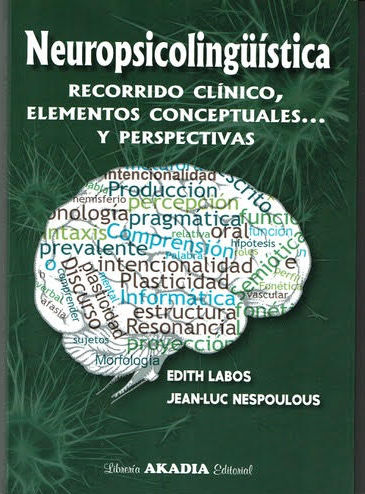Bienvenue sur le portail des membres de l'Académie de Montauban
Cet espace est dédié spécifiquement aux membres de l'Académie, qu'ils soient académiciens, associés, correspondants ou honoraires.
Il contient en page d'accueil des informations sur les activités de l'Académie et ses projets. Cette page permet aux membres qui sont des acteurs de la vie culturelle de Montauban et du département de faire connaître à leurs confrères certaines activités : conférences, expositions, publications, concerts.... susceptibles de les intéresser.
Elle permet aussi d'accéder directement à des pages particulières : les derniers numéros de notre lettre électronique, nos statuts ou un rappel chronologique de l'évolution de l'Académie au fil des années.

Académie des Sciences, des Lettres et des Arts de Montauban
Mars - Avril 2025 N°84
Sommaire
1. Le mot du Président
2. La séance publique du 3 mars 2025
3. Réception de Jean-Paul DEKISS :
4. Les Rendez-vous de l’Académie. CFM radio, N°51
5. La séance publique du 7 avril 2025
6- Les Rendez-vous de l’Académie. CFM radio, N°52
7. Les publications de l’Académie
1. Le mot du Président
Le mot du Président : Printemps

Nom d’une saison, le mot est devenu symbole de renouveau, voire de renaissance. Nous le trouvons dans l’intitulé de manifestations artistiques, littéraires ou culturelles y compris politiques ! : « printemps des poètes », « printemps des arts », « printemps Arabe », « printemps de Bourges », « printemps de Prague », « printemps républicain ». Il est aussi, avec son cortège d’images évocatrices voire plus explicites, synonyme de saison des amours. De grands peintres comme Arcimboldo, Botticelli, Monet entre autres l’ont magnifiquement illustré. Il évoque également l’effervescence, l’efflorescence, voire les débordements, une certaine joie de vivre, un bonheur inauguré, ou retrouvé.
Si Antonio Vivaldi, Claude Debussy l’ont orchestré, Léo Ferré pour sa part l’a chanté : « Y’a la mer qui s’prend pour Monet/ ou pour Gauguin ou pour Manet/ c’est l’printemps/…Y’a la pluie qu’est passée chez Dior/pour s’payer l’ model soleil d’or/ c’est l’printemps/…. Et des ballots qui n’ont pas vu/ qu’c’était l’printemps…. »
Igor Stravinsky, lui, avait compris que cela méritait un sacre !!!
2. La séance publique du 3 MARS
La séance publique du lundi 3 mars 2025
(Compte rendu rédigé par Pierre Gauthier)
Le président ouvre la séance à 17 heures.
Il rappelle que nous fêterons dans quelques jours le 150ème anniversaire de la naissance de Maurice Ravel : il fait écouter un extrait de Jeux d'eau, œuvre du compositeur, interprété par Ravel lui-même.
Le Secrétaire Général présente ensuite l’actualité culturelle du mois en insistant sur le salon de la philatélie qui se tiendra dans la salle du Marché Gare de Montauban en fin de semaine, et sur l’ouverture de l’exposition, au cœur de la collection Brache-Bonnefoy, à l’Abbaye de Beaulieu en Rouergue.
3. Réception de Jean-Paul DEKISS

Puis c'est la réception de M. Jean-Paul Dekiss de Nemesker, élu au 10ème fauteuil, celui qu’occupait Paul Duchein . Il est parrainé par Mireille Courdeau et Christian Stierlé.
Mireille Courdeau le présente : cinéaste de formation, c’est un réalisateur, un écrivain, un acteur de la culture, qui a le secret d’une solidarité engagée.
Il a créé en 2014 une ferme des lettres à l’Honor de Cos. « Honnête homme du XXIe siècle », il n’a rencontré les lettres et la poésie qu’assez tardivement, à la sortie de son lycée de Versailles. Autodidacte, il a découvert le cinéma aux Armées. Il devient scénariste puis réalisateur et producteur de nombreux films, dont 6 longs-métrages. Il est plusieurs fois sélectionné dans des festivals internationaux. Cependant, ainsi que l'explique Mireille Courdeau, « Votre détestation des médiocrités, des ambitions va vous faire quitter le cinéma ». Fruits de ses rencontres avec des œuvres et des auteurs (Jules Verne, Julien Gracq, Régis Debray, Michel Serres…) ses publications sont nombreuses. En 1995, il obtient l'accord de Gilles de Robien, alors maire d'Amiens, pour la création et l'ouverture au public de la Maison Jules Verne dans cette ville. Il la dirige de 2007 à 2011 et il y reçoit plus de150 écrivains et artistes.
« A la ferme des lettres de l’Honor de Cos, vous l’internationaliste vous vous enracinez dans un territoire », affirme M. Courdeau. Libre de corps et d’esprit, J.P. Dekiss est un militant du paradis sur terre : « c’est le fil rouge de votre vie » : fervent du rêve et du progrès, et de l’enchantement de la langue française.
Jean-Paul Dekiss prend alors la parole pour faire l’éloge de Paul Duchein, qui a tenu une place importante dans le paysage culturel montalbanais.
Il se lance en 1968 dans la fabrication de ses premières images, dans lesquelles le rêve et l’imagination tiennent une place primordiale. Il a réalisé autour de 1500 « boîtes» . [ Paul Duchein ne se définissait pas comme un artiste mais comme un « fabricateur »].
Une exposition au Musée Ingres en 2011 fit connaître une partie de son œuvre au grand public, avant que sa « Chaise de Mme Gonse » ne marque l’entrée nord de Montauban. Ce « passeur » fut un des plus grands collectionneurs d’art d’Occitanie.
Il n’a pas pour autant délaissé la pharmacie : rédacteur en chef de la Revue des Pharmaciens, il a longtemps présidé leur syndicat départemental.
Jean Paul Dekiss a décidé de consacrer sa conférence à Julien Gracq, né Louis Poirier, qu’il a rencontré plusieurs fois entre 1999 et sa mort en 2007 : Julien, comme Sorel, et Gracq par référence aux Gracques, deux frères tribuns de la plèbe dans la Rome républicaine. Tout en apportant de précieux renseignements biographiques, cette communication est centrée sur la première partie de l’œuvre d’un des plus grands écrivains de langue française du XXe siècle, du Château d’Argol au Rivage des Syrtes, ouvrage qui obtint le Prix Goncourt 1951, que Gracq refusa pour dénoncer les compromissions commerciales du monde littéraire.
Le conférencier lit de nombreuses citations qui mettent longuement en relief sobriété et force poétique du style. Le texte de cette communication sera publié dans le Recueil de l'Académie, où le lecteur aura tout loisir de savourer les richesses dont un résumé ne peut donner l'idée.
Le président remet au nouvel académicien, comme il est de tradition, la médaille de l'Académie, avant de lever la séance à 18 h 30.
4. CFM Radio Les Rendez-vous de l’Académie N° 51
L’émission était consacrée à Maurice Ravel à l’occasion du 150ème anniversaire de sa naissance.
La fortune du mot composer
5. La séance publique du 7 AVRIL
(Compte rendu rédigé par Pierre Gauthier)
Le Président ouvre la séance à 17 heures. Il passe la parole au secrétaire général adjoint qui présente les évènements culturels à venir à Montauban et dans le département.
Il appelle l’attention sur le 4e salon du livre, le 27 avril 2025, à Montauban, et sur la semaine du cinéma espagnol annoncée au cinéma Le Paris.
Puis la parole est donnée au conférencier, M Arnaud Bezard-Falgas, qui nous parle de son grand-père, le colonel Reverdy, « sous l’épée, la plume et le pinceau », militaire, historien, artiste.
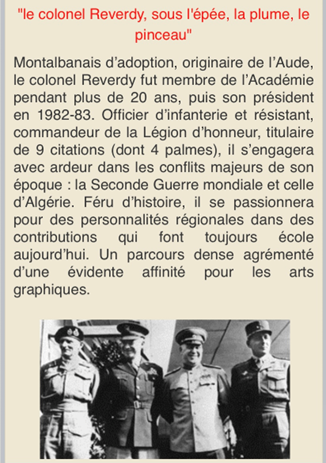
Il sollicite donc l’indulgence de l’auditoire devant le risque de « transports partiaux » de sa part.
Né à Gruissan dans l’Aude d’un père conservateur des hypothèques et souvent muté, scolarité à Saint Théodard puis à Sorrèze, le futur colonel Reverdy est une forte personnalité. Il siégea plus de vingt ans au fauteuil n°15 de notre Académie, où il fut élu en 1975 et qu’il présida en 1982 et 1983.
Il garda beaucoup d’activités à sa retraite, écrivit ses mémoires quatre ans avant sa mort, à Montauban, en 1996.
Il s’intéressa notamment à la généalogie familiale, puis à l’histoire et rédigea des biographies de gens célèbres : Hippolyte de Guibert, Alfonse Jourdain, Jean Daniel Dumas et ses exploits au Canada, les Malartic, Olympe de Gouges bien sûr… Ayant du goût pour l’histoire et le roman historique, il en composa trois.
Mais c’est aussi un artiste qui s'essaie à l’aquarelle et au dessin à la plume avec un résultat plus qu’honorable, comme en témoignent les illustrations projetées au cours de la conférence.
Mais l’essentiel de cette causerie concerne la carrière militaire d'Yvan Reverdy qui s’engage à 19 ans : se succèdent l’occupation de la Ruhr, Saint Maixent d’où il sort sous-lieutenant, l’Algérie, puis la campagne de France, des combats de forte intensité, blessé et fait prisonnier sur la colline inspirée de Sion, chère à Barrès.
Libéré pour raison sanitaire, il rejoint l’état-major de Montauban en 1941. Il participe immédiatement à un travail de camouflage de matériel militaire à l’ORA - organisation de résistance de l’armée.
Arrêté, interrogé au Fort Montluc à Lyon, il a la chance d’être relâché. Il reprend ses activités dans la résistance puis dans l’Armée de la Libération, qui le conduisent à exercer un commandement dans la bataille du Médoc, et à la libération d' une des « poches » allemandes de l’Atlantique.
Après la guerre, il poursuit sa carrière militaire en Allemagne puis au Maroc. De nombreuses distinctions sont venues reconnaître la qualité de ses services. Il prend sa retraite à Montauban où il développe dans le monde de la culture les nombreuses activités évoquées plus haut : « sous l’épée, la plume et le pinceau ».
Ce récit empreint de piété filiale et fort plaisamment illustré de documents familiaux a passionné une assistance nombreuse qui tenait à rendre hommage tant au président de l’Académie qu’il fut en 1982 et 83 qu’au combattant de la France libre.
La séance est levée vers 18h15
6. CFM Radio Les Rendez-vous de l’Académie N° 52
Invité Rosendo Li

L’entretien a permis de découvrir l’itinéraire et la personnalité et les centres d’intérêt de ce plasticien dessinateur sino-péruvien
La fortune du mot : dessin
L’illustre du mois par Anne Lasserre : Félix Bouisset
Le livre du mois : « La nef de Géricault » de Patrick Grainville
Le Poème : l’Etranger de Charles Baudelaire
« Qui aimes-tu le mieux, homme énigmatique, dis ? ton père, ta mère, ta sœur ou ton frère ?
— Je n’ai ni père, ni mère, ni sœur, ni frère.
— Tes amis ?
— Vous vous servez là d’une parole dont le sens m’est resté jusqu’à ce jour inconnu.
— Ta patrie ?
— J’ignore sous quelle latitude elle est située.
— La beauté ?
— Je l’aimerais volontiers, déesse et immortelle.
— L’or ?
— Je le hais comme vous haïssez Dieu.
— Eh ! qu’aimes-tu donc, extraordinaire étranger ?
— J’aime les nuages… les nuages qui passent… là-bas… là-bas… les merveilleux nuages ! »
7. Publications de l’Académie
Bon de commande
Mr , Mme , :
Adresse :
souhaite recevoir le(s) livre(s) suivant(s) (soulignez les livres commandés) :
- 400ème anniversaire du siège de Montauban (1621-2021) : 15 €.
- Le Franc de Pompignan, Homme de Lettres et citoyen : 20 €.
- Deux siècles d’histoire de l’Académie (1730-1930) : 20 €.
- Le voyage de Languedoc et de Provence : 10 €
- L’Axe Garonne, la terre et les hommes : 10 €.
- Du Tarn-et-Garonne aux Tranchées : nos poilus : 15 €.
- Dictionnaire des Montalbanais, illustres, méconnus, oubliés : 25 €.
- Pouvillon retrouvé : 20 €.
Participation aux frais d’envoi pour une commande : 6€.
Ouvrages récents :
- Le Handicap. La frontière ( ?) entre le normal et le pathologique. Colloque. J-L Nespoulous (ed.) : 15 €.
- Qui êtes-vous réellement cher Blaise Pascal ? : 10 €.
Règlement, par chèque uniquement, à l’ordre de l’Académie de Montauban.
Le détail de nos publications est en ligne sur le site internet de l’Académie de
Montauban : http://www.academiemontauban.fr/publications/ouvragescollectifs
Responsable de la lettre électronique de l’Académie :
Robert d’Artois
Mise en page :
Jean-Luc Nespoulous
Messagerie :
Adresse :
Maison de la Culture, 25 Allée de l’Empereur, 82000 Montauban
POUR EN SAVOIR PLUS, cliquer sur ce lien
Académie des Sciences, des Lettres et des Arts de Montauban
Février 2025
N°83
Sommaire :
1 - Le mot du Président : p. 1-
2 - La séance publique du 3 février 2025 : p. 2-
3 - Les Rendez-vous de l’Académie. CFM radio, N°49 : p. 5
4 - La séance publique du 3 mars 2025 :
Réception de Jean-Paul de Kiss : p. 6
5- Les publications de l’Académie : p. 6-7
1. Le mot du Président
Retraite, plusieurs acceptions différentes pour un mot dans les préoccupations actuelles.
En France on part en retraite, alors qu’en Espagne et dans toute l’hispanité on « jubile», car la retraite s’y nomme « jubilacìon » j’ai l’habitude de dire que les mots que nous utilisons parlent de nous….
« Faire retraite », c’est se retirer un moment de la vie sociale et de ses agitations journalières, certains le pratiquent dans un cloitre, d’autres simplement en se mettant « au vert » ou partant en mer, ou encore escaladant quelque sommet.
Il y a en effet différentes manières et différents lieux possibles pour se retourner momentanément sur notre existence, nos manières de vivre, de partager, vers des formes de méditation.
Par contre, « partir en retraite » c’est se retirer des « actifs officiels », parfois d’ailleurs pour, dans une nouvelle vie, avec de nouveaux centres d’intérêt, être plus actif….
Mais on bat aussi la retraite ce qui n’est guère glorieux, ce qui nous remet en mémoire la Bérézina et la retraite de Russie, la fin de l’épopée napoléonienne fût une mise en retrait par les anglais à Sainte Hélène…
Restons positifs et festifs avec une belle retraite aux flambeaux qui elle est jubilatoire…
Mais quelle que soit la forme, il s’agit toujours de retrait, d’interruption, comme une fin programmée. Voila pourquoi j’apprécie ce mot de jubilation car il sous-entend une dimension heureuse, rayonnante…
Cela peut sembler contradictoire… Si contradiction il devait y avoir, Voltaire dans son « Epitre à Horace » la transcende gaiement « Je cherchais la retraite. On disait que l’ennui / de ce repos trompeur est l’insipide frère./ Oui la retraite pèse à qui ne sait rien faire ;/ mais l’esprit qui s’occupe y goute un vrai bonheur ».. autrement dit : une jubilation…
2. La séance publique du 3 février
Compte rendu rédigé par Pierre Gauthier
Le Président ouvre la séance à 17 heures. Après quelques mots de bienvenue et le rappel succinct par le secrétaire général de l’agenda culturel à Montauban, Madame Martine De Grande, membre associé, présente sa conférence sur « L'orientalisme français dans l’art au XIXe siècle »

L’orientalisme, précise la conférencière, désigne « un climat qui va se propager à travers tous les arts et se développer dans tous les mouvements artistiques, le principal étant le romantisme », ce courant artistique et littéraire étant inspiré par l’orient (recouvrant les rives orientales de la Méditerranée et l’Afrique du Nord)
On trouve ses origines lointaines dans l’alliance franco-turque de 1536, les « turqueries » des XVII et XVIIIe siècles, la mode des divans et des sofas. Pensons aussi aux Lettres Persanes de Montesquieu.
En 1704, Antoine Galland traduit et diffuse les Contes des Mille et Une Nuits .
Au XIXe siècle, l’esthétique orientaliste devient source d’inspiration pour les peintres, les musiciens, les écrivains et les architectes.
Quatre évènements majeurs favorisent cet essor de l’orientalisme :
- La campagne d’Egypte
- La guerre d’indépendance grecque
- La conquête de l’Algérie
- L’ouverture du canal de Suez
Y contribue aussi largement la facilité des voyages
La peinture
Le propos de la conférencière est accompagné de la projection de nombreuses œuvres particulièrement bien choisies, les unes très connues (« Le Massacre de Chios », « La Bataille des Pyramides », « La Réception de l’ambassadeur du Siam », « Le Bain turc ») d’autres beaucoup moins. « Là où l’Europe paraît sombre et froide, l’orient est lumineux, chaud et coloré ». Il n’est pas étonnant que de nombreux peintres y trouvent leur inspiration.
On pense tout de suite aux scènes de bataille, aux uniformes rutilants d’Antoine Gros (La Bataille des Pyramides) mais il convient de citer aussi
- Louis François Lejeune, général, plusieurs fois blessé, qui fut directeur de l’Ecole des Beaux-Arts de Toulouse
- Le diplomate Dominique Vivant Denon, dessinateur et graveur talentueux
- Et naturellement Delacroix, auteur, avec Le Massacre de Chios (1824), du premier tableau politique de l’histoire de l’art, 110 ans avant Guernica.
- Jean Léon Jérôme et La Réception de l’ambassadeur du Siam (1861)
- Horace Vernet (La Prise de Constantine), qui fut le peintre « officiel » de la conquête de l’Algérie.
Le Hammam alimenta les fantasmes occidentaux, et donna l’occasion de présenter des nus féminins dans une atmosphère particulière (Benjamin Constant et Intérieur de harem au Maroc , Ingres et Le Bain turc , Chassériau et La Toilette d’Esther).
La peinture de genre met en scène la vie quotidienne : Etienne Dinet ( La Balançoire) et Gustave Guillaumet (Les Tisseuses à Bou Saâda)
Eugène Delacroix, qui suivit la Mission Mornay en 1832 au Maroc, d’où il ramena 7 carnets de croquis, reste le plus grand représentant de l’orientalisme.
Les peintres sont aussi frappés par l’immensité du désert : Sahara de Gustave Guillaumet, « le Millet du désert » (1867), Léon Belly et ses Pèlerins allant à La Mecque (1861)
La musique
L’orient a eu une influence sur la musique occidentale. La conférencière cite
- Les Indes Galantes (1735) de Jean-Philippe Rameau, symbole d’une époque d’insouciance raffinée vouée au plaisir et à la galanterie.
- Samson et Dalila (1877) de Camille Saint Saëns.
- Estampes (1903) de Claude Debussy.
La littérature
Le voyage en Orient devient une entreprise à la mode (Chateaubriand en 1811, Lamartine en 1835, Gérard de Nerval, « un fou de génie » en 1851)
Maxime Ducamp, Flaubert, Alexandre Dumas (Le Comte de Monte- Cristo est parcouru par le souvenir desMille et une Nuits ), tous ont aussi embarqué pour l’Orient. Théophile Gautier accompagna l’impératrice Eugénie à l’inauguration du canal de Suez. Pierre Loti, fasciné par la Turquie, y trouve son inspiration.
L’architecture
Dès 1867, les expositions universelles favorisent la concrétisation des attentes grâce aux pavillons orientaux, de plus en plus nombreux. Ils inspirent aux architectes des œuvres qui témoignent d’une créativité étonnante.
Sont cités
- Le Musée Georges Labit à Toulouse (1893)
- La Casamaures, à proximité de Grenoble
- La cathédrale de La Major à Marseille
La fin de l’orientalisme
Les facilités nouvelles de déplacement vont faire décliner l’intérêt pour l’orientalisme. Les artistes se tournent vers un autre Orient, encore inexploré, la Chine et le Japon.
L’orientalisme prendra un autre visage ouvert sur l’abstraction, avec Matisse, Paul Klee et Vassili Kandinski.
L'indépendance de l’Algérie en 1962 et la fermeture de la villa Abd-El-Tif (ouverte en 1907, l'équivalent algérien de la Villa Médicis), sonneront le glas du courant orientaliste qui avait vécu sa plus grande gloire au XIXe siècle.
Un public nombreux applaudit chaleureusement cette conférence lumineuse.
3. Les rendez vous de l’Académie CFM N°49

Alain Daziron, créateur des « journées de Larrazet » était l’invité de cette 49ème émission une occasion pour la fortune du mot d’explorer « journée »… Alain Daziron pour sa part outre l’entretien avait choisi comme lieu le cap Blanc-Nez dans le Pas de Calais…et un regard sur Socrate, Pierre disserta sur le rugby, Anne mit en lumière l’itinéraire de Justin de Selves. Le livre du mois « Trésor caché » de Pascal Quignard. Vous pourrez écouter l’émission en cliquant sur le lien suivant : https://www.cfmradio.fr/alain-daziron
4. La séance publique du 3 mars
C’est Mireille Courdeau vice-présidente qui, au nom de notre Académie, recevra Jean Paul De Kiss au fauteuil 10, qu’occupait Paul Duchein. Après avoir fait l’éloge de son prédécesseur Jean Paul De Kiss qui a mis en valeur les maisons d’écrivains et notamment celle de Jules Verne à Amiens, nous parlera de Julien Gracq qu’il a rencontré à plusieurs reprises dans sa maison de Saint Florent le vieil, proche de Saumur.
5. Publications de l’Académie
Bon de commande
Mr , Mme , :
Adresse :
souhaite recevoir le(s) livre(s) suivant(s) (soulignez les livres commandés) :
- 400ème anniversaire du siège de Montauban (1621-2021) : 15 €.
- Le Franc de Pompignan, Homme de Lettres et citoyen : 20 €.
- Deux siècles d’histoire de l’Académie (1730-1930) : 20 €.
- Le voyage de Languedoc et de Provence : 10 €
- L’Axe Garonne, la terre et les hommes : 10 €.
- Du Tarn-et-Garonne aux Tranchées : nos poilus : 15 €.
- Dictionnaire des Montalbanais, illustres, méconnus, oubliés : 25 €.
- Pouvillon retrouvé : 20 €.
Participation aux frais d’envoi pour une commande : 6€.
Ouvrages récents :
- Le Handicap. La frontière ( ?) entre le normal et le pathologique. Colloque. J-L Nespoulous (ed.) : 15 €.
- Qui êtes-vous réellement cher Blaise Pascal ? : 10 €.
Règlement, par chèque uniquement, à l’ordre de l’Académie de Montauban.
Le détail de nos publications est en ligne sur le site internet de l’Académie de
Montauban : http://www.academiemontauban.fr/publications/ouvragescollectifs
Responsable de la lettre électronique de l’Académie :
Robert d’Artois
Mise en page :
Jean-Luc Nespoulous
Messagerie :
Adresse :
Maison de la Culture, 25 Allée de l’Empereur, 82000 Montauban
POUR EN SAVOIR PLUS, cliquer sur ce lien
Académie des Sciences, des Lettres et des Arts de Montauban
Janvier 2025
N°82
Sommaire
1 - Le mot du Président : p. 1-2
2 - La séance publique du 6 janvier 2025 : p. 2-5
Philippe Bécade : La découverte de la circulation du sang : quinze siècles d’errances
3 - Les Rendez-vous de l’Académie. CFM radio, 13 janvier 2025. : p. 6
4 - La séance publique du 3 février 2025 :
Martine de Grande ; L’orientalisme dans l’art du XIX siècle p. 6-7
5 - Les publications de l’Académie : p. 8
1. Le mot du Président
Forain, foraine : par tradition depuis près d’une trentaine d’années, notre Académie organise une sortie dite « foraine » à l'intention de ses membres titulaires et associés, un dimanche de printemps. Cette année, ce sera le 18 mai - nous avons vérifié les dates afin d’éviter la maladresse que j’avais commise l’année dernière en plaçant cette sortie le dimanche de la fête des mères….Choix par omission effectivement peu pertinent…Il peut être intéressant de s’intéresser au terme forain qui nous vient du bas latin : foranus – qui dépasse à l’extérieur, d’où étranger, foran en provençal. Le dictionnaire historique d’Alain Rey précise qu’au XVIIème siècle on parle encore d’une « rue foraine » c’est-à-dire écartée du centre… Puis le mot signifie : qui vient de l’extérieur, peu à peu éliminé au profit d’étranger…Il ne s’emploie plus aujourd’hui qu’au sens de : qui vend sur les foires et les marchés, d’où les fêtes foraines des jours de foire…
2. La séance publique du 6 janvier 2025
(Compte rendu rédigé par Pierre Gauthier)
Le président ouvre la séance en présentant les vœux de l’Académie à l’assistance.
Il rappelle que le lendemain 7 janvier nous serons au 10e anniversaire de l’attentat contre Charlie Hebdo. Il cite la phrase attribuée de manière apocryphe à Voltaire : « je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire » et souligne que la liberté de conscience ne se morcelle pas.
L’assemblée observe à sa demande une minute de silence.
Le secrétaire général donne la liste des réunions culturelles annoncées pour le mois de janvier à Montauban et Verdun/Garonne.
Puis Philippe Bécade présente « la découverte de la circulation du sang : quinze siècles d’errances ».
 Si les grandes découvertes médicales sont dues au hasard (la pénicilline) ou à la mise à profit de découvertes dans d’autres secteurs (le microscope), les questions tenant au cœur et au sang tiennent une place à part : organe d’essence divine, à caractère sacré, siège de l’âme, complexité du système cardio-vasculaire alimentent des controverses pouvant être violentes.
Si les grandes découvertes médicales sont dues au hasard (la pénicilline) ou à la mise à profit de découvertes dans d’autres secteurs (le microscope), les questions tenant au cœur et au sang tiennent une place à part : organe d’essence divine, à caractère sacré, siège de l’âme, complexité du système cardio-vasculaire alimentent des controverses pouvant être violentes.
Le conférencier brosse une anatomie rapide du système cardio-vasculaire et souligne deux paramètres essentiels pour la circulation du sang, le calibre des vaisseaux et la viscosité du sang. Ce système assure des échanges essentiels à la vie. Il n’a été connu qu’après vingt siècles de tâtonnements.
Philippe Bécade analyse les erreurs d’Hippocrate, d’Aristote et de Galien, : le dernier, plus grand médecin de l’Antiquité, a fait autorité pendant quatorze siècles.
Son œuvre a été traduite en arabe à Bagdad entre le 8e et le 12e siècles et se diffuse en Andalousie, à Constantinople, dans des monastères italiens : le monde arabe et persan (avec Avicenne) adopte la médecine galénique.
Ces publications sont traduites par Gérard de Crémone à Tolède et Arnaud de Villeneuve à Montpellier (qui accueille les médecins juifs expulsés d’Espagne).
La renaissance affine la recherche dans le domaine de la circulation, l’anatomie étant en l’occurrence associée à l’esthétique (Michel Ange, Léonard de Vinci et l’Homme de Vitruve).
Surtout c’est l’époque où trois grand savants en viennent à contredire Galien :
- André Vesale (Andrea Van Vesel), le plus grand anatomiste de tous les temps, fournit la description précise et exacte de l’anatomie cardiaque. Il sera poursuivi par l’Inquisition.
- Miguel Serveto (Michel Servet), poursuivi à la fois par les catholiques et les protestants, sera brûlé vif le 27 octobre 1553, avec ses livres, pour hérésie (arianisme).
- Et un élève de Vesale, Réaldo Colombo
Cet épisode donne l’occasion au conférencier de riches digressions sur la pratique des autodafés, de livres jugés dangereux, fléaux des dictatures, de Platon bannissant les poètes de la République idéale au régime Pinochet mettant en1981 le Don Quijote à l’index.
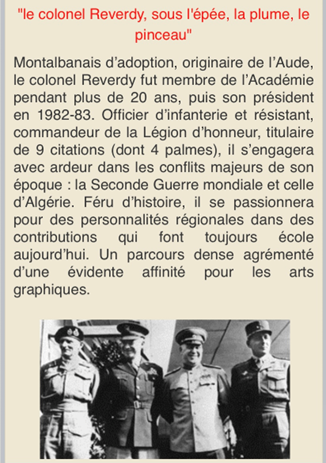
On arrive à une compréhension globale du système circulatoire avec William Harvey qui met fin, en 1628, à 15 siècles de dogme galéniste : le cœur est le point de départ et d’arrivée des vaisseaux. A partir de là, tout devient clair et la circulation « n’est plus qu’une affaire de plombier » : le cœur est une pompe qui envoie un liquide dans un circuit fermé.
Harvey n’en est pas moins dénoncé comme charlatan par les maîtres de la Sorbonne, Gui Patin et Riolan. Il est en revanche soutenu par Descartes, Malebranche puis Boileau. L’intervention de Louis XIV sera décisive.
Dans ce contexte, Molière dans Le Malade imaginaire ridiculise le doyen de la Faculté de Paris.
Découverte à Berlin en 1924 : un manuscrit de Ibn Al Mafis (né en 1213), le plus grand physiologiste du Moyen Age, dont un passage passé longtemps inaperçu apporte la même description que Harvey. Or l’un et l’autre ont travaillé à Padoue et l’école de Padoue connaissait les travaux d’Ibn Al Mafis.
Alors de quel côté de la Méditerranée le schéma de la circulation sanguine a-t-il été dessiné avec exactitude ? Cela n’aurait aucune importance pour qui entend André Siegfried pour lequel la Méditerranée est le seul continent liquide.
Plus récemment Claude Bernard mit en lumière le rôle des nerfs vasomoteurs : ceux-ci s’ajoutent au cœur, aux artères et aux veines, aux capillaires et au sang pour composer le système circulatoire.
Parallèlement la question de la viscosité du sang a provoqué l’apparition d’une nouvelle discipline, l’hémodynamique.
En définitive un système remarquablement compliqué, dont un des dérèglement les plus connus est l’hypertension artérielle (HTA) désigné par les Américains comme un « serial killer ».
En conclusion, nous dit le conférencier, la découverte des mécanismes de la circulation sanguine n’est pas venue d’un éclair qui éblouit, elle est issue d’un voile qui se déchire lentement. A l’infiniment grand et à l’infiniment petit ils ont ajouté l’infiniment complexe.
De la salle conquise par cette conférence magistrale viennent alors une série de questions qui prolongent le débat.
3. CFM - Les rendez vous de l’Académie , émission n° 48 du 13 janvier 2025

Le bouquiniste « bolégayre » Maurice Baux était l’invité de cette émission qui, au cours de l’entretien et des questions, nous fit partager son amour des livres et leur importance dans son itinéraire d’éducation populaire.
La fortune du mot explora les richesses du mot remuer, bouléguer en occitan. Maurice Baux avait choisi aussi de nous parler de Notre Dame des Grâces, un de ses lieux préférés.
Pierre Gauthier insista sur la richesse de l’offre culturelle à Montauban et d’autres communes du département.
Anne Lasserre nous remit en mémoire les avancées sociétales mises en œuvre par l’illustre Charles de Broca, élu à l'Académie en 1864 et qui en fut le président en 1867.
Le livre du mois était Bristol de Jean Echenoz
Maurice Petit, pour sa part, avait choisi de lire un superbe passage d’Alberto Manguel extrait de son Histoire de la lecture.
4. La séance publique du 3 février2025
Martine de Grande, membre associé, présentera « L’orientalisme dans l’art du XIXème siècle » : De la campagne d’Egypte suivie de la guerre d’Indépendance de la Grèce, l’expansion du colonialisme et le lent effondrement de l’empire Ottoman feront naître l’Orientalisme artistique à travers la peinture, la littérature, la musique et l’architecture, jusqu’à son épanouissement. Une formidable source d’imagination et d’inspiration….
Fêter semble un impératif de circonstances. Cependant, dans un monde à la fois surpris et marqué par des successions d’événements multiples, variés voire impensables, avons-nous encore le cœur à fêter ? Il ne serait peut-être pas futile de se poser la question : « que fêter et comment » ? Même la fin des plus de quarante ans de la dictature syrienne, par les incertitudes qu’elle ouvre, n’engage guère à la fête. Par ailleurs les aléas climatiques et les ravages provoqués notamment dans le Pas de Calais puis en Espagne, notre très proche voisine, ne peuvent nous laisser indifférents. Ils ont d'ailleurs suscité des élans de solidarité qui ont de quoi nous remettre du baume au cœur : les humains sont capables de dépasser des résidus de nombrilisme et de s'ouvrir aux autres - ce que rappelait Montaigne : « tout homme porte en lui la forme entière de l’humaine condition ».. Un proverbe serbe ne dit-il pas qu’ « un arbre s’appuie sur les autres arbres, comme l’homme s’appui e sur les autres hommes ».
Alors oui, en marge des rassemblements familiaux habituels, n'oublions pas ceux que la solitude enferme et fêtons une dimension parfois retrouvée de la fraternité.
5. Publications de l’Académie
Bon de commande
Mr , Mme , :
Adresse :
souhaite recevoir le(s) livre(s) suivant(s) (soulignez les livres commandés) :
- 400ème anniversaire du siège de Montauban (1621-2021) : 15 €.
- Le Franc de Pompignan, Homme de Lettres et citoyen : 20 €.
- Deux siècles d’histoire de l’Académie (1730-1930) : 20 €.
- Le voyage de Languedoc et de Provence : 10 Euros.
- L’Axe Garonne, la terre et les hommes : 10 €.
- Du Tarn-et-Garonne aux Tranchées : nos poilus : 15 €.
- Dictionnaire des Montalbanais, illustres, méconnus, oubliés : 25 €.
- Pouvillon retrouvé : 20 €.
Participation aux frais d’envoi pour une commande : 6€.
Ouvrages récents :
- Le Handicap. La frontière ( ?) entre le normal et le pathologique. Colloque. J-L Nespoulous (ed.) : 15 €.
- Qui êtes-vous réellement cher Blaise Pascal ? : 10 €.
Règlement, par chèque uniquement, à l’ordre de l’Académie de Montauban.
Le détail de nos publications est en ligne sur le site internet de l’Académie de
Montauban : http://www.academiemontauban.fr/publications/ouvragescollectifs
Responsable de la lettre électronique de l’Académie :
Robert d’Artois
Mise en page :
Jean-Luc Nespoulous
Messagerie :
Adresse :
Maison de la Culture, 25 Allée de l’Empereur, 82000 Montauban
POUR EN SAVOIR PLUS, cliquer sur ce lien :
Académie des Sciences, des Lettres et des Arts de Montauban
Décembre 2024
N°81
Sommaire
1 - Le mot du Président : p.2
2 - La séance publique du 4 novembre : p. 2-8
- Mireille Courdeau : La symbolique de l’eau autour de trois cartes du Tarot de Marseille : p.3-4
- Alain Visentini : La symbolique de l’eau dans la poésie grecque : p. 4-6
- Anne Lasserre : Au fil de l’eau : symbolique et poétique de l’eau : 6-7
3 - Le colloque inter-académique des 100 ans de l’Académie de Pau-Béarn (avec conférence de Robert d’Artois), 23 novembre 2024. p. 8-9.
4 - Les Rendez-vous de l’Académie. CFM radio, 2 décembre. : p. 9
5 - La séance solennelle du 15 décembre : p. 10
6 - Les publications de l’Académie : p. 11
1. Le mot du Président
Fêter semble un impératif de circonstances. Cependant, dans un monde à la fois surpris et marqué par des successions d’événements multiples, variés voire impensables, avons-nous encore le cœur à fêter ? Il ne serait peut-être pas futile de se poser la question : « que fêter et comment » ? Même la fin des plus de quarante ans de la dictature syrienne, par les incertitudes qu’elle ouvre, n’engage guère à la fête. Par ailleurs les aléas climatiques et les ravages provoqués notamment dans le Pas de Calais puis en Espagne, notre très proche voisine, ne peuvent nous laisser indifférents. Ils ont d'ailleurs suscité des élans de solidarité qui ont de quoi nous remettre du baume au cœur : les humains sont capables de dépasser des résidus de nombrilisme et de s'ouvrir aux autres - ce que rappelait Montaigne : « tout homme porte en lui la forme entière de l’humaine condition ».. Un proverbe serbe ne dit-il pas qu’ « un arbre s’appuie sur les autres arbres, comme l’homme s’appuie sur les autres hommes ».
Alors oui, en marge des rassemblements familiaux habituels, n'oublions pas ceux que la solitude enferme et fêtons une dimension parfois retrouvée de la fraternité.
2. La séance publique du 4 novembre (Compte rendu rédigé par Pierre Gauthier)
Le président ouvre la séance à 15h30, en évoquant le compositeur Gabriel Fauré, né à Pamiers en 1845 et décédé à Paris un 4 novembre, en 1924 : il y a cent ans aujourd'hui.
Le Secrétaire Général énumère les événements culturels du mois, particulièrement nombreux, marqués avant tout par les « Lettres d’Automne », dont l’animatrice, Agnès Gros, était l'invitée de l’émission mensuelle de l’Académie sur CFM82, enregistrée le matin même (émission diffusée le mardi à 20h et le dimanche à 14h).
Il est rappelé que le nouveau prix Goncourt, Kamel Daoud, est venu à Montauban à plusieurs reprises, invité par les « Lettres d’Automne ».
Dans cette actualité il faut signaler aussi les journées Manuel Azaña, dont M Bruno Vargas assure maintenant la présidence, remplaçant notre collègue JP Amalric, fondateur de ces journées.
Le Secrétaire Général rappelle ensuite les activités de l’UTAM, de la Société Archéologique de Tarn-et-Garonne, des Amis du Musée Ingres, du Groupe d’Histoire de Verdun-sur-Garonne, de la SMERP et de la Compagnie des Ecrivains.
Le Président signale enfin qu’un verre de l’amitié sera offert à la fin de notre séance solennelle, le dimanche 15 décembre au Théâtre Olympe de Gouges.
Mireille Courdeau présente la première des trois communications consacrées à la symbolique de l’eau. Ces trois communications, brillantes, ont été particulièrement appréciées par un public nombreux.
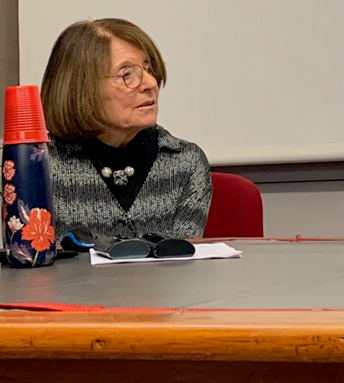
2.1. La symbolique de l’eau autour de trois cartes du jeu de Tarot de Marseille.
Le Tarot, indique d’abord la conférencière, est une « langue composée de 78 lettres, qui sont des cartes colorées » : c’est une « grammaire personnelle, et pourtant universelle, qui permet d’imaginer de multiples interprétations pour ces messages hermétiques ».
Elle centrera son propos sur trois cartes, arcanes majeurs du Tarot de Marseille : la Tempérance, l’Etoile et la Lune : toutes trois traitent de l’eau, non pas en tant que matière mais comme symbole à déchiffrer...
L’eau ne peut être ramenée à une formule chimique, elle est un bien commun, « enfin de moins en moins », bien commun et enjeu financier. « L’Homme vénère l’eau dépositaire de ses croyances, de ses espérances, de ses joies, de ses peurs ».
« Sacrée et vénérée parce que nécessaire à la vie, l’eau est symbole de fertilité, d’abondance matérielle et de richesse spirituelle ».
Dans toutes les religions, aspersions, ablutions, immersions sont autant de rituels de purification par l’eau : on pense par exemple aux bains des fidèles dans les eaux du Gange.
Mais comment lire les baignades dans la Seine lors des jeux Olympiques ?
Symbole de vie et en même temps symbole de mort, l’eau fascine et surprend, elle appelle à la rêverie pour Gaston Bachelard.
La conférencière souligne que l’eau porte un triple symbole : de vie, de purification et de régénération.
Le Tarot de Marseille a intéressé de nombreux artistes, d’André Breton à Michel Tournier et Niki de Saint Phalle. Le premières cartes de ce jeu auraient été peintes vers 1450 en Italie. Son iconographie, d’abord d’inspiration chrétienne, s’en affranchit peu à peu sous l’influence des astrologues et des alchimistes, puis des révolutionnaires. Le premier Tarot de Marseille remonte à 1760 et, sous sa forme actuelle, à 1930.
Une interrogation : « l’Homme trouve-t-il dans le Tarot les réponses qui le rassurent sur sa place sur terre, dans l’univers, sur son avenir, sur sa finitude ? »
C’est sous cet éclairage que la conférencière a abordé l’étude des trois cartes dans lesquelles l’eau est présente.
Ici, tout a un sens : aucune couleur, aucun trait, aucun chiffre n’est laissé au hasard
Le tarot de Marseille est composé de 78 cartes, 22 arcanes majeurs et 56 arcanes mineurs (arcane, dérivé du latin, mystère, secret, caché)
Les quatre séries d’arcanes mineurs illustrent le monde qui entoure l’homme, les quatre éléments originels : le feu pour les bâtons, l’eau pour les coupes, l’air pour les épées et la terre pour les deniers.
Les 22 arcanes majeurs posent à l’Homme des questions essentielles. Trois cartes nous parlent de l’eau :
Sur la carte de la tempérance (arcane n°14), l’eau est source de vie et d’énergie
Celle de l’Etoile (n°17) symbolise l’eau créatrice
L’eau de la lune (arcane n°18) est régénératrice : « l’être humain se régénère aux larmes de la lune »
« Le Tarot de Marseille serait donc une école de réflexion, une école de déduction, une école de vie, un univers où on parle un langage étrange, où les mots sont remplacés par des symboles et les phrases par des images »
L’eau, symbole universel de la connaissance.
2.2. Alain Visentini prend la suite pour nous présenter la symbolique de l’eau dans la poésie grecque :
« on ne se baigne jamais dans le même fleuve » nous dit Héraclite pour symboliser la fuite du temps.
Le conférencier privilégiera dans tout son propos Hésiode, poète du 8e siècle avant notre ère, contemporain d’Homère ; L’Odyssée aussi sera largement citée.
Il évoquera successivement les eaux marines puis les eaux fluviales et les sources.

Hésiode raconte, dans un vaste poème épique, Théogonie, la naissance des dieux, depuis l’océan primitif, « Flot » qui engendra avec « Gaia » la déesse mère, Nérée, lui-même père, avec Doris, de cinquante filles, les Néréides.
Ce récit d’Hésiode « constitue une véritable genèse, une cosmogonie qui raconte la naissance du monde jailli de forces cosmiques, océanes et telluriques… »
La perception par Homère de la mer, « plaine marine », « flot salé » est complexe et ambiguë : « la mer apparaît tour à tour comme menaçante, dangereuse, espace de tous les périls, de toutes les “odyssées “, mortelle et en même temps, féconde et bienveillante »
Les fleuves sont les veines où circulent, sur la terre, les puissances des dieux. Hésiode évoque les fleuves comme « vivants et descendants d’Océan », vingt cinq fleuves d’Asie Mineure mais aussi des fleuves étrangers comme le Nil, et les fleuves de Grèce.
La perception des eaux fluviales est « assurément » animiste : elles ont une âme, un destin, constituent des protections tutélaires ou, au contraire, se montrent de redoutables ennemis.
Personnaliser le fleuve, le nommer, l’invoquer, est une marque d’appropriation rassurante visant à l’apprivoiser
Les sources, les fontaines sont sur cette terre écrasée de soleil perçues comme un don des dieux : « jaillissant généreusement de la terre-mère Gaïa, elles apparaissent comme une bénédiction et le séjour privilégié des divines naïades ». Ce lien mystérieux de la terre-mère avec le clair jaillissement du monde souterrain qui en surgit comme un cadeau divin explique la richesse des mythes qui entourent les sources et les fontaines.
Le conférencier achève son propos par l’évocation terrifiante des fleuves infernaux, dont le plus connu, le Styx, fleuve du dégoût, de la haine : un droit de passage est exigé par l’épouvantable Charon et chaque arrivant doit lui céder la pièce de monnaie qu’on lui a mise dans la bouche. Homère décrit le monde des enfers, la rencontre avec l’âme des défunts, les châtiments reçus par des héros aux âmes impures, ayant osé défier et outrager les dieux, comme Tityos, Tantale et Sisyphe.
2.3. Il revenait à Anne Lasserre de conclure ce triptyque avec une promenade poétique, en France, dans une période bien plus récente :
Au fil de l’eau : symbolique et poétique de l’eau
Que nous dit l’eau, qui court sous la plume des poètes ? (A de Vigny dans Le Cor)
Cascades qui tombez des neiges entrainées,
Sources, gaves, ruisseaux, torrents des Pyrénées
L’onde est transparente sous la plume de La Fontaine, dans l’« l’Ile » d’Henri de Régnier, elle devient glauque.
L’eau charme par sa voix, elle fascine par son mouvement : « la mer, la mer toujours recommencée », de Paul Valéry. Sa voix est changeante : la pluie de novembre chuchotait, tambourinait et fredonnait sur le toit de la cabane de Kenneth White.

La conférencière souligne que la présence de l’eau en poésie est appelée par sa puissance évocatrice, son pouvoir sur l’imaginaire. Elle devient un véritable personnage ; la Seine de Jacques Prévert, insouciante, se la coule douce. L’eau sanglote nous dit Victor Hugo dans Les Contemplations , Pierre Reverdy l’entend pleurer. Et chacun depuis Verlaine sait qu’« il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville »
Anne Lasserre insiste toutefois sur la puissance symbolique de l’eau, qui apparaît dans des pratiques quasi universelles signalées dans les autres communications,
ablutions,
immersions
baptême.
« l’océan qui gronde,
Et qui sert au soleil de vase baptismal » (Victor Hugo)
L’eau dessine la fuite du temps, par exemple dans Le Lac de Lamartine et Sous le Pont Mirabeau d’Apollinaire.
L’eau est aussi un miroir, qui renvoie bien des reflets, à commencer par le nôtre :
La mer est ton miroir ; tu contemples ton âme
Dans le déroulement infini de sa lame (Ch. Baudelaire, « L’homme et la mer »)
Miroir du monde, le fleuve devient le symbole du pays natal : Du Bellay célèbre son Loire gaulois qui lui plaît davantage que le Tibre latin.
L’eau est aussi source de métamorphose, elle nous lave de ce que nous avons été, efface le passé. La Sorgue « roule aux marches d’oubli la rocaille de ma raison »(René Char). « La pluie nous a lavés et lessivés » (François Villon dans La Ballade des pendus).
Elle incite au recueillement, à la méditation, à la contemplation.
Mais en appelant à l’aventure, elle devient symbole de liberté : « Homme libre, toujours tu chériras la mer »(Ch. Baudelaire)
L’eau se fait même sculptrice : Victor Hugo dans son long poème, « Dieu »
La goutte d’eau travaille, et, terrible ouvrière,
Tord en cercles profonds l’énorme fondrière
Notre collègue termine son propos en insistant sur la relation que bien des poètes voient entre l’eau et la création poétique. René Char traduit la source-inspiration devenant rivière- poème : « la poésie est de toutes les eaux claires celle qui s’attarde le moins aux reflets de ses ponts »
« il faut lire le poème comme il est écrit – comme on passe un gué – où l’eau s’insurge autour de ces pierres inertes qui prétendent briser son courant »
Et comment oublier « Le bateau ivre » de Rimbaud :
« Et dès lors, je me suis baigné dans le Poème
De la Mer, infusé d’astres et lactescent
Dévorant les azurs verts ; où, flottaison blême
Et ravie, un noyé pensif parfois descend »
En conclusion, l’eau est un être total avec un corps, une voix, et une âme. Elle est une réalité poétique complète. Aussi comment enfermer l’eau dans quelques mots, le temps d’une conférence ?Par principe, l’eau est libre, vivante, multiple, toujours la même et jamais la même. Et sa voie est intarissable .
Les trois intervenants ont été vivement applaudis.
La séance est levée à 18h15
3. Le colloque inter-académique des 100 ans de l’Académie de Pau-Béarn
Le samedi 23 novembre, à l'occasion de son centenaire, l’Académie de Pau a organisé un colloque interacadémique sur « Le vin, signature d'un territoire et d'un terroir ». Robert d’Artois nous y représentait et y donna une conférence intitulée « Vins de cépages, vins de terroirs : droit du sol, droit du sang ! » dont voici l’argumentaire : « La Bible, pourtant très prolixe sur l’ivresse de Noé (jugée indécente par ses enfants) lors de la fin du déluge, ne nous donne aucune indication quant au terroir et cépage ou cépages de ce vin semble t-il tombé du ciel…

En revanche, le Gargantua de Rabelais nous conte comment le moine Jean des Entommeures sauve la vigne de l’Abbaye de Seuillé ( sans doute un chenin) dévastée par les troupes de Picrochole…
Cicéron vante les vins de Falerne… et aussi quelques vins grecs ; il est vrai que l’on évoque plus souvent les terroirs que les cépages sauf lorsqu’ils sont uniques, prenant le pas sur les lieux…
Certains sont portés à croire que le cépage fait la spécificité du vin , alors que d’autres en célèbrent le lieu d’origine, appelé terroir…
Mais tout cela n’est pas si simple, voire simpliste, ce que nous analyserons… Que dit-on donc des vins combinant plusieurs cépages, allons-nous opposer irrémédiablement Bordeaux et Muscadet, Côte du Rhône et Viognier ?
Cépage et terre s’allient pour générer le vin…
En est-il de même en ce qui concerne les nationalités ? Peut-on raisonnablement pousser l’analogie, sont-elles liées aux lieux de naissance ou aux origines biologiques des humains ?
En France cela est tranché depuis Charles VII, qui qualifie de français tout individu né dans le royaume. Alors qu’en Allemagne où le cépage est privilégié, le droit du sang a permis à Hitler de justifier un certain nombre d’invasions en Europe centrale…
Mais cette comparaison - même si elle n’est pas raison, et si, de surcroît, il faut lui adjoindre le travail des vignerons - nous enseigne qu’à partir des différences de cépages et de vins on peut réfléchir sur des problèmes de société et peut-être les regarder d’un œil différent… »
4. CFM les rendez-vous de l’Académie, émission enregistrée le 2 décembre

La 47ème émission avait invité Vincent Roberti, préfet du département de Tarn-et-Garonne qui expliqua comment et pourquoi, après des études et un doctorat en mathématiques, il avait opté pour le service de l’État. En conséquence Robert d'Artois a exploré la fortune du mot « calcul ». Puis Anne Lasserre a fait découvrir deux illustres : Théodore et Germain Olivier, tandis que le lieu choisi par l’invité était Montmartre à Paris. Maurice Petit lut le poème « Terre de France » de François Fabié. Le livre du mois, Le sentiment des crépuscules, de Clémence Boulouque, explore la rencontre en 1938 entre Salvador Dali et Freud par l’entremise de Stephan Zweig. Pour sa part, Pierre Gauthier évoqua le public.
Pour écouter l'émission, cliquer sur le lien :
https ://www.cfmradio.fr/vincent-roberti-prefet-du-tarn-et-garonne
5. La séance solennelle du 15 décembre
En conclusion du cycle de conférences proposées depuis le mois de septembre autour du thème de l’Eau, Maurice Petit, Florence Viguier-Dutheil, Jean-Marc Andrieu, membres titulaires, accompagnés au piano par Marie Condamin ont choisi de l’évoquer au Théâtre Olympe de Gouges sous l’angle de ses représentations artistiques, qu’elles soient littéraires, picturales ou encore musicales. Une invitation à une promenade au fil de l’eau en pays de poésie, de mélodies et de scènes peintes. Un moment propice à l’évasion pour clore une année académique particulièrement riche sur le plan culturel.
6. Publications de l’Académie
Bon de commande
Mr , Mme , :
Adresse :
souhaite recevoir le(s) livre(s) suivant(s) (soulignez les livres commandés) :
- 400ème anniversaire du siège de Montauban (1621-2021) : 15 €.
- Le Franc de Pompignan, Homme de Lettres et citoyen : 20 €.
- Deux siècles d’histoire de l’Académie (1730-1930) : 20 €.
- Le voyage de Languedoc et de Provence : 10 Euros.
- L’Axe Garonne, la terre et les hommes : 10 €.
- Du Tarn-et-Garonne aux Tranchées : nos poilus : 15 €.
- Dictionnaire des Montalbanais, illustres, méconnus, oubliés : 25 €.
- Pouvillon retrouvé : 20 €.
Participation aux frais d’envoi pour une commande : 6€.
Ouvrages récents :
- Le Handicap. La frontière ( ?) entre le normal et le pathologique. Colloque. J-L Nespoulous (ed.) : 15 €.
- Qui êtes-vous réellement cher Blaise Pascal ? : 10 €.
Règlement, par chèque uniquement, à l’ordre de l’Académie de Montauban.
Le détail de nos publications est en ligne sur le site internet de l’Académie de
Montauban : http://www.academiemontauban.fr/publications/ouvragescollectifs
Responsable de la lettre électronique de l’Académie :
Robert d’Artois
Mise en page :
Jean-Luc Nespoulous
Messagerie :
Adresse :
Maison de la Culture, 25 Allée de l’Empereur, 82000 Montauban
POUR EN SAVOIR PLUS, cliquer sur ce lien :
Académie des Sciences, des Lettres et des Arts de Montauban
Novembre 2024
N°80
Sommaire
1 - Le mot du Président : p.1
2 - La séance publique du 7 octobre: p.2-3
3 - Les Rendez-vous de l’Académie. CFM radio, 14 octobre : p.4
4 - La séance publique du 4 novembre : p.4
5 - Les publications de l’Académie : p.5
1 - Le mot du président
Nous la cherchons souvent, l’inspiration, c’est sans doute la raison pour laquelle nous retenons souvent les noms des inspiratrices, déesses, égéries sans lesquelles nombre de poèmes, odes, musiques, statues, peintures n’auraient vu le jour. Laure inspira Pétrarque, la voûte étoilée inspira Van-Gogh… Mais ce peut être un lever ou un coucher de soleil, un paysage, une vue de l’esprit, l’instant d’un rêve qui nous inspire, comme nous le manifeste l’histoire de la création artistique. Et ce, même si, parfois, comme l’a admirablement dessiné Goya : « les songes de la raison engendrent des monstres ».
Encore une fois c’est la formulation du terme et son contexte qui vont faire sens. « J’ai l’inspiration », est à différencier de « je m’inspire de » … Dans le premier, c’est ma force créatrice qui génère, dans le second, je m’appuie sur des situations pour les extrapoler ou les embellir ou, sur de l’existant, pour le décliner, à l’instar de Picasso avec les « Ménines » de Velasquez.
Mais il est aussi tout à fait possible de reproduire en signalant que l’on s’est fortement inspiré ou qu’il s’agit d’une copie. Omettre de l’indiquer ou ne pas le faire délibérément porte un nom : plagiat (du grec plagios : oblique, fourbe), ce qui relève d’un rapport à l’éthique.
Privilégions donc et célébrons l’inspiration créatrice suscitée par tel être aimé, désiré, tel fugace instant superbe, telle rencontre ou relation exceptionnelle, lorsque le temps acquiesce à notre supplique et « suspend son vol »…,nous laissant « savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. » (Lamartine).

Raphaël, « L’école d’Athènes », 1512
2. La séance publique du 7 octobre
Sylvie Brunel, géographe (qui connaît bien notre département), professeur émérite à la Sorbonne, ancienne présidente d’Action contre la Faim, auteur entre autres d’un ouvrage intitulé Pourquoi les paysans sauveront le Monde , était la conférencière invitée dans le cadre da la thématique de l’eau. Son propos, « Du maïs à la Camargue, croire en l’avenir du monde », tenait à marquer l’importance du dieu maïs, dont la culture régresse malheureusement en Europe. Reprenons ici le compte rendu bref et clair qu’en a fait Le Petit Journal :

« Le maïs est indispensable et pourtant mal aimé. Pour la conférencière, la culture du maïs est adulée dans le monde où elle ne cesse de progresser. Pour nourrir l’humanité en quête d’aliments de qualité, préserver les sols, la biodiversité et le climat, aucune plante n’égale la céréale des Dieux, aliment anti famine des pauvres.
Pour Sylvie Brunel, qui reprend longuement le sujet dans son ouvrage Sa Majesté le maïs, en France, première exportatrice mondiale de semences de maïs, nous accusons de tous les maux ce nerf de la guerre, en particulier du gaspillage de l’eau. Il en fait pourtant le meilleur usage possible pour assurer la transition écologique.
De nombreux échanges ont eu lieu avec l’assistance venue en nombre pour une conférence passionnante.
Sylvie Brunel est géographe, économiste et écrivain. Spécialiste de l’Afrique et des questions de développement et de famine, elle est aussi l’une des anciennes présidentes de l’association humanitaire Action contre la faim.
Sylvie Brunel a deux passions, les chevaux et la Camargue, et une obsession : nourrir le monde. Toute son œuvre littéraire est centrée sur ces trois piliers. Mais face aux peurs comme au catastrophisme, il devient de plus en plus difficile de résister aux dogmes ! Outre Sa Majesté le Maïs, elle a publié récemment Le sourire de l’alligator. »
3. Les rendez-vous de l’Académie - CFM radio, le 14 octobre

L’invité de notre 45ème émission était Alain Petit, directeur de la Maison des Jeunes et de la Culture de Verdun-sur-Garonne. Après plus de 30 ans à la tête de cette institution de « la République des jeunes » imaginée dès la fin de la guerre par Olivier Philip, Alain va prendre sa retraite. C’est avec passion qu’il nous a parlé de son travail, de sa conception de l’éducation populaire, de la vitalité (plus de 2000 adhérents ), des animations et du rayonnement de cette MJC. La « fortune du mot » a d’ailleurs exploré les richesses du terme jeune, Anne Lasserre a tracé le portrait de « l’illustre » Georges Saint-Yves. Le livre du mois est de Dominique Bona, Les Partisans, Kessel et Druon : l’Académicienne y conte les liens, les actions communes des deux auteurs du Chant des partisans. C’est Anne qui a lu un poème de circonstance, « Le mois d’octobre » , de François Coppée. Pour écouter l’émission : https://www.cfmradio.fr/alain-petit
Dès novembre notre émission va améliorer sa formule avec de nouvelles rubriques et une équipe renforcée.
4. La séance publique du 4 novembre
Cette séance, la troisième de notre thématique de l’eau, sera assurée par un trio de deux consoeurs et un confrère : Mireille Courdeau nous fera découvrir la place de l’eau dans les tarots marseillais, Anne Lasserre son importance et son abondance dans la littérature française, et Alain Visentini pour sa part nous indiquera les cheminements gréco-latins des sources comme des jaillissements et ruissellements de l’eau…
5. Publications de l’Académie
Bon de commande
Mr , Mme :
Adresse :
souhaite recevoir le(s) livre(s) suivant(s) (soulignez les livres commandés) :
- 400ème anniversaire du siège de Montauban (1621-2021) : 15 €.
- Le Franc de Pompignan, Homme de Lettres et citoyen : 20 €.
- Deux siècles d’histoire de l’Académie (1730-1930) : 20 €.
- Le voyage de Languedoc et de Provence: 10 €.
- L’Axe Garonne, la terre et les hommes : 10 €.
- Du Tarn-et-Garonne aux Tranchées : nos poilus : 15 €.
- Dictionnaire des Montalbanais, illustres, méconnus, oubliés : 25 €.
- Pouvillon retrouvé : 20 €.
Participation aux frais d’envoi pour une commande : 6 €.
Ouvrages récents :
- Le Handicap. La frontière ( ?) entre le normal et le pathologique. Colloque. J-L Nespoulous (ed.) : 15 €.
- Qui êtes-vous réellement cher Blaise Pascal ? : 10 €.
Règlement, par chèque uniquement, à l’ordre de l’Académie de Montauban.
Le détail de nos publications est en ligne sur le site internet de l’Académie :
http://www.academiemontauban.fr/publications/ouvragescollectifs
Responsable de la lettre électronique de l’Académie :
Robert d’Artois
Mise en page :
Jean-Luc Nespoulous
Messagerie :
Adresse :
Maison de la Culture, 25 Allée de l’Empereur, 82000 Montauban
POUR EN SAVOIR PLUS, cliquer sur ce lien :
Académie des Sciences, des Lettres et des Arts de Montauban
Octobre 2024
N°79
Sommaire
1. Le mot du Président : p.2
- Lé séance publiquedu 16 septembre: p. 2-4
- Le 27 septembre. Notre Académie invitée par l’Académie de Toulon : p.4
4. La séance publique du lundi 7 octobre : p. 5-6
4. Les publications de l’Académie : p. 7
1. Le mot du président
Nourrir : cet infinitif sonne comme un impératif, une exigence, une ambition - infinitif : ce mot ne laisse-t-il pas entendre que ce ne sera jamais achevé , jamais définitif ?… Depuis la nuit des temps le pain quotidien n'est-il pas le symbole de cette nécessité primordiale ?
Trop heureux les peuples qui peuvent consommer deux repas par jour alors que plus d’un tiers de la planète souffre de malnutrition, voire de dénutrition. Sylvie Brunel, notre conférencière invitée le 7 octobre, nous éclairera sur ces points, elle qui a été pendant de nombreuses années présidente d’Action contre la faim. NOURRIR est d'ailleurs le titre d’un de ses ouvrages.
J’en appelle à Etienne de La Boétie pour qui il ne saurait être question de la seule nourriture organique : «J’aime ce qui me nourrit : le boire, le manger et les livres»… Se nourrir de livres, de musique, d’arts plastiques est certes enrichissant; mais peut-être y concourent aussi les relations humaines, l'amitié, le partage, la fraternité. Voilà sans doute une manière d’exercer une part de notre humanité, en développant, approfondissant ce qui est inné, ce que nous appelons : «se cultiver». Contemporain de La Boétie, Jean Bodin se plaisait à affirmer qu’«il n’est de richesses que d’hommes», une belle conception de l’enrichissement...
Il n’est d’ailleurs pas innocent que le mot culture renvoie à la fois à la terre que l’on cultive et à l’esprit qui se cultive…
2. La séance publique du 16 septembre
Compte rendu rédigé par Pierre Gauthier
Le Président ouvre la séance à 17h 10 en présentant les nombreux talents de l’intervenant, Monsieur François Boitard, anthropologue, qui nous parle des impensés de l’eau.
Nous naissons de l’eau, rappelle d’entrée le conférencier, mais nous ne pouvons pas y retourner en même temps que nous ne pouvons pas vivre sans eau. Celle-ci est à la fois symbole de vie et symbole de mort.
La culture de l’eau est, depuis l’antiquité, partagée entre le sacré et le profane. Les Romains, qui ont une vénération, un culte de l’eau, disciplinent et organisent son emploi : thermes, aqueducs, égouts, aménagements portuaires.
Du déluge au baptême elle est présente à toutes les étapes de la genèse du christianisme.
L’avancée d’une approche rationnelle des phénomènes naturels (Lavoisier, Franklin) ne conduira pas à l’abandon des figures mythiques, des arts aux expression des cultures populaires (les fontaines, divinités récupérées par le christianisme). La révolution de l’arrivée de l’eau courante, l’explosion des piscines n’y changeront rien.
A l’origine nous naissons de l’eau, nous sortons d’un univers fusionnel, et le conférencier d’appeler dans sa démonstration Hergé, Michel Serres (un enfant de la Garonne), le costume marin et le couffin, la publicité pour Evian et les bébés nageurs, le « Grand Bleu »…
Le passage, la sortie de ce monde fusionnel voit remonter à la surface des souvenirs archaïques, des peurs (crabe, araignées..). Nous devons nous nourrir : c’est la fonction de la tétée. « Toute eau est un lait »(G Bachelard) : pensons aux fontaines ubérales, à la scène de la fontaine de Trévi dans La Dolce Vita.
Arrive l’heure de la sexualité. La femme est associée dans la plupart des représentations à l’élément liquide, de La Naissance de Vénus, de Botticelli à Jolie môme de Léo Ferré. Dans L’Eau vive de Guy Béart, l’eau est, en plus, symbole de liberté.
L’œuvre de Marcel Pagnol associe étroitement la femme, l’eau, la vie.
Femme-eau mais aussi femme tueuse : pensons aux sirènes, à la légende de Lorelei.
Et l’homme ? Il est lui aussi associé à l’eau mais dans des symboles très différents. De Noé et Moïse à Cousteau, Bompard, Tabarly, l’homme se sert de l’eau, la domine, la maitrise. La mer, les fleuves sont des lieux privilégiés de conflits, d’expression de l’héroïsme : « Homme libre, toujours tu chériras la mer »
L’eau a toujours été présentée liée au désir, et en particulier au désir sexuel, depuis les étuves médiévales jusqu’à La Piscine de Jacques Deray et au Club Méditerranée. Le film Le Gendarme de St Tropez lui-même est présenté comme illustrant le basculement d’une société dans la modernité. Et le développement du transport aérien permet de réaliser le désir d’îles paradisiaques
Mais parfois survient Thanatos. La vague est toujours présente et menaçante : c'est le mythe du combat avec la force des éléments déchaînés.
Heureusement il y a des doubles : l’objet transitionnel permet de s’habituer peu à peu à la solitude, et facilite la prise de conscience de l’altérité et l’affirmation de sa propre identité.
Le miroir d’eau permet de passer de l’eau qui rafraichit à l’eau qui réfléchit.
Et on ne peut pas séparer l’eau de l’idéal de pureté :
- L’agneau pur buvant dans l’onde pure est encore plus pur
- L’eau bénite fait reculer Satan
- Nos nouvelles Sainte Geneviève, celle de l’Etat et celle de la ville, plongent dans les eaux de la Seine soi-disant redevenues correctes.
Face à la pollution en effet, algues vertes, marées noires, l’eau ne serait plus le symbole de la pureté et de la vie ? « Les mythes de l’eau s’effondrent. Voire »
Vouloir restaurer la nature première, besoin de rêve, retour à la pureté fantasmée des origines : « L’eau est le lait inépuisable de la nature Mère ». (P. Claudel)
Nous ne sommes pas prêts à ne voir dans l’eau que la combinaison de deux gaz !
Il a été rappelé notamment au cours du bref débat qui a suivi cette communication très riche et très appréciée que l'eau est incompressible : rien n’arrête sa puissance, comme l'attestent, partout sur le globe, les ravages des inondations.
La séance est levée à 18h.

La grande vague de Kanagawa (Hokusai)
3. Le 27 septembre notre Académie invitée par l’Académie de Toulon
Jacques Carral y a donné une conférence très suivie sur le Voyage de Languedoc et de Provence de Jean-Jacques Le Franc de Pompignan. L’intégralité de cette conférence sera bientôt sur notre site.
4. La séance publique du 7 octobre
Sylvie Brunel, géographe, professeur émérite à la Sorbonne, prolongera notre cycle de l’eau. Spécialiste des questions de développement, elle s’intéresse particulièrement aux enjeux de sécurité alimentaire. Sa conférence s’intitule : Du maïs à la Camargue, croire en l’avenir du monde. Un de ses récents ouvrages - outre celui cité plus haut - porte le titre étendard de ses analyses et réflexions : Pourquoi les paysans sauveront le monde. Thème qui résonne particulièrement dans ce département de Tarn-et-Garonne que l’on qualifie souvent de potager et verger de la région toulousaine. Pour Sylvie Brunel les agriculteurs sont les acteurs de la nouvelle révolution agricole qui consiste à produire en protégeant la nature : « Ils sont les premiers écologistes de la Terre ».

L’Adieu, de Tadao Cern
Sculpture monumentale d’épis de blé érigée verticalement
(Abbaye de Beaulieu)

4. Publications de l’Académie
Bon de commande
Mr , Mme , :
Adresse :
souhaite recevoir le(s) livre(s) suivant(s) (soulignez les livres commandés) :
- 400ème anniversaire du siège de Montauban (1621-2021) : 15 €.
- Le Franc de Pompignan, Homme de Lettres et citoyen : 20 €.
- Deux siècles d’histoire de l’Académie (1730-1930) : 20 €.
- Le voyage de Languedoc et de Provence : 10 Euros.
- L’Axe Garonne, la terre et les hommes : 10 €.
- Du Tarn-et-Garonne aux Tranchées : nos poilus : 15 €.
- Dictionnaire des Montalbanais, illustres, méconnus, oubliés : 25 €.
- Pouvillon retrouvé : 20 €.
Participation aux frais d’envoi pour une commande : 6€.
Ouvrages récents :
- Le Handicap. La frontière ( ?) entre le normal et le pathologique. Colloque. J-L Nespoulous (ed.) : 15 euros
- Qui êtes-vous réellement cher Blaise Pascal ? : 10 euros
Règlement, par chèque uniquement, à l’ordre de l’Académie de Montauban.
Le détail de nos publications est en ligne sur le site internet de l’Académie de
Montauban : http://www.academiemontauban.fr/publications/ouvragescollectifs
Responsable de la lettre électronique de l’Académie :
Robert d’Artois
Mise en page :
Jean-Luc Nespoulous
Messagerie :
Adresse :
Maison de la Culture, 25 Allée de l’Empereur, 82000 Montauban
POUR EN SAVOIR PLUS, cliquer sur ce lien :
Septembre 2024
N°78
Sommaire
1. Le mot du Président : p.2
2. Thématique de l’eau (septembre-décembre 2024)
(Contribution de Daniel Donadio) : p.3-6
3. La séance publique du lundi 16 septembre : p. 7
4. Les publications de l’Académie : p. 8
1. Le mot du Président
« On a de l’expérience, on manque d’expérience » … Subtile ambivalence que celle de ce mot dont le contexte précise la signification… Ce qui nous incite à la vigilance face aux citations extraites de leur contexte, comme aux inflations verbales que souvent seule notre « expérience » nous permet de débusquer…
En ce qui concerne notre Académie, nous tentons donc l’expérience de consacrer à une même thématique les dernières conférences de l’année, en 2024 l’eau et en 2025 la langue française.
Ouvrons ce cycle de l’eau. Le 16 septembre, c’est l’anthropologue François Boitard qui nous alertera sur les « impensés de l’eau » ; le 7 octobre Sylvie Brunel, Professeur à la Sorbonne, intitulant sa conférence « Du maïs à la Camargue, croire en l’avenir du monde » traitera de l’irrigation et de son importance pour les cultures nourricières. En novembre, le trio composé de Mireille Courdeau, Anne Lasserre et Alain Visentini nous fera explorer l’eau dans les tarots marseillais, mais aussi la dimension poétique et onirique de l’eau à travers leurs choix dans les littératures de la Grèce et de la Rome antiques comme de la littérature française.
La séance solennelle du 15 décembre, animée par Florence Viguier et Maurice Petit, avec le concours musical de Jean-Marc Andrieu, évoquera la puissance inspiratrice de l'eau, sa présence dans tous les arts, ses manifestations esthétiques autant que plastiques.
Mais il serait hasardeux et peu fidèle à l’esprit de notre Académie de nous aventurer dans cette thématique si nous nous contentions des évocations et références que je viens de citer et ce en ignorant un certain nombre de données techniques, économiques, vitales, essentielles. C’est pourquoi notre confrère Daniel Donadio, très sensibilisé à ces questions, nous propose les réflexions ci-dessous.
2. Thématique de l’eau
Septembre-décembre 2024,

Cette série de conférences sur le thème de l’eau, présentée par l’Académie de Montauban, de septembre à décembre 2024 est d’actualité (en fait elle tombe à pic) car elle est au centre de nombreuses interrogations, scientifiques, économiques et écologiques. Les différents thèmes abordés nous invitent à quelques réflexions, comme l’origine de l’eau sur terre, l’origine de la vie sur terre et la notion de bien public, de bien commun, de partage, qui sont aujourd’hui menacés.
L’eau, comme l’air et la terre, est essentielle à la vie, telle que nous la connaissons aujourd’hui, Ses propriétés physiques (conducteur thermique), ses propriétés chimiques (solvant et dilution) et sa capacité d’exister sous trois états [solide, liquide et gazeux (vapeur d’eau)] en font un acteur-clé dans la genèse de la vie et le fonctionnement des divers processus géologiques et écologiques.
- La quête scientifique qui fascine savants et chercheurs, depuis des siècles, est l’origine de l’eau sur notre planète. D’ou vient-elle ? Depuis le big bang, il y a 13,82 milliards d’années, et la formation de la terre( à partir de la nébuleuse solaire) il y 4,6 milliards d’années, plusieurs théories sont explorées :
- La théorie des comètes et des astéroïdes (chondrites carbonées), qui ont amené sous forme d’eau glacée de grandes quantités d’eau ; c’est le bombardement lourd tardif (3,5 à 4 milliards d’années).
- La théorie des chondrites à enstatite, qui a permis de retrouver de l’eau dans des roches présentes dès l’origine de la terre ; des travaux récents, notamment australiens, ont confirmé cette hypothèse.
- La théorie des micro-météorites : ce sont des particules, rarement supérieures au centimètre, qui bombardent la terre de façon permanente, encore de nos jours, (plusieurs milliers de tonnes chaque jour).
- Enfin la théorie de la nébuleuse proto-solaire qui a permis le stockage de l’eau dans les profondeurs de la terre (au delà de 250 km).
En résumé, les scientifiques plaident pour la succession de ces différentes théories pour expliquer l’origine de l’eau sur terre : originelle, (tout au début de la planète) approvisionnement secondaire, stockage. Le système solaire en général (4,6 milliards d’années) a joué un rôle moteur sur le système planétaire : ce système solaire initial, dans un environnement dynamique, est caractérisé par une chaleur intense, des radiations et la présence de diverses particules et matériaux. C’est la naissance du jeune soleil. Rappelons la dernière découverte, grâce au télescope géant (James Webb), d’une exoplanète, « une planète océan » à 48 années-lumière de la terre.
- La deuxième interrogation : L'eau à l'origine de la vie ?
« L’eau n’est pas nécessaire à la vie, elle est la vie » (Saint-Exupéry) On s’éloigne ainsi de Theillard de Chardin pour qui l’origine de la vie est Dieu.
La vie apparaît avec la formation des océans, il y a 3,5 à 4 milliards d’années. Un vrai bouillon de culture s’organise : des micro-organismes, des cyanobactéries vont extraire l’oxygène de l’eau et vont s’opposer aux deux gaz prépondérants, à côté de la vapeur d’eau, le dioxyde de carbone (CO2) et le dioxyde de soufre (SO2). Rappelons que la structure de l’eau est formée de 2 molécules d’hydrogène et 1 molécule d’oxygène (H2O). L’oxygène, le réchauffement solaire avec la luminosité et la photosynthèse : les trois ingrédients fondamentaux pour l’apparition de la vie sur terre . Se succèdent des organismes monocellulaires puis des organismes pluricellulaires, acteurs, certes rudimentaires, de la naissance de la flore et de la faune. Ensuite les mécanismes d’adaptation vont progressivement transformer la vie aquatique vers la vie terrestre ; les branchies sont remplacées par les poumons, le cœur avec 2 cavités pour la vie aquatique se transforme en 4 cavités pour la vie terrestre (2 oreillettes et 2 ventricules). Le cycle de l’eau, évaporation (vapeur d’eau) précipitation et ruissellement, en régulant la température, façonne les paysages (surtout les littoraux) en influençant les modèles climatiques. A côté des cyanobactéries, la photosynthèse a pour but de créer de l’énergie sous forme de glucides (sucre) à partir de l’énergie lumineuse provenant du soleil. C’est une réaction biochimique, énergétique qui se déroule chez les plantes. Les trois éléments indispensables à la photosynthèse sont la lumière solaire, le dioxyde de carbone (CO2) et l’eau (H2O) qui se combinent dans le chloroplaste des cellules végétales pour produire du glucose et libérer de l’oxygène (2ème source d’oxygène après les cyanobactéries). La chlorophylle, pigment vert présent dans les chloroplastes, capte la lumière solaire et initie le processus photosynthétique. L’eau et l’oxygène sont bien à la base des origines de la vie sur terre, en s’appuyant sur un long processus d’adaptation qui va s’étendre sur environ 3,5 à 4 milliards d’années. La vie vient en fait des océans comme l'a parfaitement démontré Rachel Carlson.
Enfin, la dépendance humaine à l’égard de l’eau depuis l’antiquité a été une source de symboles encore présents de nos jours (mythes, légendes, civilisations primaires, religions.…,). Nos ancêtres adoraient le soleil et l’eau.
- La troisième réflexion qui nous préoccupe aujourd’hui : la place de l’eau dans notre vie quotidienne : bien commun, bien public qu’il faut partager et protéger car il est en danger.
- Répartition inégale de l’eau sur terre : 70% du globe est représenté par les océans ; 97% de l’eau salée, 3% d’eau douce ; un Français consomme en moyenne 120 litres d’eau par jour, un scandinave 250 litres, un israélien 700 litres, un américain de Las Vegas plus de 1500 litres et … un africain 3 litres par jour !
- L’eau est nourricière pour la faune, pour la flore et pour l’homme.
- L’eau est à l’origine des civilisations et des villes.
- L’eau est le support des voies navigables, au niveau des canaux, des fleuves, des mers et des océans, avec des constructions gigantesques, comme le pont du Gard, le canal de Suez ou de Panama… Et en France le barrage de Serre-Ponçon…
- L’eau est à la base de disciplines sportives avec les olympiades d’été et d’hiver.
- L’eau se retrouve au carrefour de nos cultures : littérature, peinture, architecture, musique, chanson, cinéma.
- Mais l’eau est aussi au centre de catastrophes, d’épidémies, de pollutions (plastiques dans les océans; 8°continent). Devant la montée des eaux, des capitales, comme Djakarta, sont menacées.
- Dans certains secteurs économiques et commerciaux, la guerre est déclarée ( l’histoire des bassines en agriculture) : le mariage nécessaire entre la politique de l’utilisation de l’eau et l’écologie est loin d'être facile.
- Enfin la dépendance humaine à l’égard de l’eau va au-delà de la survie de base et s’étend à l’agriculture, à l’industrie et à la production d’énergies : désalinisation dans certains pays, production d’hydrogène demain.
Ces différentes conférences nous invitent à prendre conscience de ce bien public précieux qu’il faut protéger aujourd’hui pour mieux le partager demain. C’est tout un symbole et c’est un clin d’œil sur les images, les conceptions et les rapports à l’eau qui traversent nos civilisations depuis 400 millions d’années. Ce serait une grande erreur de penser que la technologie résoudra tous les problèmes de « l’eau douce et de l’eau claire ». Une démarche individuelle est plus que jamais nécessaire et nous ramène à l’histoire du colibri.
Daniel Donadio
Un moment de réflexion (il y a plus de 50 ans) :
« L’emprise de l’homme sur la nature est devenue telle qu’elle comporte le risque de destruction de la nature elle-même il est frappant de constater qu’au moment où s’accumulent et se diffusent de plus en plus les biens dits de consommation, ce sont les biens élémentaires les plus nécessaires à la vie comme l’air et l’eau qui commencent à faire défaut. »
Georges Pompidou (discours de Chicago 28 février 1970.)
3. La séance publique du 16 septembre
« Les impensés de l’eau »
(Conférence de François Boitard)
Les mythes de l’eau, d’origine ancienne, sont toujours présents dans les symboles d’aujourd’hui et ils comptent parmi les éléments moteurs de nos sociétés modernes.
Ils s’expriment, pour peu qu’on les y cherche, dans nos productions culturelles (cinéma, télévision, publicité, arts, bandes dessinées, chansons, etc…), sorte d’à côté, de réserve nourricière de notre imaginaire. Mais ils s’expriment aussi dans nos réalisations industrielles, urbaines et commerciales, ainsi qu’à travers l’actualité, le plus souvent sous forme subliminale ou tellement naturelle qu’on ne s’en rend pas compte. Ils se révèlent vite comme miroirs des questions que l’on se pose aujourd’hui, où l’eau s’affirme comme la représentation principale, le symbole des symboles.
4. Publications de l’Académie
Bon de commande
Mr , Mme , :
Adresse :
souhaite recevoir le(s) livre(s) suivant(s) (soulignez les livres commandés) :
- 400ème anniversaire du siège de Montauban (1621-2021) : 15 €.
- Le Franc de Pompignan, Homme de Lettres et citoyen : 20 €.
- Deux siècles d’histoire de l’Académie (1730-1930) : 20 €.
- Le voyage de Languedoc et de Provence : 10 Euros.
- L’Axe Garonne, la terre et les hommes : 10 €.
- Du Tarn-et-Garonne aux Tranchées : nos poilus : 15 €.
- Dictionnaire des Montalbanais, illustres, méconnus, oubliés : 25 €.
- Pouvillon retrouvé : 20 €.
Participation aux frais d’envoi pour une commande : 6€.
Ouvrages récents :
- Le Handicap. La frontière ( ?) entre le normal et le pathologique. Colloque. J-L Nespoulous (ed.) : 15 euros
- Qui êtes-vous réellement cher Blaise Pascal ? : 10 euros
Règlement, par chèque uniquement, à l’ordre de l’Académie de Montauban.
Le détail de nos publications est en ligne sur le site internet de l’Académie de
Montauban : http://www.academiemontauban.fr/publications/ouvragescollectifs
Responsable de la lettre électronique de l’Académie :
Robert d’Artois
Mise en page :
Jean-Luc Nespoulous
Messagerie :
Adresse :
Maison de la Culture, 25 Allée de l’Empereur, 82000 Montauban
POUR EN SAVOIR PLUS, cliquer sur ce lien :
Académie des Sciences, des Lettres et des Arts de Montauban
Juillet 2024
N°77
LES ACTUALITÉS DE L’ACADÉMIE
Sommaire:
3. CFM : les rendez-vous de l’Académie. 43ème édition, enregistrée le 9 juillet : p. 5-6
4. La séance publique du lundi 16 septembre : p. 6-7
5. Les publications de l’Académie : p. 9
1. Le mot du président :
Flamme
Il y a la flamme que l’on déclare à la personne chérie, la flamme dévastatrice des incendies de l’été, la flamme qu’arboraient les chevaliers au tournoi comme à la guerre, la double flamme à la poupe du bateau (celle indiquant la nationalité du bateau et celle des eaux territoriales dans lesquelles il navigue). La flamme est aussi ce stylet avec lequel on saigne un cheval malade…
Flamme qui, partie d’Olympie, arrivée sur le trois-mâts Belem, sillonne la France avec son message de trêve, d’excellence et de fraternité.
Fierté et élégance du Colonel Thibaut Valette, champion Olympique de concours complet d’équitation, Ecuyer en Chef du Cadre Noir, - fleuron de l’ « Equitation de tradition Française » inscrit en 2011 au patrimoine culturel de l’humanité par l’UNESCO - portant cette flamme jusqu’à la tribune présidentielle des Champs-Elysées lors de la cérémonie du 14 juillet.
2. La séance publique du lundi 1er juillet
(Compte rendu rédigé par Pierre Gauthier)
Le président ouvre la séance à 17 heures, en rappelant que le compositeur Erik Satie, né à Honfleur en 1866, est mort à Paris il y a 99 ans, le 1er juillet 1925.
Il souhaite la bienvenue à quatre nouveaux membres associés admis à l’Académie, Mme Pierrette Campillo et MM. Eric Céciliot, Antony Falgas et Patrick Marty.
Il indique que le programme des conférences de l’année 2025 est arrêté, et donne la parole au Secrétaire Général.
Celui-ci rappelle le colloque sur « L’éloge du politiquement correct » qui doit se tenir dans deux jours, la saison qui s’ouvre à l’abbaye de Beaulieu avec une série de concerts entre le 5 et le 14 juillet, et l’inauguration le 11 juillet au MIB de l’exposition « Ingres et Delacroix, objets d’artistes ».
A la suite de ces informations, commence la réception de Madame Edmée Ladier, élue au 37ème fauteuil. C'est Mme Geneviève André-Acquier, sa marraine, qui accompagne l’impétrante et la présente en soulignant son engagement ancien dans les fouilles de la vallée de l’Aveyron, ses titres universitaire, son goût pour la musique aussi, ce qui la rapproche de Mme Christiane Vallespir à qui elle succède, et ses fonctions de conservateur du patrimoine de 1981 à 2011.
Mme Ladier a pris dans ses travaux sur la préhistoire dans la vallée de l’Aveyron la suite d’Albert Cavaillé et elle a permis la création du Musée Victor Brun, l’inventeur de « la Dame de Bruniquel ». Ce Musée est né d’un élan de générosité et de la volonté de transmettre d’un certain nombre d’érudits locaux.
Edmée Ladier est l’auteur d’un ouvrage publié en 1994 par le Muséum d’histoire naturelle sur Les Bijoux de la Préhistoire : la parure magdalénienne dans la vallée de l’Aveyron ».
Mme André-Acquier termine en soulignant la ténacité de notre nouvelle collègue, sa fidélité dans la démarche et au Musée : il s’agit pour elle de comprendre le lointain passé de l’Homme.
Après ses remerciements, Mme Edmée Ladier rend hommage à Mme Christiane Vallespir, professeur de musique, née à Toulouse, titulaire du CAPES d’éducation musicale et chant choral, enseignante notamment à Saint-Gaudens puis à l’IUFM de Montauban, passionnée par la transmission du savoir musical, dont la retraite se passe désormais sous le double signe de la musique et de l’aquarelle.
La nouvelle académicienne consacre ensuite sa conférence, magnifiquement illustrée, à l'évocation de la place du site de Bruniquel dans l’archéologie préhistorique de la France.
La préhistoire est une discipline scientifique récente, apparue autour de 1864, il n’y a que 160 ans, avec la publication des découvertes faites dans la vallée de la Vézère mais aussi à Bruniquel, à la grotte Courbet.
Elle est à la conjonction d’autres disciplines, la paléontologie, la géologie, l’évolution biologique des êtres vivants étudiée par Lamarck et Darwin. C’est un laboratoire du transformisme et de l’évolutionnisme.
On connaît en général l’apport des précurseurs dans le sud-ouest (Noullet, Lartet), des pionniers de la vallée de la Vézère (Henry Christy, le marquis de Vibraye), mais moins l’apport essentiel, dans la vallée de l’Aveyron, de l’abbé Pottier, de Victor Brun et d’autres chercheurs.
Une carte montre les sites explorés par Victor Brun, de Fontalès (à côté de Saint-Antonin) à la grotte Courbet et aux abris de Bruniquel.
C’est ainsi qu’on trouve dès mai 1864 un Mammouth gravé sur une défense dans le grand abri de la Madeleine (vallée de la Vézère), mais aussi dans la grotte de Courbet, à Bruniquel, une tête de renne gravée sur un os.
Et une mission exploratoire mandatée par la Société des Sciences, de l’Agriculture et des Belles Lettres de Tarn- et-Garonne a publié dès 1863 une note importante sur ses découvertes.
En 1866, Peccadeau de Lisle y fouille le site de Montastruc et en ramène de nombreux objets dont des rennes en ivoire et des propulseurs. Les recherches conduites entre 1862 et 1866 ont fait entrer Bruniquel dans l’histoire de la préhistoire, véritablement consacrée par l'Exposition Universelle de 1867. Pourtant ces recherches vont s'interrompre dans la vallée de l'Aveyron pendant plus de soixante ans alors qu’elles se poursuivent dans la vallée de la Vézère.
Elles ne reprennent à Bruniquel qu'à partir des années 1920 avec Marc Chaillot, Bernard Bétirac (Montastruc : cheval bondissant), Paul Darrasse (Fontalès) et Edmée Ladier elle-même (Gandil en 1987-1996 et, en 1985-1986, Courbet : la toute petite Vénus du même nom).
La grotte de Bruniquel, que l'on peut dater de 176 000 ans, réserve peut-être d'autres révélations. L'avenir reste ouvert…
La séance est levée à 18 h30, l'usage voulant que l'on ne pose pas de questions à un nouveau membre de l'Académie.
Philippe Bécade était l’invité de l’émission quelques jours après la clôture du colloque sur «L' éloge du politiquement correct ». Chacun des animateurs de l’émission - Anne Lasserre-Vergne, Maurice Petit et Robert d'Artois - ayant suivi ce colloque, l’occasion était belle pour le commenter. C’est d’ailleurs du terme « colloque » que s’est emparée « la fortune du mot ». Anne, pour sa part, a évoqué l’illustre Léon Rolland, et Maurice avait choisi de faire découvrir ou redécouvrir le poème de Victor Hugo « Que l’exemple vous serve ». Quant à Robert, il a profité de la publication du livre Sauvés par la sieste pour plaider en faveur de cet art du repos quotidien, méridien ou non !…
4. La séance publique du lundi 16 septembre :
Ce sera l'inauguration de la thématique de l'eau, choisie pour les quatre dernières conférences de l’année.
François Boitard, anthropologue, va l’ouvrir autour des « impensés de l’eau », qu’il nous présente ainsi :
Lors de son expérience du 27 février au 1er mars 1785, Lavoisier démontre à tous que : aqua, ax, ay et autres aigues ne constituent plus un des quatre éléments, mais un assemblage de deux gaz. Bientôt s’imposera à tous le nom d’H2O comme substantif. Cet événement marque-t-il le début de la fin des mythes et des représentations symboliques de l’eau ? De Lavoisier à aujourd’hui, nous assistons à une objectivisation de notre regard sur l’eau et, comme le dit Brassens, « le Grand Pan est mort ! »
Tout porte à le croire car, comme le souligne Madame Claudine Brelet dans son récent ouvrage Réenchanter l’eau, il nous faudrait reconstruire ces mythes de l’eau qui appartiendraient au passé dont les sociétés premières encore présentes sur notre planète seraient les seules porteuses.
Je ne le pense pas et crois pouvoir démontrer que les mythes de l’eau, d’origine ancienne, sont toujours présents dans les symboles d’aujourd’hui et qu’ils comptent parmi les éléments moteurs de nos sociétés modernes.
Ils s’expriment, pour peu qu’on les y cherche, dans nos productions culturelles (cinéma, télévision, publicité, arts, bandes dessinées, chansons, etc…), sorte d’à côté, de réserve nourricière de notre imaginaire. Mais ils s’expriment aussi dans nos réalisations industrielles, urbaines et commerciales, ainsi qu’à travers l’actualité, le plus souvent sous forme subliminale ou tellement naturelle qu’on ne s’en rend pas compte. Ils se révèlent vite comme miroirs des questions que l’on se pose aujourd’hui, où l’eau s’affirme comme la représentation principale, le symbole des symboles.
Ce sont ces impensés de l’eau, ces sens cachés ou inconscients, certains remontant aux origines, d’autres d’apparition plus récente, dont il sera question, appuyés sur divers exemples et illustrations.
5. Publications de l’Académie
Bon de commande
Mr , Mme , :
Adresse :
souhaite recevoir le(s) livre(s) suivant(s) (soulignez les livres commandés) :
- Dictionnaire des Montalbanais, illustres, méconnus, oubliés : 25 €.
Participation aux frais d’envoi pour une commande : 6€.
Ouvrages récents :
Règlement, par chèque uniquement, à l’ordre de l’Académie de Montauban.
Le détail de nos publications est en ligne sur le site internet de l’Académie de
Montauban : http://www.
Responsable de la lettre électronique de l’Académie :
Robert d’Artois
Mise en page :
Jean-Luc Nespoulous
Messagerie :
Adresse :
Maison de la Culture, 25 Allée de l’Empereur, 82000 Montauban
POUR EN SAVOIR PLUS, cliquer sur ce lien :
Académie des Sciences, des Lettres et des Arts de Montauban
Juin 2024
N°76
LES ACTUALITÉS DE L’ACADÉMIE
1. Le mot du Président : p. 2
2. La séance publique du 3 juin : p. 3-7
3. CFM : les rendez-vous de l’Académie. 42ème édition, enregistrée le 24 juin : p. 8
4. La séance publique du lundi 1er juillet : p. 8-9
5 - Le colloque de l’université de Brest « Eloge du politiquement correct », 3-5 juillet 2024 Montauban, Ancien Collège
6 . Les publications de l’Académie : p. 9
1. Le mot du Président
La pluie et le beau temps...
L’été, entamé par des séquences particulièrement pluvieuses, a enfin surgi. Nous voici imaginant, espérant, sur des terrasses ou dans des jardins, des soirées conviviales. Vraisemblablement aussi de nourritures terrestres, la table ne se concevant sans le partage. Tout cela contribue, avec les retrouvailles familiales auxquelles l’été est propice, aux plaisirs de cette saison.
Toutefois la météorologie, qui se veut scientifique et prévisionnelle, nous rappelle s’il en était besoin, sa part d’aléatoire, ce qui nous incite à un peu d’humilité, car « nous ne faisons pas la pluie et le beau temps ». L’actualité récente nous a malheureusement fait découvrir comment certains épisodes climatiques ont pu ravager des communes du Pas-de-Calais, du Maine-et-Loire, de la vallée de la Vésubie, laissant leurs habitants dans des situations catastrophiques…
Les grecs de l’antiquité , devant leur impuissance dans ce domaine, expliquaient ces évènements par des querelles de ménage entre Zeus et Héra, ou par des colères de Poséidon, ou encore par des furies d’Eole,. L'Odyssée en témoigne. Cela ne veut pas dire que nous ayons la nostalgie de la pensée antique. Reconnaissons simplement que cette mythologie révèle plus de charme, voire de poésie que les cartes météo auxquelles les différents médias nous ont accoutumés.
Face à ces aléas, à ces caprices de la nature, laissons la conclusion à Pascal : « L’homme n’est qu’un roseau, le plus faible de la nature, mais c’est un roseau pensant. Il ne faut pas que l’univers entier s’arme pour l’écraser ; une vapeur, une goute d’eau suffit pour le tuer. Mais quand l’univers l’écraserait, l’homme serait encore plus noble que ce qui le tue, puisqu’il sait qu’il meurt et l’avantage que l’univers a sur lui. L’univers n’en sait rien. »
2 - La séance publique du 3 juin
(Compte rendu rédigé par Pierre Gauthier)
Le président ouvre la séance à 17 heures, en évoquant deux anniversaires, celui du massacre des étudiants chinois sur la place Tien An Men, dans la nuit du 2 au 3 juin 1989, et celui de la fondation de la Ligue des Droits de l’Homme, le 4 juin 1898.
Le secrétaire général donne le calendrier de l’actualité culturelle du mois avec des manifestations à l’UTAM, notamment ses ateliers, à la SMERP, à la Société historique et archéologique, à la Ferme des Lettres.
Puis le président présente le conférencier, Jordi Passerat, prêtre, docteur en théologie, professeur émérite à l’Institut Catholique, Mainteneur des Jeux Floraux, Majoral du Félibrige depuis 1997, élu à l’Académie en 1980, à l’âge de 31 ans.
Sa conférence a pour titre « Les 700 ans du Gai Saber ».

J. Passerat a souhaité raconter une aventure, celle de l’Académie des Jeux Floraux, qui a fêté le 3 mai ses 700 ans (il signale l’ouvrage collectif consacré à cet anniversaire). Son exposé est illustré de nombreuses citations de textes en occitan médiéval, accompagnées de leur traduction.
Cette histoire commence par une promenade poétique, celle du premier troubadour, Guilhem IX d’Aquitaine, comte de Poitiers, chevauchant d’Agen vers Toulouse, capitale du Languedoc.
Toulouse connaît en mai 1324 un grand évènement, « un grain de folie », avec la création de la Sobregaya Companhia de Gai Saber, par 7 fondateurs, «les Mainteneurs » (champions, défenseurs), autour d’un programme : « saber far bons dictatz en roman »(savoir faire de belles pièces en Occitan) ce qui recouvre louer Dieu, notre Seigneur et ses saints, instruire les ignorants, retenir les amants fous et sots, vivre avec joie et allégresse, fuir l’ennui et la tristesse, ennemis du Gai Savoir.
Nous sommes devant une tentative de retrouver le temps où l’Occitan, langue du « trobar », rayonnait dans toutes les cours européennes. Le mouvement troubadour est sur le déclin. Les mainteneurs veulent redonner sa dignité à la langue d’Oc (dite aussi romane), menacée par l’arrivée de la langue d’oil avec le nouveau pouvoir)…
Ils invitent donc à trois jours de fête, au verger des Augustines, le 1er Mai 1324, « per chantar et s’esbaudir per que volem far entendre nostre saber ».Cette fête est organisée autour d’un concours de poésie, donnant lieu à l'attribution d’une violette d’or (offerte par les Capitouls)
Le cérémonial suivi par le Consistoire des 7 troubadours sera repris pendant des siècles, presque immuable.
Le premier lauréat sera Arnaud Vidal, de Castelnaudary.
Le contexte : une période troublée, marquée en 1320 par le passage à Toulouse des sinistre pastoureaux, en 1321 par la chasse aux lépreux. En 1325, premiers affrontements de la guerre de 100 ans.
Les Mainteneurs sont des commerçants ou des hommes de loi. Parmi eux un seul poète, Bernard de Panassac, une sorte de François Villon, petit noble venu de l’Astarac, qui sera couronné un jour, comme Ramon de Cornet, prêtre séculier puis franciscain, originaire de Saint Antonin Nobleval, désigné souvent comme le dernier troubadour, et qui mettra la langue des troubadours au service de la mystique franciscaine la plus épurée.
Les Mainteneurs s’attachent rapidement à leur organisation en Consistori del Gai Saber, qui prendra petit à petit un tour assez universitaire, avec une sélection des docteurs en Gay Saber et remise d’un diplôme. Guilhem Molinié, lui-même troubadour, est chargé d’un travail de codification et d’organisation. Il est l’auteur des « leys d’amor », vaste œuvre d’érudition, somme d’austères règles de grammaire et d’art poétique, manuel de morale et de bien vivre. Guilhem Molinié veut embrasser la totalité des savoirs universitaires déclinés sous la forme de 9 sciences.
Il propose comme norme linguistique aux poètes de son temps la langue de Toulouse, devenant norme universelle.
Il crée un nouveau style de poésie, « mariale et florale »
Le conférencier évoque les derniers troubadours : outre Arnaud Vidal et Ramon de Cornet, déjà cités, Peire de Lunel (de Montech) et Gaston Fébus,
Il signale la création de nouvelles récompenses : à la violette s’ajoutent l’églantine, le souci puis l’amarante et le lys.
Il évoque le mythe isaurien, l’invention de Clémence Isaure, à partir du concept de clémence, apparu en 1489 (on lui a même trouvé une statue).
Avec le temps, on note l’abandon progressif de l’occitan dans le concours de poésie et la transformation du consistoire en un collège de rhétorique (aux 7 mainteneurs s’ajoutent des maîtres es jeux floraux)
En 1694 ce collège est transformé par Louis XIV en Académie des Jeux Floraux.
Deux évènements plus récents sont signalés :
En 1771, le jeune Fabre, de Carcassonne, âgé de 20 ans, remporte le Lys, mais Fabre du Lys sera plus connu comme Fabre d’Eglantine.
En 1819, trois récompenses sont attribuées au jeune Victor Hugo (17 ans)
« Toulouse la romaine où en des jours meilleurs
J’ai cueilli tout enfant la poésie en fleurs »
Et le conférencier de laisser la conclusion à Antonin Perbosc qui écrivit en 1924, pour le 6ème centenaire :
« O violeta, englantina, gaug
Forissetz tant o mai unfanosas qu’antan
Per l’honor de Tolosa et del verbe occitan »
A la fin de cette conférence très appréciée, le Président évoque l’auteur des paroles du Se canto et l’œuvre de Claude Nougaro ; il estime que, s’agissant de Clémence Isaure, la légende est plus belle que la réalité, il est donc préférable de préserver la légende…
A une interpellation sur un déclin de la poésie comme genre littéraire, J Passerat répond qu’elle connaît un nouveau souffle ; il y a beaucoup de poètes à découvrir.
3 - CFM 42ème émission enregistrée le 24 juin

Michel Lacotte était invité de l’émission animée par Anne Lasserre, en l’absence de Maurice Petit. C’est le terme « bénévole » qu’a décliné « la fortune du mot » : en effet l’invité compte près de 45 ans de bénévolat, et de surcroît, il est président de Bénévolat 82. L’entretien a permis de découvrir ses centres d’intérêt, ses actions associatives, mais aussi son expédition sur le voilier Belem au profit de jeunes en difficultés, sa pratique quotidienne du cyclisme. Il a aussi évoqué son village natal du Limousin très proche du tristement célèbre Oradour-sur-Glane…
L’illustre célébré par Anne était le prêtre et écrivain Bertrand de Latour (1701-1780), qui fut l'un des fondateurs de l’Académie et son Secrétaire perpétuel.
Robert d'Artois a, quant à lui, choisi comme “livre du mois” Un certain art de vivre, de Dany Laferrière (Grasset, 2023) dont il a lu quelques aphorismes savoureux.
Le lien pour écouter l'émission est le suivant : https://www.cfmradio.fr/michel-lacotte
4 - La séance publique du 1er juillet

Une séance particulière puisqu' il s’agit de la réception par Geneviève André-Acquier, qui fut la première femme présidente de notre Académie, de notre nouvelle consœur Edmée Ladier, élue au 37ème fauteuil, vacant depuis la démission de Madame Christiane Vallespir dont elle prononcera l’éloge avant de présenter sa conférence sur Bruniquel et les débuts de l’archéologie préhistorique en France.
L’existence d’une humanité très ancienne est actuellement reconnue par tous. Mais la Préhistoire en tant que discipline scientifique est née il y a à peine 160 ans. Les travaux menés en Périgord dès 1863 par le marquis de Vibraye puis Edouard Lartet et Henry Christy ont mené à la découverte d’objets en silex, d’armes et d’instruments domestiques en os ou bois de renne, et d’œuvres d’art remarquables. Mais on sait moins que des recherches ont été menées parallèlement, dès 1862, à Bruniquel et dans ses environs. Les travaux de l’abbé Pottier, du vicomte de Lastic Saint Jal, de Victor Brun, de Peccadeau de Lisle ont été à l’époque considérés comme aussi importants que ceux menés dans la vallée de la Vézère. Ces chercheurs ont mis au jour un nombre considérable d’objets et d’œuvres d’art qui ne le cèdent en rien à leurs homologues périgourdins. Victor Brun en particulier a fait un travail scientifique rigoureux, salué à l’époque par les chercheurs aussi réputés qu’E. Lartet puis E. Cartailhac.
Les publications de ces travaux aux résultats spectaculaires ont nourri l’émergence et le développement de la Préhistoire en tant que discipline scientifique. Ils ont aussi très largement contribué à sa popularisation, comme en témoigne le nombre d’ouvrages de vulgarisation, qui jusque dans les années 1900, mentionnent et illustrent les sites de Bruniquel.
5 - Le colloque de l’université de Brest « Eloge du politiquement correct », 3-5 juillet 2024 Montauban, Ancien Collège (colloque ouvert au public, entrée gratuite) sous le patronage de notre Académie a pour sous-titre : « Pour une réévaluation d’un discours modérateur contemporain… »
Ci-dessous le texte de présentation des organisateurs :
Apparu dans les années 1970 aux Etats-Unis, le politiquement correct désigne à ses débuts les formes de discours destinées à lutter contre les discriminations affectant les minorités et les groupes marginalisés. Cependant, et particulièrement en France, le politiquement correct a suscité de nombreuses critiques. On lui a ainsi reproché d’instaurer un nouveau conformisme langagier, fait de stéréotypes et de formules figées, ce qui peut faire douter de sa sincérité.
Ce colloque revisite la notion de « politiquement correct » en tenant compte des critiques précédentes, mais en le recentrant sur ses objectifs initiaux : favoriser un langage de modération et d’intégration sociale face à des pratiques discriminatoires. La réhabilitation de cette notion est d’une actualité brûlante en cette période où se multiplient les messages d’exclusion et de haine, notamment sur les réseaux sociaux.
Dans une telle perspective, ce colloque – qui accueille les participants de plusieurs pays – s’interrogera sur les ressources langagières aptes à redynamiser le politiquement correct dans le sens du dialogue et du respect de l’autre. De même, il abordera le problème de la sensibilisation au politiquement correct dans le cadre de l’éducation et des médias. Enfin, il évaluera la situation du politiquement correct dans divers domaines particuliers (littérature, internet, médecine, etc.).
6 - Publications de l’Académie
Mr,Mme,: Adresse :
Bon de commande
souhaite recevoir le(s) livre(s) suivant(s) (soulignez les livres commandés) :
- - 400ème anniversaire du siège de Montauban (1621-2021) : 15 €.
- - Le Franc de Pompignan, Homme de Lettres et citoyen : 20 €.
- - Deux siècles d’histoire de l’Académie (1730-1930) : 20 €.
- - Le voyage de Languedoc et de Provence : 10 Euros.
- - L’Axe Garonne, la terre et les hommes : 10 €.
- - Du Tarn-et-Garonne aux Tranchées : nos poilus : 15 €.
- - Dictionnaire des Montalbanais, illustres, méconnus, oubliés : 25 €.
- - Pouvillon retrouvé : 20 €.
Participation aux frais d’envoi pour une commande : 6€. Ouvrages récents :
- - Le Handicap. La frontière ( ?) entre le normal et le pathologique. Colloque. J-L Nespoulous (ed.) : 15 euros
- - Qui êtes-vous réellement cher Blaise Pascal ? : 10 euros
Règlement, par chèque uniquement, à l’ordre de l’Académie de Montauban. Le détail de nos publications est en ligne sur le site internet de l’Académie de
Montauban : http://www.academiemontauban.fr/publications/ouvragescollectifs
Adresse :
Responsable de la lettre électronique de l’Académie : Robert d’Artois
Mise en page :
Jean-Luc Nespoulous
Messagerie :
Maison de la Culture, 25 Allée de l’Empereur, 82000 Montauban POUR EN SAVOIR PLUS, cliquer sur ce lien : http://www.academiemontauban
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Académie des Sciences, des Lettres et des Arts de Montauban
Mai 2024
N°75
LES ACTUALITÉS DE L’ACADÉMIE
1. Le mot du Président : p.2
2. La séance publique du 6 mai : p. 3-7
3. CFM : les rendez-vous de l’Académie. 41ème édition, enregistrée le 15 mai : p.8
4. La séance publique du lundi 3 juin : p. 8-9
5. Les publications de l’Académie : p. 9
1. Le mot du Président
Célébrons les ponts !
Bien sûr, les traditionnels ponts de mai sont agréables et appréciables, puisqu'ils provoquent une rupture des séquences de travail. Ils permettent de se ressourcer, de se retrouver en famille ou en amitié. Si, de surcroît, le temps est au «grand beau» ce sont de très agréables moments pour profiter pleinement de la nature au cours de balades, randonnées, occasions de découvertes et autres activités dont je ne vous imposerai pas une énumération au vu de leur immense variété...
A vrai dire, ce n’étaient pas ces ponts de rupture que je voulais évoquer... Mais les ponts qui relient, ceux que les mots tissent entre les hommes. Je prends ce bel exemple des Africains du Sud disant à Nelson Mandela lors de la réconciliation et de la fin de l’apartheid : « Madiba tes mots sont des ponts entre nous ».
Les ponts relient les hommes, les quartiers des villes : à Montauban le Pont Vieux entre la ville haute et Villebourbon, à Toulouse le Pont neuf relie Saint- Cyprien au centre, en Hongrie Buda à Pest, et le Pont-Euxin (étymologiquement « mer hospitalière ») l’Europe à l’Asie Mineure. Ce n’est donc pas sans raisons que Darwin écrivait que « trop longtemps les hommes ont construit des murs et il serait temps qu’ils construisent des ponts ».
Mais à côté de ces ponts édifices, il y a les ponts de l’esprit, le rôle des pontifes (pontifex, en latin) c’est celui qui relie, qui fait le lien entre le sacré et la société, réunit, construit une communauté, une assemblée, une cité, et par extension une politique. C’est ainsi que Federico Mayor, directeur général de l’UNESCO, incitait à « jeter des ponts entre les idées, les savoirs et les énergies ». C’est cette dimension qui me fait dire à l’envi : « Vive les ponts !»

3. La séance publique du 6 mai
Compte rendu de Pierre Gauthier
Le Président ouvre la séance à 17 heures, et passe la parole au secrétaire général adjoint, Philippe Bon, qui présente, comme il est de coutume, l’actualité culturelle à Montauban, en signalant tout particulièrement les conférences de Charles Matharan à l’UTAM et celle de notre collègue Alain Visentini sur « Marc Aurèle » à l’Université Populaire.
Le Président rappelle ensuite que nous célébrons, aujourd'hui 6 mai, le trentième anniversaire de l'inauguration par François Mitterrand et la Reine Elizabeth II du tunnel sous la Manche. Puis il présente notre conférencier, Robert Verheuge, qui doit traiter un sujet vaste et très important puisqu’il s’agit d’« une ambition contrariée : la Cinquième République, des politiques culturelles aux loisirs de masse »
Nous avons la chance, dit Robert Verheuge, de vivre dans un pays où l’Etat a presque toujours été préoccupé de l’art et des choses de l’esprit, avec, depuis le XVIe siècle, une remarquable continuité, mais sans parvenir à hausser la culture au rang des aspirations fondamentales.
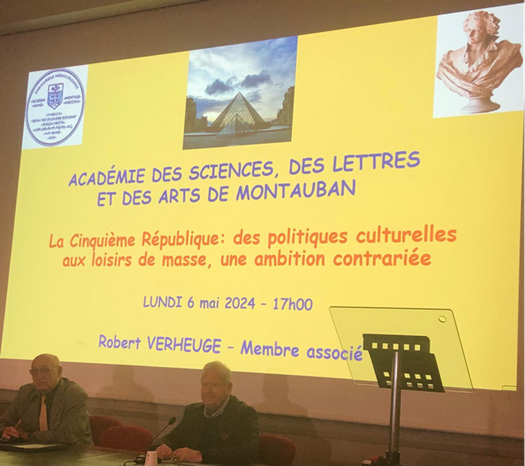
Il y a politique culturelle quand les pouvoirs publics ont une vision globale de la place et du rôle de la culture dans la société, avec ses finalités, ses objectifs et ses moyens.
Le conférencier rappelle la définition particulièrement large de la culture qu’en a donnée l’UNESCO en 1982 (conférence de Mexico) : l’ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social, englobant, outre l’art et les lettres, les modes de vie, les systèmes de valeur, les traditions et les croyances.
Robert Verheuge n’ira pas si loin dans son approche de la culture, qui passe par le préalable de la citoyenneté. Il observe que c’est le plus souvent dans l’espace public que se construit et s’exprime la dimension esthétique de l’appartenance et de la sociabilité.
Il passe rapidement sur les approches totalitaires d’une politique culturelle qu’ont connues certains pays, avant de noter que nous sommes entrés dans le temps du prêt-à-porter artistique, de la concentration industrielle, de l’achat des produits culturels propres à une civilisation de masse où l’évènementiel recouvre et annexe le véritable culturel.
Nous sommes le pays de l’exception culturelle, concept qui relève du droit international, qui fonde des limitations au libre échange dans ce domaine en vue de soutenir et de promouvoir nos artistes, avec, par exemple, deux applications pratiques, bien connues, de ce concept, le prix unique du livre et le financement de la production cinématographique via le CNC.
Si l’on remonte aux origines de cette exception culturelle il faut évoquer l’ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539, la création de l’Académie française et celle de la Comédie française, parmi les plus connus des très nombreux épisodes qui se succèdent tout au long de cinq siècles.
Après ces rappels rapides mais indispensables des concepts de base de notre politique culturelle, Robert Verheuge aborde la politique culturelle de la 5e République en distinguant, dans ses 66 ans, quatre périodes.
La première (1958-1969) voit une cohabitation du rêve gaullien de grandeur et des idées du Front Populaire. Elle est dominée par la figure d’André Malraux à qui de Gaulle apporte une « utopie globalisante ».
Le conférencier observe que ce ministère de la Culture, créé pour Malraux, ministère au périmètre du reste instable et aléatoire, a vu passer 26 ministres mais que seuls deux couples Président-Ministre ont su laisser une politique culturelle ambitieuse et fondatrice, De Gaulle et Malraux, puis Mitterrand et Jack Lang.
En 1961, le Conseil Supérieur du Plan officialisait » l’entrée de l’action culturelle dans le vocabulaire officiel : « ce qui vise à maintenir la culture vivante, la transmettre, la répandre, réduire les inégalités dans l’accès à l’art et aux choses de l’esprit »
Les Maisons de la Culture, ces nouvelles cathédrales, des équipements uniques au monde, sont créées, mais avec le risque de s’en tenir à un petit nombre de projets prestigieux.
Mais en même temps, le secrétariat d’Etat à la jeunesse et aux sports, dirigé par l’alpiniste Maurice Herzog, accompagne la création d’équipements socio-culturels « qui poussent comme des champignons », financés par les collectivités locales et par l’Etat.
La France est donc quadrillée par de grandes institutions culturelles prestigieuses mais aussi par un réseau d’une toute autre nature, confié et dédié au social et à l’animation.
Au bilan immense d’André Malraux, ministre de 1959 à 1969, une multitude de grands chantiers ouverts que chacun a présents à l’esprit.
La seconde période, de 1969 à 1981, est marquée par des espoirs et des déceptions.
Sous Georges Pompidou est lancée la création du Centre National des Arts et de la Culture (Beaubourg) et la transformation de la gare d’Orsay.
Et la loi Toubon réaffirme le principe de l’exception culturelle.
La troisième, de 1981 à 1993, est celle de Jack Lang (Ministre de 1981 à 1993) mais aussi de François Mitterrand soi-même.
Le budget du ministère de la Culture est doublé, un programme très important de grands travaux est lancé. Le Ministre étend d'ailleurs son champ d’intervention à des domaines qui étaient considérés comme marginaux, comme les arts de la rue, le rap, la bande dessinée.
Il faut se souvenir aussi du lancement de la Fête de la Musique, une très grande réussite, et de la célébration du bicentenaire de la Révolution.
Le conférencier rappelle également que dans le domaine de la chanson la France est première au monde et cite trois manifestations ; le Printemps de Bourges, les Francofolies et Alors Chante.
Il est souvent reproché à Jack Lang une pratique « parisienne et salonarde », une culture de cour avec ses mœurs, ses travers et ses grimaces (Michel Schneider), le désintérêt pour l’éducation populaire, une dichotomie entre culture régalienne et culture de terrain mais il n’en est pas moins vrai que le ministère de la culture sous Jack Lang a favorisé, de façon très volontariste, invention et création.
Entre l’époque De Gaulle/Malraux et l’époque Mitterrand/Lang, on observe une grande continuité, accompagnée d’adaptations tenant compte des mutations de plus en plus rapides de la société.
Robert Verheuge voit dans la quatrième période, depuis 1995 jusqu’à aujourd’hui, le temps des paradoxes.
Certes on peut citer la création sous Jacques Chirac du Musée des Arts Premiers, et l’inauguration sous François Hollande du Mucem, de la Fondation Vuitton et de la Philarmonique de Paris, mais il note une rupture entre la gauche de gouvernement et la culture.
La France répond au défi lancé par l’incendie de Notre-Dame, et soutient financièrement les acteurs et institutions culturelles pendant le confinement et la pandémie, mais le Président de la République déclare qu’il n’y a plus de culture française mais des cultures de France.
Où en sommes-nous ?, demande Robert Verheuge dans sa conclusion.
Jamais il n’y a eu autant de moyens mis dans la culture que depuis le début de la cinquième République, et d’efforts pour la démocratiser.
10 à 20% des Français accèdent, dans la « sphère publique », au monde des idées et de l’art, et ce secteur dégage une valeur ajoutée de 46 Milliards d'€ alimentant le PIB.
Le bilan de ces 66 dernières années serait donc positif s’il n’y avait deux facteurs d’inquiétude :
-Le développement du numérique, accompagné par une inévitable dérégulation du marché cognitif, qui produit de façon massive ignorance, confusion et intolérance.
-L’Etat reste incapable de hausser la culture à la hauteur d’aspiration fondamentale, pire, il n’y a plus de grande ambition dans ce domaine.
Vivement appréciée par un public nombreux, cette conférence suscite de nombreux commentaires, et questions.
Au président qui regrette que l’Europe s’illustre plus par son marché que par sa richesse culturelle, tout en saluant la réussite de l’Euro monnaie unique, Robert Verheuge répond en citant le plein succès du programme Erasmus et en rappelant que Marseille fut un temps capitale européenne de la culture.
S’agissant de l’éducation populaire, à laquelle le conférencier comme le président sont très attachés, celui-ci cite le rapport Condorcet de 1792, qui en précise les objectifs et les contours : « Nous avons observé, enfin, que l'instruction ne devait pas abandonner les individus au moment où ils sortent des écoles ; qu'elle devait embrasser tous les âges ; qu'il n'y en avait aucun où il ne fût utile et possible d'apprendre, et que cette seconde instruction est d'autant plus nécessaire que celle de l'enfance a été resserrée dans des bornes plus étroites. »
En définitive, cette politique ne peut se juger que sur le temps long, elle bénéficie d'une certaine continuité en profitant de la vitesse acquise.
3. Les rendez vous de l’Académie : 41ème émission CFM , enregistrée le 15 mai
Notre invité étant ce que l’on appelle dans un élogieux jargon « un voileux », c’est donc le mot voile qui fit « la fortune du mot ».
L’entretien avec l’invité Robert Verheuge a permis de découvrir un itinéraire en grande partie autodidacte, avec un cheminement au coeur de responsabilités importantes, que ce soit dans l’univers culturel – direction du centre de Saint Maximin – ou dans l’éducation populaire, comme délégué général de l’association Leo Lagrange. Mais aussi un appétit pour les échanges et dialogues humains intergénérationnels comme interculturels.
Anne Lasserre pour sa part avait choisi comme «illustre» Paul Buffa, humaniste qui fut à deux reprises président de notre Académie. Montmartre était le lieu célébré par notre invité. Et Maurice Petit lut le poème élu par Robert Verheuge, « Credo » de Lucien Jacques . Enfin, Robert d'Artois signala, comme « Livre du mois », l’Histoire des préjugés , insidieux qui se travestissent en « sagesse des nations » pour mieux duper (39 articles publiés sous la direction de Jeanne Guérout et Xavier Mauduit, éd . Les Arènes, janvier 2023).
4. La séance publique du 3 juin
C’est à l'occasion de la célébration des 700 ans de l’Académie des Jeux floraux, à laquelle il a participé comme plusieurs membres de notre Académie, que Jordi Passerat, «mainteneur des Jeux Floraux», nous entretiendrade leur histoire : « 1324-2024, les 700 ans des Jeux Floraux de Toulouse et la naissance du Gai Saber ». La plus ancienne Académie d’Europe a inventé les Jeux floraux pour sauvegarder l’héritage des troubadours et donner sa dignité à la langue d’Oc. Les manuscrits précieux des «Leys d’Amors» nous offrent ainsi la première grammaire d’une langue moderne et un traité de rhétorique pour apprendre à bien écrire en versifiant sur tous les thèmes du savoir. Cette véritable encyclopédie, écrite en occitan, révèle le rôle de capitale intellectuelle auquel aspirait la ville de Toulouse en cette fin du Moyen Age.
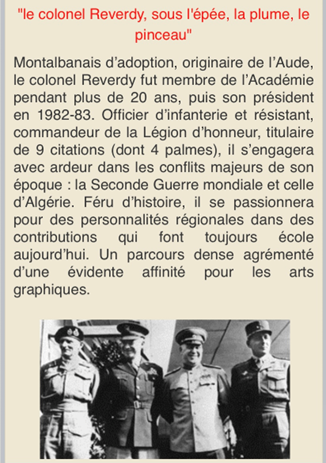
5. Publications de l’Académie
Mr,Mme,: Adresse :
Bon de commande
souhaite recevoir le(s) livre(s) suivant(s) (soulignez les livres commandés) :
- - 400ème anniversaire du siège de Montauban (1621-2021) : 15 €.
- - Le Franc de Pompignan, Homme de Lettres et citoyen : 20 €.
- - Deux siècles d’histoire de l’Académie (1730-1930) : 20 €.
- - Le voyage de Languedoc et de Provence : 10 Euros.
- - L’Axe Garonne, la terre et les hommes : 10 €.
- - Du Tarn-et-Garonne aux Tranchées : nos poilus : 15 €.
- - Dictionnaire des Montalbanais, illustres, méconnus, oubliés : 25 €.
- - Pouvillon retrouvé : 20 €.
Participation aux frais d’envoi pour une commande : 6€. Ouvrages récents :
- - Le Handicap. La frontière ( ?) entre le normal et le pathologique. Colloque. J-L Nespoulous (ed.) : 15 euros
- - Qui êtes-vous réellement cher Blaise Pascal ? : 10 euros
Règlement, par chèque uniquement, à l’ordre de l’Académie de Montauban. Le détail de nos publications est en ligne sur le site internet de l’Académie de
Montauban : http://www.academiemontauban.fr/publications/ouvragescollectifs
Adresse :
Responsable de la lettre électronique de l’Académie : Robert d’Artois
Mise en page :
Jean-Luc Nespoulous
Messagerie :
Maison de la Culture, 25 Allée de l’Empereur, 82000 Montauban POUR EN SAVOIR PLUS, cliquer sur ce lien : http://www.academiemontauban
9
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Académie des Sciences, des Lettres et des Arts de Montauban
Avril 2024
N°74
Sommaire:
1. Le mot du Président : p. 2
2. La séance publique du 8 avril : p. 3-6
3. CFM : les rendez-vous de l’Académie. 40ème édition, enregistrée le 15 avril : p. 6
4. La séance publique du lundi 6 mai : p. 7
5. Les publications de l’Académie : p. 8
Le mot du Président
Voyager...
D'après Homère, le périple du retour d'Ulysse vers Ithaque fut difficile, éprouvant, surprenant, semé d'embûches…Cette Odyssée est une mémorable épopée ! Pourtant le sonnet de Du Bellay Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage… suggère l'enrichissement que le héros, comme « celui qui conquit la toison » a retiré de cette aventure. Préfiguration de la banale assertion « les voyages forment la jeunesse » ! Bien que toujours actuelle, cette affirmation n'est pas exclusive : toutes les classes d’âge ont perçu l’intérêt, le plaisir du voyage et s’y adonnent sous des formes multiples et variées… Voyages ou simples déplacements ?
Voyager réellement c’est rencontrer, découvrir, admirer, partager, échanger, ouvrir les yeux, les sens, les appétits, les goûts… C’est évidemment dans cet esprit que les voyageurs du XIXème siècle faisaient « le tour » des capitales et villes célèbres de l’Europe, ce qui donnera le mot « touriste »… On n’en était pas aux excès que nous connaissons : le « surtourisme » dont certaines villes, voire certains pays commencent à se protéger, pour ne rien dire de l'affligeante expression, devenue leitmotiv : « j’ai fait la Grèce, l’Italie etc … »
Il importe à l'inverse de faire l’éloge du « vrai » voyage comme ouverture aux autres et au monde, même si l’on peut aussi voyager dans sa tête : « autour de [sa] chambre », selon Xavier de Maistre.
« A quoi te sert de voyager si tu t’emmènes avec toi ? C’est d’âme qu’il te faut changer, non de climat » nous conseille Sénèque. Avec la belle saison qui vient voyageons donc l’esprit grand-ouvert.
Ce que préconisait déjà Montaigne. Marguerite Yourcenar pour sa part attribue à Hadrien dans ses Mémoires cette déception devant le faible nombre d’esprits voyageurs : « Peu d’hommes aiment longtemps le voyage, ce bris perpétuel de toutes les habitudes et cette secousse sans cesse donnée à tous les préjugés.
2. La séance publique du 8 avril
Le Président ouvre la réunion à 15h, devant une assistance nombreuse, en passant la parole au Secrétaire Général qui donne, comme à l’habitude, le calendrier des manifestations culturelles du mois.
Celui-ci souligne en particulier le Salon du livre qui se tiendra le dimanche 28 avril au foyer du Fort. Il signale aussi que l’Institut d’Etudes Occitanes célèbrera les 20 et 21 avril le 80e anniversaire de la mort d’Antonin Perbosc, avec une conférence de Norbert Sabatié.
Le Président indique aux membres associés, à jour de leur cotisation, qu’ils pourront retirer le recueil des conférences 2023 à l’issue de cette séance.
Il salue l’arrivée de l’impétrant : Pierre Desvergnes, accompagné par ses parrains, Anne Lasserre et Norbert Sabatié.
Ce dernier commence la présentation de notre nouveau membre titulaire par une interpellation : « apprendre vous motive » puis il évoque ses origines quercynoises, plus précisément de la région de Caylus, et son itinéraire professionnel qui l’amènera dans la Sarthe, puis aux Mureaux où il sera conseiller municipal, et en Normandie, où il passera une douzaine d’années, sur les traces d’Alphonse Allais auquel il a consacré une conférence qui a ravi notre Académie le 6 février 2023 (« le Pote Allais »). Il fréquente le comédien Jean-Marie Proslier.
Revenu dans notre région il y a une quinzaine d’années, il assume la présidence de la Compagnie des écrivains de Tarn et Garonne depuis 2019 et a créé il y a trois ans le Salon du livre (dont la prochaine édition, signalée en début de réunion, accueillera Mme Julie Gayet).
« Vous êtes – conclut N. Sabatié - un pince sans rire au grand cœur et nous vous accueillons pour le meilleur et pour le rire ».
Pierran Desvergnes remercie l’Académie pour son accueil, en particulier ses parrains (et marraine, Anne Lasserre est « plus qu’une fleur, un bouquet ») et fait l’éloge de son prédécesseur au 24e fauteuil, le Docteur Philippe Rollin.
Ce dernier, né à Montauban en 1924, père de cinq enfants, fixé Faubourg du Moustier, qualifié en pédiatrie, fut élu dans notre Académie en 1994 au fauteuil de l’abbé de Vezins.
Il manifesta un goût prononcé pour les archives et nous représenta jusqu’en 2005 à la Conférence nationale des académies.
L’impétrant remarque en souriant qu’un « modeste infirmier » va siéger à la place d’un éminent médecin dans une compagnie dont une des raisons d’être est « l’encouragement au bien »
Sous le titre « Au pied de la lettre » il présente ensuite sa conférence sur les riches échanges épistolaires entre deux très fortes personnalités de notre paysage littéraire et artistique, Marcel Pagnol (1895-1974) et Jules Muraire dit Raimu (1883-1946), en toute amitié et liberté : des propos que l’air du temps permettait et qui feraient sans doute froncer les sourcils aujourd’hui…
Son exposé est alimenté par de nombreuses citations tirées des lettres que ces deux personnalités ont échangées entre 1929 et 1946, échanges marqués par de nombreuses « fâcheries » suivies de réconciliations entre deux hommes liés par une très forte amitié.
Le contenu de ces échanges, souvent très directs, a porté sur les rôles confiés à Raimu, sur aussi le montant de ses cachets, et beaucoup sur la distribution des rôles dans les pièces puis les films qu’ils ont montés ensemble.
Les lettres citées portent majoritairement sur la trilogie Marius-Fanny-César mais aussi beaucoup sur La Femme du Boulanger. D’autres œuvres sont mentionnées comme Le Schpountz , Topaze et La Fille du Puisatier .
C’est au théâtre Marigny qu’est née en 1929, avec de premiers échanges déjà savoureux, « une amitié pleine de coups de gueule, de rires, de fâcheries et surtout des plus belles pages du cinéma français »
Pagnol, encore inconnu, propose à Raimu de jouer dans Marius mais ce dernier veut jouer le rôle de César et non celui de Panisse, ce qui conduit l’auteur à remanier sa pièce.
« On se dispute » ensuite sur l’accent des acteurs (« je cherche à défendre ta pièce et à me défendre moi ») mais finalement Pagnol impose Pierre Fresnay.
Enfin, Raimu fait un coup de force et rétablit la fameuse scène de la partie de cartes que Pagnol avait enlevée, à la suite de quoi Pagnol écrira sur la tapisserie de la loge de Raimu : « Raimu est un génie ».
« Avec Marius – lui écrit ce dernier- tu as écrit la grande comédie du père et du fils, de l’amour paternel et de l’amour filial »
« On se dispute » lorsque Pagnol veut porter Fanny au cinéma « parlant » : « au cinématographe, écrit Raimu, tout est mort, c’est définitif… sans aucune place pour l’amour du public »
Le troisième volet de la trilogie est porté directement à l’écran, et Raimu veut négocier son cachet à la hausse : dans la négociation, Pagnol utilise un subterfuge en laissant croire à Raimu que le film commence par l’enterrement de César...
Il a fallu convaincre Raimu de jouer dans La Femme du Boulanger : « ce sera un travail de joueurs de boule et d’avaleurs d’apéritif » écrit-il à Pagnol qui lui répond : « mon cher Jules, je te considère comme le premier ou le dernier des imbéciles, cette fois je te le dis, c’est fini… »
« On se dispute » beaucoup sur la distribution, ce qui conduit Pagnol à écrire : « je n’ai jamais eu le moindre désir de t’emmerder, même quand tu es emmerdant, ce qui t’arrive quelques fois… »
Dans ce film, les conseils de Raimu tant sur la distribution que sur le tournage sont insistants, ce qui montre bien son haut degré d’implication.
Il écrit à Pagnol : « avec le rôle dans La Femme du Boulanger , tu m’as fait un beau cadeau »
Sur Le Schpountz, « tu ne pouvais pas me faire plus plaisir en me faisant comprendre que toi aussi tu avais ri en regardant Le Schpountz ». (Pagnol)
« Avec toutes tes lettres, tu vas bientôt faire la pige, écrit Pagnol, à Madame de Sévigné, ceci n’est pas un reproche…je lis les belles à tout le monde » mais il écrit aussi : « tu n’as aucun bon sens »
Dans une autre lettre, Pagnol écrit à Raimu : « si tu fais un navet de plus j’aurai la consolation de n’y être pour rien, sur ce, bien affectueusement à toi »
La réplique de Raimu est de la même eau : « mon cher Marcel, je reçois ta lettre sur mon lit car je suis couché avec 80 ventouses, et avec toi ça fait 81…tu es un emmerdeur génial mais un emmerdeur...tu es un auteur de génie mais un très mauvais metteur en scène ».
La Comédie-Française propose à Raimu de l’engager pour jouer dans Le Bourgeois gentilhomme : il l’écrit à Pagnol qui lui répond en lui adressant ses condoléances.
Pagnol est présent à la clinique où Raimu doit subir une petite intervention chirurgicale, il le trouve se disputant avec l’infirmière car il veut goûter avant l’intervention une bouteille de whisky qu’on vient de lui offrir. Raimu va à pied au bloc opératoire, commande à son épouse un steck et des frites. Il ne se réveillera pas.
« Que Jules ne soit plus là me fait de la peine pas seulement parce que je l’aimais mais parce que je n’arrêtais pas de me disputer avec lui »…« Ton génie fait partie du patrimoine de la France ».(Marcel Pagnol)
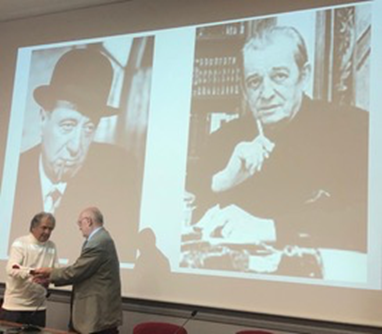
(Compte rendu réalisé par notre confrère Pierre Gauthier).
3. CFM les rendez-vous de l’Académie 40ème émission, enregistrée le 15 avril
Entretien avec l’invité Pierre Marillaud, un itinéraire républicain…
Ainsi que les chroniques habituelles :
« A la fortune du mot » : Intervenir L’illustre par Anne Lasserre : Louis Cahusac : aimer à la folie ! Le livre par Maurice Petit : Laure Murat, Proust, roman familial : comment la lecture de La Recherche » lui parle de sa famille Le lieu choisi par notre invité : le port de la Rochelle
Pour l’écouter https://www.cfmradio.fr/pierre-marillaud
4. La séance publique du 6 mai
Ambitions à la baisse pour une politique culturelle initiée par André Malraux ? Une des questions posées par le conférencier Robert Verheuge…
La France se positionne comme le pays de « l’exception culturelle ». Qu’est-ce que cette expression recouvre réellement ? Staline disait à Ramadier et à Churchill que le pouvoir ne se mesure qu’au nombre de divisions blindées. Napoléon, au contraire, a rédigé les statuts de la Comédie-Française pendant l’incendie de Moscou, parce qu’il avait évalué le pouvoir de ce qu'André Malraux appelait « les choses de l’esprit ». La Cinquième République conduit depuis 66 années une politique culturelle volontariste. Mais on peut regretter qu’elle n’ait pas articulé éducation populaire et action culturelle.
Nonobstant ce manque, la Cinquième République a conduit avec une étonnante continuité une politique culturelle que lui envient les nations démocratiques. Elle a pris appui sur des décisions, des textes fondateurs, dont certains remontent à la Monarchie et à l’Empire. Il est passionnant de découvrir ou redécouvrir la longue histoire du développement culturel.
Cette politique culturelle est maintenant contrariée par une tendance à l’industrialisation, à la mercantilisation et par le développement des industries du numérique, avec les conséquences que l’on sait sur nos esprits et nos démocraties.
Le conférencier, à partir de son parcours professionnel dans le monde de l’éducation populaire et celui de l’action culturelle, a pensé qu’il était temps de faire le point et de poser la question : « où allons-nous ? »
5. Publications de l’Académie
Bon de commande
Mr , Mme , :
Adresse :
souhaite recevoir le(s) livre(s) suivant(s) (soulignez les livres commandés) :
- 400ème anniversaire du siège de Montauban (1621-2021) : 15 €.
- Le Franc de Pompignan, Homme de Lettres et citoyen : 20 €.
- Deux siècles d’histoire de l’Académie (1730-1930) : 20 €.
- Le voyage de Languedoc et de Provence : 10 Euros.
- L’Axe Garonne, la terre et les hommes : 10 €.
- Du Tarn-et-Garonne aux Tranchées : nos poilus : 15 €.
- Dictionnaire des Montalbanais, illustres, méconnus, oubliés : 25 €.
- Pouvillon retrouvé : 20 €.
Participation aux frais d’envoi pour une commande : 6€.
Ouvrages récents :
- Le Handicap. La frontière ( ?) entre le normal et le pathologique. Colloque. J-L Nespoulous (ed.) : 15 euros
- Qui êtes-vous réellement cher Blaise Pascal ? : 10 euros
Règlement, par chèque uniquement, à l’ordre de l’Académie de Montauban.
Le détail de nos publications est en ligne sur le site internet de l’Académie de
Montauban : http://www.academiemontauban.fr/publications/ouvragescollectifs
Responsable de la lettre électronique de l’Académie :
Robert d’Artois
Mise en page :
Jean-Luc Nespoulous
Messagerie :
Adresse :
Maison de la Culture, 25 Allée de l’Empereur, 82000 Montauban
POUR EN SAVOIR PLUS, cliquer sur ce lien :
http://www.academiemontauban.fr
Académie des Sciences, des Lettres et des Arts de Montauban
Mars 2024
N°73
LES ACTUALITÉS DE L’ACADÉMIE
Sommaire:
1.Le mot du Président : p. 2
2.L’émission radiophonique des Rendez-vous de l’Académie : p. 2
3. La séance publique du 4 mars p.3-7
4. La séance publique du lundi 8 avril : p. 7-8
5. Les publications de l’Académie : p. 9
Le mot du Président
L’échange
C’est un mot qui, depuis plus de six mois, résonne dans l’actualité : on ne parle que d’échanges d’otages… Pour ma part je préfère les échanges culturels ou sportifs, les échanges d’œuvres d’art, de savoirs, de savoir-faire, de civilités ; pourquoi pas de recettes de cuisine…
Sans doute l’échange a-t-il été précédé dans les sociétés primitives par le troc, mot parfois mal connoté de nos jours… Il n’empêche qu’il est vraisemblablement l’élan qui préside à la naissance des sociétés, et sous-entend le respect d’une égalité.
Sans doute aussi a-t-il généré les premières formes du calcul et de l’écriture pour mémoriser et consigner les tenants et aboutissants des échanges, prémices de l’économie.
Malheureusement on peut aussi échanger des coups, des horions, à éviter…Mais échanger c’est surtout discuter, argumenter, confronter des points de vue, des opinions, ce qui maintient la vivacité intellectuelle et la liberté de penser, exalte et développe les richesses humaines. « Si tu diffères de moi, loin de me léser, tu m’enrichis » rappelait Saint-Exupéry .
« Un homme seul est en mauvaise compagnie » disait Paul Valéry...L’échange manifeste un refus de l’isolement, le besoin d’échanges assumé évite de s’enfoncer dans une solitude faussement confortable. Il nous épargne aussi l’adhésion aveugle aux idées reçues et « libère la syntaxe et évite l’ankylose de la logique » (G. Bachelard).
Alors persistons à échanger ! C‘est bon pour les sociétés humaines et pour le monde dont nous sommes les citoyens.
2. Les « rendez vous de l’Académie » CFM 39ème émission
L’invité du jour était le président de l’association Alphonse Jourdain, l’architecte Gérard Marre, aussi président de Relience. C’est pourquoi la « fortune du mot » a exploré les diversités du mot “pluriel”. Le lieu que l’invité a choisi de faire découvrir : le cirque de Parragi dans le massif des Cinque-Terre en Italie. Le livre du mois : le Tacite de Xavier Darcos et l’illustre du mois : Edouard Raynaud. Pour écouter cet enregistrement : https://www.cfm radio.fr/gerard-marre

3. La séance publique du 4 Mars
L’Académicienne Anne Lasserre, qui a les Pyrénées chevillées au cœur, nous a expliqué comment, au fil des temps, ce massif a été apprécié.

Soit longtemps ignorées, soit objet de différents imaginaires, les Pyrénées sont maintenant fréquentées de diverses manières par des populations dont les centres d’intérêt sont disparates mais qui en fait sont des reflets de cette évolution et permettent d’en retracer les temps forts.
Ces montagnes furent d'abord perçues comme inhospitalières. En témoigne le fondateur de notre Académie, Jean-Jacques Lefranc de Pompignan après sa visite à Barèges qu’il cherche à chasser de sa mémoire « Disparaissez, objets affreux,/ Torrents dont les fougueux écarts/ Se percent des routes bruyantes/ De cascades effrayantes./ Ne fatiguez plus mes regards. »
Elles ont la double peine d’être perçues comme repaire du diable, des sorcières, puis des contrebandiers et des brigands...
Toute méconnaissance entraîne ainsi des fantasmes, des légendes, génératrices d’erreurs et de faussetés.

Sciences et santé.
Mais des paysages aussi grandioses ne peuvent que susciter intérêt et envie de découverte… Voilà pourquoi la première approche se voudra scientifique, car c’est l’amour de la science qui incite à affronter ces terres inconnues, pleines de dangers... Elles seront l’objet de nombreux rapports et d’ouvrages scientifiques dès le XVIIIe siècle. Le plus connu est sans doute les Observations faites dans les Pyrénées de Ramond de Carbonnières, secrétaire du maréchal de Rohan qu’ il a suivi dans son exil à Barèges….
S’y ajoutent les eaux thermales déjà fréquentées par Jules César, puis plus tard par Marguerite de Valois, Catherine de Médicis, Rabelais…Madame de Maintenon amène le duc du Maine en cure à Barèges…
Mais si ces « curistes » ne vont pas bien loin de leur lieu de cure, d’autres s’aventurent, faisant quelques courses à cheval ou en chaise à porteurs.
Une destination branchée.
Ils découvrent quelques paysages saisissants qui vont générer une vision romantique, ainsi que les prémices d’un tourisme…, une nouvelle façon de se déplacer qui consiste à voyager pour le plaisir de la découverte et à publier son récit de voyage.
Au XIXe siècle, les Pyrénées seront fréquentées par Chateaubriand, Rossini, Hugo, David d’Angers… Puis Baudelaire, Flaubert, Viollet le Duc se verront offrir un séjour dans les Pyrénées pour les récompenser de leur succès au baccalauréat. Bagnères de Bigorre sera considérée comme le lieu de France où l’on s’amuse le plus… On va dans les Pyrénées pour se montrer, se distraire, faire la fête… On découvre les sites : Gavarnie, Cauterets et le lac de Gaube deviennent des incontournables… « il est enjoint à tout être vivant et pouvant monter un cheval, un mulet, un quadrupède quelconque de visiter Gavarnie…Les dames et les convalescents s’y font conduire en chaise à porteurs », indique Hippolyte Taine dans le guide touristique dont il est le rédacteur…
Les voyageurs romantiques demandent à ces montagnes de leur renvoyer l’image d’un paradis perdu et retrouvé au fin fond de la France, comme l’Arcadie des poètes….
« Bénissez, ô bergers, votre humble destinée,/ Contents de vos vallons, heureux dans vos hameaux,/ Puissiez-vous des cités ignorer les fléaux,/ Cent fois plus dangereux pour vos douces retraites/ Que ces rocs menaçants suspendus sur vos têtes. »
En revanche, ce type de tourisme ne s’intéresse guère à la population locale, sa pauvreté et ses difficultés à vivre. En plein déni de la réalité, les voyageurs romantiques se contentent de parcourir ces vallées qu’ils qualifient d’heureuses car loin de la société porteuse de bien des maux.
Ce ne sera qu’avec les conquérants des cimes que le regard va changer…
Des sports ? Oui, jusqu’à l’excès…
Parmi les premiers de ces conquérants, il faut noter le comte Henry Russell-Killough, irlandais par son père et gersois par sa mère. Après avoir arpenté l’Amérique du sud, la Mongolie, la Chine et le Népal, il loue pour 99 ans le massif du Vignemale, gravit des monts encore sans nom, notamment celui qu’il baptise Marboré… Après plusieurs ascensions-découvertes, il s’étonne : « N’est-il pas singulier qu’il y ait encore à 8 heures de Cauterets, toute une région de neiges éternelles moins connues que l’Afrique ou la Lune ? »
Le pyrénéisme en est à ses premiers balbutiements. Un genre littéraire nouveau voit le jour : le récit d’ascension. Les courses se multiplient, rendant la montagne moins mystérieuse, plus familière. On narre cela avec un style spécifique, proche des récits de marins explorateurs et découvreurs, à l’instar de Christophe Colomb. Mais aussi avec l’allégorie de la montagne, perçue comme une belle à conquérir.
Si l’on persiste à penser que les montagnes agissent sur le caractère, c’est dans une dimension quasi philosophique : elles seraient une école, feraient aimer le bien et obligeraient à donner le meilleur de soi-même.
Les deux guerres consacrent leur dimension de frontière, mais très rapidement, à l’issue de la deuxième, après les trois glorieuses et par la naissance de la civilisation des loisirs, ce sont toutes sortes de disciplines sportives qui s’y développent.
De nos jours ces montagnes sont devenues une immense aire de jeux multiples et divers : parapente, rafting, canyoning, escalades de pitons mais aussi de cascades gelées. Le ski y est pratiqué dans 34 stations, y compris le ski tracté à cheval (ski-joering) ou à vtt…
Et n’oublions pas qu’elles sont depuis 1903 le théâtre des exploits et légendes du Tour de France cycliste, avec une affluence extraordinaire de spectateurs pour cette rare épreuve sportive gratuite.
En outre le cirque de Gavarnie, déjà comparé à un gigantesque amphithéâtre au XVIIIe siècle, est devenu depuis 1985, sous l’impulsion de François Joxe, une immense scène de spectacle sur laquelle ont été déjà représentés Dieu, Orphée et Eurydice, Roméo et Juliette, Le Songe d’une nuit d’été, Le Cid…
En conclusion, nous pouvons dire que le pyrénéisme est un phénomène relativement récent dont l’avènement a été longuement préparé. Les traces de l’évolution du sentiment de la montagne se trouvent inscrites dans les nombreux ouvrages consacrés aux Pyrénées depuis la fin du XVIIIe siècle, mémoires scientifiques, récits de voyage, récits d’ascension, guides touristiques, recueils poétiques et certains romans, comme Cinq-Mars d’Alfred de Vigny. Leur lecture montre à quel point notre regard est circonscrit par la société et l’époque dans laquelle nous vivons.
En fin de conférence, Anne Lasserre termine par un clin d’œil reliant Montauban aux Pyrénées : dans la revue illustrée Le Quercy, du 1er novembre 1892, l’avocat, peintre et cartographe Paul-Edouard Wallon, né en 1821 à Montauban, signe l’article « Le Quercy et les Pyrénées », concluant : « Entre le Quercy, le Rouergue et les Pyrénées, il existe un lien tout à fait direct. » La conférencière estime qu’il n’est pas étonnant de compter, parmi les premiers dessinateurs de panoramas, Emilien Frossard, qui a fait ses études de théologie à Montauban. Il est à l’origine de la création de l’observatoire du Pic du Midi. Son père, Benjamin Frossard, fut, en 1809, un des membres fondateurs de la Société des Sciences, Agriculture et Belles Lettres de Tarn-et-Garonne, qui deviendra l’Académie de Montauban.
4. La séance publique du 8 avril
Ce sera une séance de réception, celle de Pierre Desvergnes par Norbert Sabatié. Le nouvel académicien lui répondra et fera l’éloge de son prédécesseur, le docteur Philippe Rollin. Sa conférence, « Au pied de la lettre », nous dévoilera la correspondance entre Marcel Pagnol et Raimu : durant 16 années, Marcel Pagnol et Jules Raimu se sont écrit. Leurs écrits épistolaires nous font rencontrer deux personnalités cocasses et différentes, mais liées par une amitié authentique. La mauvaise foi, les engueulades, l’ironie, la complicité, la tendresse, l’humanité, l’admiration qu’ils se portent apparaissent dans leurs écrits, et tout cela se dévore sur un fond de décor de Provence : le Sud !
Le contenu de leurs lettres nous ramène au théâtre et au cinéma de leur époque et fait rejaillir chez certains des souvenirs de moments fabuleux, pour d’autres ce sera la découverte d’un auteur avec un grand A et d’un interprète avec un grand I, loin d’un art m’as-tu vu et commercial. Le respect des textes et du public était leur préoccupation première.
La lecture de leur correspondance fera passer un moment d’intimité avec ces monstres sacrés et nous n’en sortirons pas indemnes, en compagnie de César, Marius, Fanny, la femme du boulanger et tant d’autres œuvres de Marcel servies par Jules.

L’union de ces deux immenses talents explose de bonheur pour un bouquet final salué par nos rires, notre respect, notre émotion et une soudaine envie de vivre.
Enfin les deux compères nous disent : la vérité, rien que la vérité…
Marcel Pagnol (1895-1974),
Jules Muraire dit Raimu (1883-1946).
5. Publications de l’Académie
Bon de commande
Mr , Mme , :
Adresse :
souhaite recevoir le(s) livre(s) suivant(s) (soulignez les livres commandés) :
- 400ème anniversaire du siège de Montauban (1621-2021) : 15 €.
- Le Franc de Pompignan, Homme de Lettres et citoyen : 20 €.
- Deux siècles d’histoire de l’Académie (1730-1930) : 20 €.
- Le voyage de Languedoc et de Provence : 10 Euros.
- L’Axe Garonne, la terre et les hommes : 10 €.
- Du Tarn-et-Garonne aux Tranchées : nos poilus : 15 €.
- Dictionnaire des Montalbanais, illustres, méconnus, oubliés : 25 €.
- Pouvillon retrouvé : 20 €.
Participation aux frais d’envoi pour une commande : 6€.
Ouvrages récents :
- Le Handicap. La frontière ( ?) entre le normal et le pathologique. Colloque. J-L Nespoulous (ed.) : 15 euros
- Qui êtes-vous réellement cher Blaise Pascal ? : 10 euros
Règlement, par chèque uniquement, à l’ordre de l’Académie de Montauban.
Le détail de nos publications est en ligne sur le site internet de l’Académie de
Montauban : http://www.academiemontauban.fr/publications/ouvragescollectifs
Responsable de la lettre électronique de l’Académie :
Robert d’Artois
Mise en page :
Jean-Luc Nespoulous
Messagerie :
Adresse :
Maison de la Culture, 25 Allée de l’Empereur, 82000 Montauban
POUR EN SAVOIR PLUS, cliquer sur ce lien :
http://www.academiemontauban.fr
Académie des Sciences, des Lettres et des Arts de Montauban
Février 2024 - N°72
LES ACTUALITÉS DE L’ACADÉMIE
Sommaire:
1. Le mot du Président : p. 1-2
2 . La séance publique du 5 février p.3-5
3. L’émission radiophonique des Rendez-vous de l’Académie : p. 6
4. La séance publique du 4mars.p. 6-7.
1. Le mot du Président
Retrouver les plaisirs de la conversation…
Chaque jour qui passe nous apporte, via tous les médias, son lot d’invectives, de jugements à l’emporte-pièce, de condamnations immédiates sans analyse ni respect.
Certains en oublient que l'homme est, par essence, « un animal politique », comme le rappelait Aristote, c’est-à-dire un être social et sociable, dimension prônée par l’expression imagée dont on abuse parfois : « faire société »…
L’échange s’avère, par le biais du langage, être le nœud de la vie sociale ; sans doute d’abord troc puis échange économique, enfin d’informations, de sensations, de peines, de joies aussi que l’on incite à partager, puis vraisemblablement de points de vue qui, mieux charpentés, deviendront des idées.
Prendre le temps de la conversation, c’est à la fois lutter contre l’immédiateté qui nous harcelle en permanence, c’est préserver l’échange, sous-tendu par un principe d’égalité autant que par le respect de la diversité.
D’ailleurs le mot converser, d'après son origine latine, veut dire : vivre avec, et n'a pas d'autre signification jusqu'au seizième siècle. Conversation, qui en est le substantif, n’est longtemps employé qu'avec le sens d'action de vivre avec. Puis, tout à coup, le dix-septième siècle, fort enclin aux néologismes de signification, le limite à l’action d’échanger des propos…
Mallarmé disait « parler n’a trait à la réalité des choses que commercialement », faisant écho à l’expression « [commerce des hommes qui permet de] frotter et limer sa cervelle à celle des autres » que préconisait Montaigne…
Retrouvons donc le plaisir de prendre du temps pour converser, dialoguer, échanger, bref continuer et même persister à vivre ensemble….
2. La séance publique du 5 février
(Compte rendu de Pierre Gauthier)
Le Président ouvre la séance à 17 heures, en passant la parole au Secrétaire Général qui donne, comme il est de tradition, la liste des manifestations culturelles devant se tenir à Montauban dans les prochaines semaines. On notera aussi des activités culturelles proposées à Verdun-sur-Garonne et à Caussade.
Le Président rappelle que le 6 février verra le 90e anniversaire des événements séditieux de 1934. Puis il introduit la conférence, en soulignant combien le secrétaire général de l’Académie, Jean-Marc Detailleur, qui doit la présenter, est un amoureux des livres.
Celui-ci a choisi de parler d'un homme important, dont la trajectoire est méconnue, dans une période qui intéresse peu nos contemporains, une période toute entière tournée vers la recherche des moyens de finir une Révolution.
Alors, Elie Decazes, Rastignac ou Alcibiade ? Nous verrons bien en suivant le récit passionnant en même temps que très dense de notre collègue, qui présente l’histoire assez extraordinaire d’un ambitieux, séducteur, servi par la chance, et focalise sur la période 1815-1820, où cet homme des lumières, d’équilibre, ce libéral, tient, contre vents et marées, contre la haine des ultras, un rôle déterminant dans la conduite des affaires du pays.
Il est né le 28 septembre 1780, dans la région de Libourne, en Gironde, dans une famille de bourgeoisie de robe. Son père, emprisonné sous la Terreur n’en restait pas moins favorable à la tendance dure des républicains. Lui fait de solides études chez les Oratoriens et s’installe comme avocat à Libourne.
Il ne tarde pas à monter à Paris (comme Rastignac) où il occupe peu de temps un emploi modeste avant de faire un certain nombre de rencontres déterminantes où sa capacité de séduction a certainement joué : il « croise » un avocat bordelais, Jaubert, futur directeur de la Banque de France, et Honoré Muraire, avocat lui aussi, personnage important du Consulat, qui participe à la rédaction du Code Civil et sera Premier Président de la Cour de Cassation.
Il exerce des fonctions importantes dans la franc-maçonnerie renaissante, et les exercera jusqu’au bout.
En 1805 il épouse Elizabeth Fortunée, l'une des filles de Muraire. Elle meurt de la tuberculose deux ans plus tard.
Il sympathise à Cauterets avec Hortense de Beauharnais, qui est alors Reine de Hollande, et avec son mari auquel il restera très attaché.
Ses fonctions de magistrat (il présidera avec brio des cours d’Assises) ne l’empêchent pas de servir Pauline Bonaparte, d’assurer vers 1811 une revue de presse pour « Madame Mère ».
Il fréquente le salon de Geneviève de Rigny, on le voit avec la duchesse d’Abrantès. C’est Rastignac…
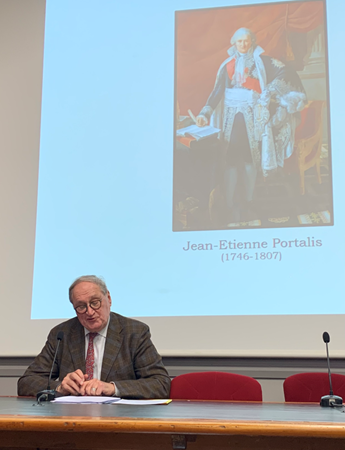
Dès son début il fait allégeance à la Restauration, refuse de prêter serment à Napoléon pendant les 100 jours, rencontre le baron Louis et Talleyrand qui le nomme préfet de police. Ambitieux et charmeur, c’est aussi un bon administrateur, doté d’une grande capacité de travail.
Il séduit Louis XVIII qui l’appelle son cher fils, ils échangent 2000 lettres, le roi le voit tous les jours, il va même jusqu’à le marier à une noble héritière beaucoup plus jeune que lui. Elie Decazes est élu député de la Seine en 1815. Il est entre 1815 et 1818 ministre de la Police du gouvernement Richelieu.
Il dirige un grand ministère de l’Intérieur (qui recouvre plusieurs de nos départements actuels), dans le cabinet du Général Dessoles (ndlr : né à Auch en 1767).
Nommé chef du gouvernement fin 1819, il le reste fort peu : victime indirecte de l’assassinat du Duc de Berry, il en est tenu pour responsable par les ultras qui conduisent contre lui une campagne haineuse (à laquelle prend part Chateaubriand). La chance l’a vraiment abandonné et il est plus que jamais dans une fonction de bouc émissaire. Louis XVIII le nomme ambassadeur à Londres, où il ne reste qu’un an, en raison des problèmes de santé de son épouse qui ne supporte pas le climat. Il revient alors à Libourne et ne reverra plus Louis XVIII, mort en 1824.
Il refusera plusieurs postes sous Charles X, mais il siège à la Chambre des Pairs, dont il est Grand Référendaire, et logé à ce titre au Palais du Luxembourg, qu’il devra quitter lors de la révolution de 1848.
Il prend alors en location l’appartement de la rue Jacob où il mourra le 24 octobre 1860 (de sa « belle mort » et non assassiné comme Alcibiade).
Tout au long de cette carrière politique que le conférencier nous narre de façon très claire et très complète, Elie Decazes a affiché des convictions dont il ne s’est jamais départi : c’est un homme des Lumières, un libéral raisonné, un homme d’équilibre qui a vécu dans ses fonctions ministérielles, et à l’évidence favorisé, la naissance du Parlementarisme en France. Pour lui la raison est la seule source de légitimité du pouvoir.
Le pays où il a exercé ses fonctions ministérielles était en 1815 dans une situation difficile et pour le moins troublée : occupation étrangère, indemnité lourde à payer aux Alliés, terreur blanche, impopularité du Roi Louis XVIII dont l’accession au trône n’allait pas de soi, élection d’une « Chambre Introuvable » dont les positions extrémistes veulent réduire les prérogatives du roi .
La Charte de 1815 était, en effet, un texte de compromis, le moyen de finir une révolution, essayant de concilier droit divin et souveraineté populaire, garantissant la propriété des biens nationaux, la liberté de culte, maintenant le concordat de 1801.
Fait Comte en 1816, Decazes pousse à la dissolution de la « Chambre Introuvable ».
En politique étrangère, il fut défavorable aux expéditions en Espagne et en Algérie.
Les trente dernières années de sa vie, Decazes les passa dans un certain retrait de la vie politique. Fondant non sans difficultés Decazeville, la ville qui porte son nom, alors même qu’en cette période de décollage industriel, la France se trouvait déjà à plusieurs longueurs derrière l’Angleterre.
Alors, Rastignac ou Alcibiade ? Notre collègue se garde bien de trancher. Elie Decazes, homme politique brillant, ne fut en rien un militaire et ne mourut pas assassiné par les ultras, à la différence d’Alcibiade. Le conférencier ne pousse pas la comparaison avec ce dernier. On peut en revanche se demander si la carrière d'Elie Decazes ne peut être rapprochée de celle d’Adolphe Thiers….
Le Président remercie le conférencier pour cette communication très riche, présentée devant une assistance nombreuse.
Il signale la sortie des actes de notre colloque de septembre 2022 sur le Handicap, annonce la conférence d’Anne Lasserre le lundi 4 mars, au cours de laquelle les Pyrénées nous apprendront comment nos regards sur les paysages ont évolué, ainsi que la conférence « aux risques de la liberté » qui sera présentée par l’Académie dans le cadre des journées Olympe de Gouges, le 11 mars à l’heure habituelle.
La séance est levée à 18h15.
3. Les rendez vous de l’Académie
Notre confrère Yves Ripoll, par ailleurs président de l’association Miguel de Cervantes, a été l’invité de la 38ème émission. En l’honneur du « Chevalier à la triste figure » « à la fortune du mot » a décliné les multiples facettes du mot “figure”.

L’entretien a permis d’éclairer l'itinéraire peu commun et riche d'expériences d'Yves Ripoll, empreint d'humanité et d'humanisme.
Maurice Petit nous a incités à découvrir en Dordogne le château de Richemont et l'Abbaye de Boschaud, et Anne Lasserre nous a permis de mieux connaître Jacques Antoine de Molières, l'un de nos « illustres » prédécesseurs.
4. La séance publique du 4 mars
C’est notre consoeur Anne Lasserre par sa conférence : « L’évolution du regard porté sur un paysage, un exemple : les Pyrénées » qui analysera l'approche de notre environnement naturel, les sites dont nous faisons des paysages.
Les grilles de lecture d’un paysage varient selon les époques et au gré des relations que nous entretenons avec notre environnement. C’est ainsi que des lieux peuvent devenir un miroir des mentalités, comme le montrent les différents regards portés sur les Pyrénées depuis le XVIIIe siècle.
La vision que nous avons de ces montagnes, et qui nous paraît tout à fait naturelle, est pourtant relativement récente. Aujourd’hui, nous les arpentons, nous les gravissons, les escaladons, les franchissons, nous nous mesurons à elles, en hiver comme en été. Les randonnées, le ski, l’escalade, le vol à voile… sont à l’honneur.
Or, il n’en fut pas toujours ainsi.
Il a fallu d’abord longuement apprivoiser les Pyrénées qui, aux XVIIIe et XIXe siècles, apparaissaient encore comme des lieux effrayants. Non seulement elles étaient le domaine des sorcières, le repaire des brigands et des contrebandiers, mais elles menaçaient de s’effondrer sur ceux qui osaient s’y aventurer.
La perception actuelle est le résultat d’une lente évolution du regard porté sur les Pyrénées.
La première approche fut scientifique.
Il fallait être animés par l’amour de la science, être géodésiens, géologues, minéralogistes, botanistes, pour oser les affronter. Sous l’influence du Romantisme, le regard devient subjectif, esthétique. Les voyageurs parcourent les vallées à la recherche d’émotions fortes et de tableaux impressionnants. Il faut attendre la seconde moitié du XIXe siècle pour que le regard commence à s’élever vers les sommets et que s’impose peu à peu la conquête des cimes.
Aujourd’hui, les Pyrénées semblent être devenues une immense aire de jeux.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LES ACTUALITÉS DE L’ACADÉMIE
Janvier 2024 - N°71
Sommaire:
1- Le mot du Président : p. 1-2
2 - La séance publique du lundi 8 janvier 2024 : p. 2-7
3 - L’émission radiophonique des Rendez-vous de l’Académie : p. 8
4 - La séance du 5 février 2024 : p. 8-9
5 - Les publications de l’Académie : p. 10
1. Le mot du Président
Tenter, tester certes, mais toujours transmettre !
Nous commençons une année qui entraine quelques changements dans nos cycles de conférences, puisque nous avons réservé et unifié les 4 dernières conférences de l’année autour du thème de l’eau.
Cette expérience nouvelle s’inscrit dans la volonté qu’a l’Académie de porter son intérêt sur un élément ressource de la planète. Cette exploration ne sera pas technique, elle cherche plutôt à creuser la façon dont l’esprit humain l’a investi avec les représentations et créations que cela a pu générer.
Dans la même perspective dynamique, c’est la langue française qui sera l’objet de nos analyses et réflexions au dernier trimestre de l’année 2025.
Ces conférences même si elles sont consultables dans un délai assez court sur notre site ( academiemontauban.fr) seront intégrées au recueil annuel que nous éditons et dont nos membres associés bénéficient au même titre que les académiciens titulaires.
Ceci constitue le deuxième corrélat de notre mission de transmission par l’édition, avec la parution très prochaine des actes du colloque sur le handicap, ainsi que l’ensemble des conférences prononcées lors de la journée Blaise Pascal.
2. La séance publique du 8 janvier
Le président ouvre la séance à 17 heures
Il demande d’observer une minute de silence à la mémoire de notre confrère Michel Suspène, récemment décédé à Verdun sur Garonne.
Il signale quelques anniversaires qui marqueront l’année 2024 : le 500e anniversaire de la naissance de Pierre de Ronsard, le 300e de celle d’Emmanuel Kant, le 200e anniversaire de la mort de Théodore Géricault. Il y aura aussi 150 ans qu’un journaliste sarcastique a inventé le terme « impressionniste », 100 ans qu’André Breton a publié le Manifeste du Surréalisme, 50 ans que Marcel Pagnol nous a quittés.
Jean-Marc Detailleur, secrétaire général de l’Académie, signale les nombreuses manifestations culturelles qui se dérouleront à Montauban et dans le département .
La parole est ensuite au Docteur Daniel Donadio, Académicien, qui traite d’une aventure scientifique en perpétuelle évolution : l’histoire de la chimiothérapie.
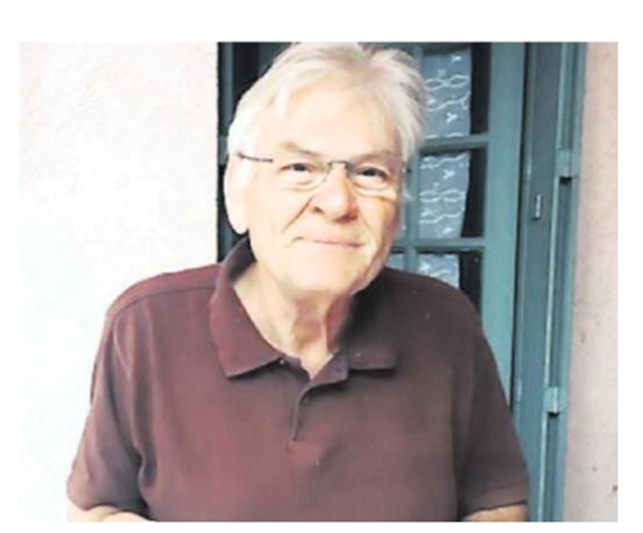
La quête des mots est essentielle pour comprendre leur origine et leur devenir, il faut aller chercher leurs racines dans l’Antiquité : Hippocrate décrit la formation de nombreux vaisseaux autour de la tumeur, évoquant les pattes d’un crabe : Karkinos, en grec donnera cancer. Galien, pour sa part évoque un œdème autour de la tumeur, une grosseur, Onkos, qui donnera le nom d’oncologie
Connu depuis l’Antiquité, le cancer, malgré sa diversité, a un fondement commun, la dégénérescence cellulaire : au lieu de croître normalement, de faire leur travail et de mourir selon un processus programmé, l’apostose, des cellules mutantes se multiplient trop vite, de façon anarchique et forment une tumeur dans un organe et parfois colonisent, par voie sanguine, un autre organe (métastase).
On est passé, face à ce phénomène, de l’alchimie à la chimie puis à la chimiothérapie. La chimie, « science qui étudie la constitution atomique et moléculaire des corps ainsi que leurs interactions » se développe à partir du XVIIe siècle sous ses différentes branches et conduit à l’apparition de la pharmacologie et à la création de l’industrie pharmaceutique.
Ce développement est accompagné par l’invention du microscope en Italie en 1625, il débouche sur l’histologie (histos, trame ou tissu en grec) et sur l’anatomie-pathologie, puis par la radiologie, à partir de la découverte du rayon X par Wilhelm Röntgen en 1886.
Dans le langage courant, le terme de chimiothérapie est utilisé pour définir des traitements médicaux, surtout du cancer. « Mais l’antibiothérapie est une chimiothérapie antibactérienne, comme le traitement de la tuberculose. Après le cancer et les maladies infectieuses, le terme de chimiothérapie s’applique à la psychiatrie, aux maladies cardiovasculaires et récemment aux maladies auto-immunes », en fait à toutes les disciplines de la médecine moderne.
Comment agit-elle ?
Les drogues de la chimiothérapie bloquent la division cellulaire (mitose) au niveau de la molécule d’ADN et inhibent la multiplication et la croissance de la tumeur, mais ces drogues attaquent aussi les cellules saines de l’organisme, agressent certains organes et fragilisent notre système immunitaire.
Le conférencier rappelle les différentes modalités de chimiothérapie, qui sont des traitements personnalisés, à la carte. Il souligne, au terme de l’énoncé de ces définitions, qu’histoire de la médecine, cancer et chimiothérapie sont intimement liés.
Il entre alors dans cette histoire de la chimiothérapie, qui va « de la sagesse ancestrale aux promesses d’hier, d’aujourd’hui et de demain ».
L’étude des momies avec les techniques modernes d’imagerie révèle l’absence de tumeurs, hormis certains cancers du sein mais surtout la présence d’artériosclérose : le professeur Zimmerman écrit que « l’absence de tumeurs malignes chez les momies montre que les facteurs cancérigènes sont liés à l’industrialisation moderne ».
Avant d’ouvrir le livre des découvertes de la chimiothérapie, le conférencier rappelle l’itinéraire de quatre médecins illustres, Hippocrate, Galien, Paracelse et le savant allemand Paul Ehrlich qui découvre la première drogue chimique issue de l’arsenic. La chimie moderne naît avec le XXe siècle.
Paul Ehrlich (1854-1925), considéré comme le père de la chimiothérapie et qui reçoit le Prix Nobel en 1908, part de travaux sur la tuberculose et la syphilis et s’intéresse à l’arsenic. Il isole un composé de l’arsenic actif contre la syphilis, le « 606 » dont le succès est retentissant. « Pour la première fois des malades sont soignés non pas avec des plantes mais avec des molécules issues de la chimie ».
L’utilisation en 1917 de la première arme chimique, le gaz moutarde ou Ypérite conduit à de nouvelles découvertes : « le remède est parfois dans le poison ». On observe que ce gaz détruit les globules blancs : pourrait-il être utile pour détruire les cellules dans les cas des enfants atteints de leucémie aigüe ? « De cette réflexion va naitre la première vraie chimiothérapie anticancéreuse dans le cadre du programme secret de recherche américain sur les armes chimiques ».
Mais la réelle chimiothérapie anti cancéreuse est l’œuvre du pathologiste Sydney Farber, de l’Université de Harvard, qui a travaillé sur l’acide folique (vitamine B9) qui joue un rôle déterminant dans l’Adn et la multiplication cellulaire : il isole des substances « anti-folate » qui vont bloquer la multiplication des cellules cancéreuses, et leucémiques en particulier.
Dans les années 50, l’arsenal chimique est déjà bien fourni pour le traitement des hémopathies malignes.
« Depuis la deuxième guerre mondiale la médecine a bénéficié de l’unité de la pensée scientifique, rigoureuse, et de la continuité de son développement » ouvrant la voie à des molécules innovantes, aux résultats parfois inespérés.
Le conférencier souligne alors le rôle de l’État dans les investissements colossaux pour l’époque qui ont permis de construire un réseau de centres régionaux de lutte contre le cancer. La recherche fondamentale et la recherche appliquée y coexistent pour la meilleure prise en charge du patient.
L’essor de la chimie a permis d’isoler de nombreuses molécules à partir de produits toxiques comme le gaz moutarde ou l’arsenic mais aussi à partir de micro-organismes ou de plantes. Avec la culture des micro-organismes, français et italiens vont isoler la Daunorubicine connue sous le nom de cérubidine. L’étude de la fleur et des feuilles de la pervenche de Madagascar, permet de découvrir une nouvelle molécule : la vincristine connue sous le nom d’oncovin. Le cis-platine dans les années 80 est la dernière grande découverte qui va révolutionner le traitement de nombreux cancers, encore aujourd’hui. Leurs effets secondaires sont responsables de complications souvent néfastes au patient, et des voix s’élèvent pour proposer d’autres médecines, une médecine s’appuyant sur les plantes et les minéraux encore présente en Inde et en Asie du sud-est, elle ambitionne souvent de prévenir la maladie.
Cette moisson de découvertes spectaculaires en chimiothérapie ne doit pas occulter d’autres découvertes retentissantes comme les rayons X en 1886 et la radiothérapie, la cortisone, les sulfamides, l’insuline…
Survient alors, en 1953 la découverte par Crick et Watson de la structure « en double hélice » de l’ADN, qualifiée « de plus grande réussite scientifique de notre siècle » : la structure de l’ADN est une échelle torsadée dans laquelle les « barreaux » sont constitués de substances appelées base et les « montants » sont fixés par de l’acide phosphorique et du glucose. D’innombrables pathologies bénéficient de cette découverte pour comprendre les maladies héréditaires, les maladies infectieuses, la cancérogénèse, et pour perfectionner de nombreux traitements.
Avec cette découverte majeure, la médecine fait « un pas de géant ». Le dépistage génétique, pour de nombreuses pathologies, est devenu un examen de routine.
Ensuite notre confrère évoque les cancers guéris par la chimiothérapie : « des histoires terribles qui se terminent plutôt bien ». Il cite le Pr Henri Pujol : « Aujourd’hui on ne soigne pas le cancer, on le traite et on peut le guérir »
Et il insiste sur la leucémie lymphoblastique de l’enfant où une triple démarche thérapeutique a permis de faire passer le taux de survie à 5 ans de 0,7% en 1947 à plus de 70% dans les années 1990.
Et sur la maladie de Hodgkin, décrite en 1932 par Sir Thomas Hodgkin qui constate chez six patients des ganglions associés à une grosse rate. Une histoire restée longtemps mystérieuse mais ce cancer va être pratiquement guéri par une combinaison de drogues associée à la radiothérapie.
Pour les autres cancers, « la démarche sera plus tardive, mais s’appuiera sur cette expérience : combinaison de chirurgie, de radiothérapie et de chimiothérapie »
La dernière partie de son propos porte d’abord sur quelques données chiffrées sur le cancer aujourd’hui, qui sévit comme un véritable fléau à l’état d’endémie : 8,5 millions de décès par cancer dans le monde chaque année, ce qui représente l’une des cinq principales causes de décès dans le monde, la deuxième aux États Unis ; en France il est responsable d’un décès sur quatre.
Un zoom sur deux des principales localisations :
- Le cancer du sein, premier cancer féminin, dont le nombre annuel a été multiplié par deux entre 1990 et 2018. 12 146 décès en 2018, en baisse de 1% par an entre 2010 et 2018. Le taux de survie à 10 ans est de 76%
- Le cancer du poumon, le plus fréquent et le plus meurtrier. La consommation de tabac est en grande partie responsable de ce résultat mais il y en a 12% d’origine professionnelle. La survie à 5 ans est de 20% pour les patients entre 50 et 65 ans.
« Depuis ces deux exemples, on peut envisager un avenir moins sombre, surtout pour le cancer du sein. Il en est de même pour les autres cancers ».
Les avancées thérapeutiques reposent sur les nouvelles orientations de la carcinogénèse : « On est en train de quitter l’ère où la seule solution était la chimiothérapie pour les nouveaux défis de ce début du XXIe siècle : l’immunothérapie, la biothérapie (association chimiothérapie immunothérapie), les anticorps conjugués, les anticorps monoclonaux, les nouvelles cibles moléculaires… les vaccins… et les nouvelles techniques de radiothérapie ciblée, fractionnée… »
De nombreuses voix s’élèvent pour « faire reculer les thérapies toxiques », des équipes parlent de « désescalade » en faisant l’impasse sur les traitements de chimiothérapie et de radiothérapie en première intention.
Les promesses aujourd’hui sont aussi fondées sur le dépistage et la prévention, mais il faut déplorer que l’offre de soins soit plus importante que l’offre de prévention. La politique de santé publique doit reposer sur une démarche pédagogique de prévention qui doit débuter à l’école primaire.
En conclusion le conférencier observe que la chimiothérapie, avec des drogues anciennes toujours utilisées et des molécules innovantes, est le plus souvent associée à la radiothérapie et à la chirurgie, triptyque incontournable et souvent déterminant. Mais il insiste aussi sur les effets secondaires et délétères : « Tout est poison et rien n’est sans poison, la dose seule fait que quelque chose n’est pas un poison » (Paracelse)
Tout patient, dit-il, avant de débuter son traitement spécifique, devrait pouvoir connaitre cette aventure médicale qu’est l’histoire de la chimiothérapie.
L’approche de la prise en charge se définit par la théorie des « 4 P » : personnalisée, prédictive, préventive, participative … et pédagogique, et il faut avant tout ne pas oublier la sagesse d’Hippocrate : « Écouter le malade, le soigner, peut être le guérir, mais ne jamais lui nuire ».
Notre confrère répond ensuite, comme c’est l’usage, à un certain nombre de questions qui tournent pour l’essentiel autour :
- De la psychologie, dans la genèse du cancer, dans l’annonce du diagnostic, mais aussi pour aider à vivre la maladie et à sortir de celle-ci
- Des facteurs environnementaux
In fine, trois remarques :
- 40% des cancers sont évitables
- Il faut permettre d’accéder à toutes les innovations
- Et développer l’offre de prévention
(compte rendu établi par Pierre Gauthier)
3. Les rendez vous de l’Académie n°37

L’invité de la 37ème émission était l’un de nos nouveaux académiciens Pierran Devergnes, président de la Compagnie des écrivains de Tarn et Garonne, c’est donc le mot compagnie dont « la fortune du mot » a exploré les richesses et décelé un risque possible autour des animaux de compagnie… L’entretien a permis de mettre à jour sa culture, sa sensibilité, son originalité et son ouverture aux autres. Il nous a aussi parlé de Saint Pierre Livron, lieu qui lui tient à cœur, enfin, l’objet du mois a porté sur la pointe Bic Cristal. Anne Lasserre a choisi l’imprimeur Edouard Forestié comme personnage «Illustre» qui fut aussi président de notre Académie.
Voici le lien pour l’écouter : https://www.cfmradio.fr/pierran-ce-qui-m-interesse-dans-dans-l-academie-c-d-apprendre
4. La séance publique du 5 février
Notre Secrétaire Général Jean-Marc Detailleur, nous présentera Elie Decazes, « Alcibiade ou Rastignac »….
Jeune, élégant, cultivé, ambitieux, Elie Decazes fut le « chef du cabinet des ministres » de Louis XVIII à 38 ans en 1829, après avoir été ministre de la Police, de l’Intérieur, confident et favori du Roi pendant 4 ans.
Véritable personnage de la « Comédie Humaine »,arrivé dans la capitale à 20 ans ce jeune avocat devient magistrat et côtoie l’élite politique au service de la famille de Napoléon.
Converti au Royalisme, il parvint après Waterloo à approcher Louis XVIII, ayant été nommé préfet de Police de Paris par le nouveau chef du gouvernement Talleyrand avec l’accord du ministre de la police Fouché.
Acquis aux « Lumières » Elie Decazes s’attache à mettre en œuvre la politique de Louis XVIII, du juste milieu.
L’assassinat du duc de Berry le 13 février 1820 marque son renvoi sous la pression de la famille royale et la fin de sa carrière ministérielle.
Il sera ensuite pendant 40 ans, tout en restant au milieu de la vie politique de la monarchie de Juillet, un agriculteur novateur, un industriel visionnaire, investissant à perte toute sa fortune dans les mines et usines métallurgiques en Aveyron, donnant son nom à une ville nouvelle : Decazeville.
5. Publications de l’Académie
Bon de commande
Mr , Mme , :
Adresse :
souhaite recevoir le(s) livre(s) suivant(s) (soulignez les livres commandés) :
- 400ème anniversaire du siège de Montauban (1621-2021) : 15 €.
- Le Franc de Pompignan, Homme de Lettres et citoyen : 20 €.
- Deux siècles d’histoire de l’Académie (1730-1930) : 20 €.
- Le voyage de Languedoc et de Provence : 10 Euros.
- L’Axe Garonne, la terre et les hommes : 10 €.
- Du Tarn-et-Garonne aux Tranchées : nos poilus : 15 €.
- Dictionnaire des Montalbanais, illustres, méconnus, oubliés : 25 €.
- Pouvillon retrouvé : 20 €.
Participation aux frais d’envoi pour une commande : 6€.
Règlement, par chèque uniquement, à l’ordre de l’Académie de Montauban.
Le détail de nos publications est en ligne sur le site internet de l’Académie de
Montauban : http://www.academiemontauban.fr/publications/ouvragescollectifs
Responsable de la lettre électronique de l’Académie :
Robert d’Artois
Mise en page :
Jean-Luc Nespoulous
Messagerie :
Adresse :
Maison de la Culture, 25 Allée de l’Empereur, 82000 Montauban
POUR EN SAVOIR PLUS, cliquer sur ce lien :
http://www.academiemontauban.fr

LES ACTUALITÉS DE L’ACADÉMIE
Décembre 2023 - N°70
Sommaire:
1 -Le mot du Président : p. 1-2
2 -« In memoriam » : disparition de Michel Suspène, membre titulaire : p. 3
3. La séance solennelle du dimanche 10 décembre 2023 : p. 4-6
4. La séance publique du lundi 8 janvier 2024 : p. 7
5. L’émission radiophonique des Rendez-vous de l’Académie : p. 8
6. Les publications de l’Académie : p. 9
1. Le mot du Président
« Car nous voulons la Nuance.. »
Tout s’accélère… Déjà dans l’entre-deux-guerres, dans Regards sur le monde actuel, Paul Valéry marquait cette corrélation entre raccourcissement des délais, c’est-à-dire du temps et rétrécissement de l’espace… Que dirait-il de nos jours où un courriel fait le tour du monde de manière quasi instantanée ?
Nous voilà donc vivant dans l’instant, l’immédiat, ce qui induit des avis en réaction, des sentiments épidermiques, des jugements à l’emporte-pièce, où le ressenti l’emporte sur le réfléchi… L’immédiateté d’Internet est un vecteur commun d’instrumentalisation, de simples messages commerciaux créent un sentiment d’urgence et poussent à répondre, voire agir dans la précipitation…
Le sociologue G. Bronner décrit la façon dont les écrans suscitent la radicalité : « or les idées radicales, fussent-elles très minoritaires, ont toujours un effet. Le philosophe John Stuart Mill disait que le mal n’a besoin de rien d’autre pour s’imposer que de l’apathie des gens de bien et de raison. »
Voilà pourquoi nous devons maintenir la nuance : nuancer nos propos c’est prendre le temps de privilégier l’analyse rationnelle et mettre une sourdine à l’émotivité que l’immédiateté exacerbe.
Ces jours-ci s’ouvre la période des fêtes qu’au nom du bureau de l’Académie je souhaite à toutes et tous belles, heureuses, en famille et en amitié.
A l’année prochaine donc pour notre première séance le lundi 8 janvier.

- « In memoriam »
Hommage à Michel Suspène
Discours de Robert d’Artois, Président de l’Académie, prononcé le 21 décembre jour de ses obsèques en l’église Saint Michel de Verdun sur Garonne
Michel Suspène était membre titulaire de notre Académie depuis l’automne 2004, soit 19 ans, reçu en 2005 par son confrère le docteur Philippe Rollin avec lequel il partageait une conception particulièrement humaniste de la médecine.
C’est ce mot humaniste qui nous vient à l’esprit dès que nous pensons à lui. En effet , sa manière d’être donnait chair et corps à ce terme parfois un peu trop facilement utilisé.
Né à Albi, mais aussi fier de l’ascendance Mallorquine de sa mère qui connut la guerre civile espagnole, il fit ses études secondaires au lycée Lapérouse pendant l’occupation.
Fasciné très jeune par le dévouement permanent de leur médecin de famille, il le prit en exemple et c’est ce qui le décida à vouloir faire le même métier. Médecin de campagne, homme de bons conseils, tourné vers les autres, dans une conception proche d’une forme de sacerdoce, comme l’ont bien perçu et reconnu nombre de verdunois tout au long des 37 ans de son exercice professionnel. Il fut aussi médecin lieutenant-colonel, chef départemental des sapeurs pompiers de Tarn et Garonne..
Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si sa conférence de réception à l’Académie est consacrée à Avicenne, à la fois philosophe et médecin.
Avicenne ce savant, ce médecin qui alliait savoir et bon sens, intellectuel aux multiples facettes, mais loin d’être un esprit désincarné, au contraire toujours tourné vers les autres et le réel.
Avicenne, une référence pour Michel Suspène, homme de savoir discret et d’érudition partagée avec finesse. Michel Suspène, Un lettré au sens le plus noble du terme, à l’humour délicat et communicatif dont il nous a régalé à différentes reprises lors de chroniques appréciées de tous les membres présents à nos séances privées, notamment une sur la L.E.M (la Loi d’emmerdement Maximum) et une autre sur les parlers toulousains.
Nous lui devons aussi en janvier 2020 une très belle conférence quasi prémonitoire et très documentée sur « Mathieu Orfila pionnier de la toxicologie médico-légale » quelques semaines avant le premier confinement, au moment où l’on commençait à évoquer une pandémie….
Mais aussi compagnon de voyage agréable avec sa femme Annie et de leurs amis Valette lors des différentes sorties et déplacements que ce soit avec l’Académie ou l’AMOPA.
Sans oublier le mélomane et son travail inlassable autour de l’orgue de Verdun dont plus d’une centaine de concerts organisés….
Esprit ouvert, curieux, réfléchi, bibliophile assidu et respectueux, empreint d’une sagesse sereine, et dont une malice élégante illuminait le regard…
Nous avions le sentiment d’avoir parmi nous un homme « bon » au sens grec du terme un kallos-Kaghatos, associant bonté et beauté de l’âme.
Michel Suspène, au nom de l’Académie je dirai que nous sommes fiers de vous avoir eu comme confrère, et nous vous remercions d’avoir été des nôtres. …
Michel Suspène, vous allez tant nous manquer…
Le 21 décembre 2023 Eglise Saint Michel de Verdun sur Garonne.
Robert d’Artois,
3. Le 10 décembre : séance solennelle
Le journal La Dépêche du Midi a bien rendu compte de notre séance solennelle, laissons-lui la parole :
La séance de l’Académie sous le signe des droits de l’homme
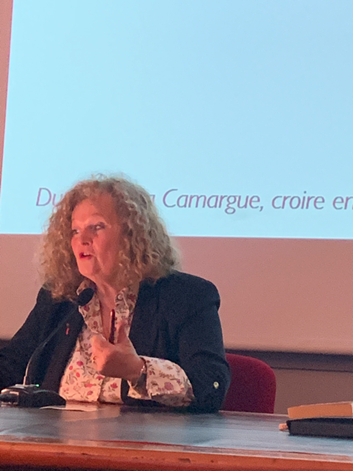
Cette séance solennelle de fin d’année est un moment important de la vie de l’Académie. Elle s’est déroulée dimanche 10 décembre au théâtre Olympe de Gouges en présence des 39 académiciens, de leur président Robert d’Artois, de Brigitte Barèges, maire de Montauban, de Vincent Roberti, préfet du Tarn-et-Garonne et d’un public fidèle. Cette année, trois nouveaux académiciens Philippe Bon, Olivier Fournet et Didier Lérisson ont rejoint l’institution. Trois autres ont été élus, Jean-Paul Dekiss, Pierre Desvergnes et Edmée Ladier.
En ce 10 décembre, 75e anniversaire de la déclaration universelle des droits de l’Homme, Robert d’Artois a fait en préambule l’éloge de René Cassin (1887-1976) :
« Compagnon de la libération, Prix Nobel de la Paix, membre du Conseil Constitutionnel, Académicien dont l’action est considérable, avec un parcours d’excellence. En 1914, c’est la guerre. Grièvement blessé, il sera l’artisan d’une volonté de réconciliation franco-allemande. Dès le 19 juin 1940, il s’embarque pour Londres rejoindre le général de Gaulle qui l’accueille en lui disant ‘Vous tombez à pic’… En effet, René Cassin rédigera l’accord du 7 août 1940 signé par Churchill, de Gaulle et Cassin qui donne un statut à la France libre. C’est en 1948 qu’il compose en coopération avec Eleanor Roosevelt le préambule de la déclaration, un idéal commun à atteindre pour tous les peuples et toutes les nations. De 1944 à 1960 il est président du Conseil d’État, puis en 1965 Président de la Cour européenne des droits de l’homme ».
Brigitte Barèges a poursuivi, citant Alexis de Tocqueville: «Sans la liberté, la vérité devient esclavage de l’erreur». La maire poursuit: « Nous fêtons l’anniversaire de la Déclaration des droits de l’homme, hier celui de la laïcité, 118 ans après la loi de 1905. Ces deux textes fondamentaux corroborent et exhortent à la liberté de pensée, de conscience, d’expression. Ces libertés sont plus que jamais remises en question aujourd’hui».
« Montauban, c’est 900 ans d’art et d’histoire et votre Académie en est un acteur important dans la vie culturelle et intellectuelle du Tarn-et-Garonne par la fondation en 1730 de la Société littéraire de Montauban. Vous participez au rayonnement culturel de notre pays », a, pour sa part, souligné le préfet Vincent Roberti ».

La séance consacrée à «Jean-Jacques Lefranc de Pompignan et la musique» est ensuite ouverte avec Jean-Marc Andrieu, membre titulaire de l’Académie, qui a proposé une conférence fort documentée et illustrée d’intermèdes musicaux dont plusieurs inédits. Il nous a ainsi fait découvrir une facette plus secrète de ce grand homme, celle du librettiste et de l’amateur d’opéra. »

Soprano : Nicole Fournié
Violon : Nirina Betoto
Clavecin : Anne-Lise Labusquière
4. La séance publique du 8 janvier
Histoire de la chimiothérapie,
Une aventure scientifique en perpétuelle évolution,
par notre confrère le docteur Daniel Donadio.
La chimiothérapie, depuis les années 50, est devenue un des traitements majeurs des cancers, le plus souvent associée à la radiothérapie et à la chirurgie. Cancer connu depuis l’Antiquité, chimiothérapie et histoire de la médecine sont étroitement liés pour définir une discipline en perpétuel devenir : la cancérologie.
D’ou viennent ces définitions scientifiques et médicales ? Dans un premier chapitre nous évoquerons les nombreuses passerelles qui existent entre l’alchimie, la chimie et la recherche fondamentale et la physiologie avec ses multiples applications thérapeutiques. Le raisonnement scientifique a toujours guidé les médecins. Encore faut-il détenir les outils ?
Dans un deuxième temps nous rapporterons la « fabrique » de ces molécules chimiques à travers des épopées surprenantes parfois dramatiques, des récits rocambolesques, des découvertes fondées sur le hasard, le courage et « l’éclair de génie » de chercheurs obstinés en s’appuyant au départ sur des « poisons » mortels, véritables armes de guerre.
La définition de la structure de l’ADN en 1953 par Waston et Crick va permettre de définir les modes d’actions et la classification des drogues de chimiothérapie.
Ainsi nous terminerons avec l’émergence de protocoles de chimiothérapie souvent associés à la radiothérapie qui, à partir des années 70, ont rendu possible la guérison de certains cancers, surtout chez l’enfant.
Malgré de nouvelles pistes de recherche, notamment immunologiques, le cancer n’a pas livré tous ses secrets. Ces récentes orientations animent les promesses de demain qui sont déjà les nouveaux défis de ce début du XXIème siècle.
5. Les rendez-vous de l’Académie
Pour leur 36ème émission sur CFM, l’invitée était notre nouvelle consoeur Edmée Ladier. C’est donc le mot « fouiller » qui fit fortune, le questionnaire a permis de découvrir sa personnalité et sa détermination, ce que l’entretien confirma, ainsi que sa passion pour notre vallée de l’Aveyron et ses richesses préhistoriques. Un peu de nostalgie et de surprise avec l’objet cocotte-minute bien connue en cuisine, mais aussi dévoilée comme potentiel coffre-fort… Anne Lasserre rappela la mémoire de Léon Jean Labat, médecin vétérinaire, ancien président de notre Académie… Emission à écouter grâce au lien suivant : https://www.cfmradio.fr/edmee-ladier

6. Publications de l’Académie
Bon de commande
Mr , Mme , :
Adresse :
souhaite recevoir le(s) livre(s) suivant(s) (soulignez les livres commandés) :
- 400ème anniversaire du siège de Montauban (1621-2021) : 15 €.
- Le Franc de Pompignan, Homme de Lettres et citoyen : 20 €.
- Deux siècles d’histoire de l’Académie (1730-1930) : 20 €.
- Le voyage de Languedoc et de Provence : 10 Euros.
- L’Axe Garonne, la terre et les hommes : 10 €.
- Du Tarn-et-Garonne aux Tranchées : nos poilus : 15 €.
- Dictionnaire des Montalbanais, illustres, méconnus, oubliés : 25 €.
- Pouvillon retrouvé : 20 €.
Participation aux frais d’envoi pour une commande : 6€.
Règlement, par chèque uniquement, à l’ordre de l’Académie de Montauban.
Le détail de nos publications est en ligne sur le site internet de l’Académie de
Montauban : http://www.academiemontauban.fr/publications/ouvragescollectifs
Responsable de la lettre électronique de l’Académie :
Robert d’Artois
Mise en page :
Jean-Luc Nespoulous
Messagerie :
Adresse :
Maison de la Culture, 25 Allée de l’Empereur, 82000 Montauban
POUR EN SAVOIR PLUS, cliquer sur ce lien :
http://www.academiemontauban.fr

LES ACTUALITÉS DE L’ACADÉMIE
Novembre 2023 - N°69
Sommaire:
- Le mot du Président : 1-2
- « In memoriam » : disparition de Théodore Braun, membre correspondant : p.3-4
- La séance publique du lundi 6 novembre 2023 : 4-7
- L’émission radiophonique des Rendez-vous de l’Académie : 8
- La séance solennelle du dimanche 10 décembre 2023 : 8-9
- Les publications de l’Académie : 10
1. Le mot du Président
Nous sommes presque au complet ! Bienvenue à notre nouvelle consœur et à nos deux nouveaux confrères : notre Assemblée Générale élective du 6 novembre a élu au premier tour de scrutin :
- au fauteuil numéro 10, vacant depuis la démission, en avril 2022, de Paul Duchein : Monsieur Jean-Paul Dekiss
- au fauteuil numéro 24, vacant par suite du décès du docteur Philippe Rollin, en février 2022 : Monsieur Pierre Desvergnes dit Pierann
- au fauteuil numéro 37, vacant par la démission, en janvier 2022, de Madame Christiane Vallespir : Madame Edmée Ladier
Très belle palette de nouveaux esprits qui viennent compléter la richesse déjà bien diversifiée de notre Compagnie.
Effectif quasi complet donc, puisque 39 sur 40 de nos fauteuils ont un titulaire, ce qui va nous permettre d’exploiter au mieux tous les talents que recèle notre Académie et ce, dans une perspective de diffusion des sciences, des lettres et des arts - ce qui a toujours été le but de notre mission. Il nous appartiendra d’organiser selon notre tradition la réception officielle de ces nouveaux membres.
Par ailleurs, je m’en voudrais un peu si je ne vous glissais comme un clin d’œil et un peu d’humour potache, le fait que le troisième jeudi de novembre (marqué il y a d’autres temps par des rites autour du vin nouveau) a été institué en 2005 par l’UNESCO « Journée mondiale de la philosophie » : « Car en dehors d’être une discipline, la philosophie est aussi une pratique quotidienne qui peut transformer les sociétés et stimuler le dialogue des cultures. En éveillant à l’exercice de la pensée, à la confrontation raisonnée des opinions, la philosophie aide à bâtir une société plus tolérante et plus respectueuse. »
Et si vous me permettez une facétie motivée par ce 3ème jeudi de novembre, certains pourraient peut-être imaginer un lien entre philo et vin… Je vous citerai donc Gaston Bachelard qui, dans La Psychanalyse du feu, les y inciterait : « Bacchus est un dieu bon car il libère la syntaxe et évite l’ankylose de la logique. »
- « In memoriam »
Disparition de Théodore Braun,
Professeur émérite de l’Université du Delaware (U.S.A), Membre correspondant de notre Académie
C’est par un courriel adressé par Jeanne Braun Vélonis, fille de Théodore, fin octobre, à notre confrère Jacques Carral, que nous avons appris le décès de Théodore Braun, survenu le 14 décembre 2022. Il était l’un des meilleurs spécialistes de Jean-Jacques Le Franc de Pompignan, auquel il a consacré sa thèse, Un ennemi de Voltaire, Le Franc de Pompignan, sa vie, son œuvre, ses rapports avec Voltaire, publiée en 1972. On lui doit également une vingtaine d’articles et de communications, en français ou en anglais, consacrés au fondateur de notre Académie. Nous l'avons reçu en qualité de
« membre correspondant » en 2012. Lors de sa réception, il a donné une communication sur « La crise existentielle de Le Franc de Pompignan au début des années 1750 ». En 2018, de retour en Tarn-et-Garonne, et à l'occasion d’une séance foraine de l’Académie à Pompignan, il a prononcé dans la chapelle des Dominicaines du château, une conférence au cours de laquelle il est revenu sur la question des rapports entre Le Franc et Voltaire, mettant en lumière le côté sombre et machiavélique de ce dernier, et évoquant les « Mensonges, calomnies et faits alternatifs » qu’il a inventés pour discréditer le poète montalbanais dans l’opinion.
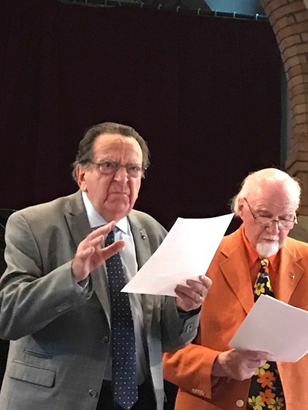
Claude Sicard (alias Voltaire)
dialoguant avec Théodore Braun (alias Le Franc de Pompignan)
Son ami Jacques Carral lui consacrera prochainement un hommage où il reviendra sur sa contribution à la connaissance de la vie Le Franc de Pompignan et de ses œuvres. Cet « In Memoriam » sera publié sur notre site et dans le Recueil 2023.
3. La séance publique du lundi 6 novembre 2023
La séance est ouverte à 17h par le président qui annonce l’élection des trois nouveaux académiciens cités plus haut.
Le Secrétaire Général procède aux annonces culturelles traditionnelles, en tête desquelles l’ouverture, le 21 novembre, des « Lettres d’Automne » qui accueillent cette année Maylis de Kérandal.
Il énumère les conférences prévues à l’UTAM, la journée d’études de la SMERP sur « tolérance et intolérance religieuse : le combat pour la liberté de conscience » du samedi 18 novembre, la communication de Charles Matharan sur la création de l’Ordre National du Mérite, les expositions sur Manuel Azaña et Marc Dautry, et la séance solennelle de l’Académie, le 10 décembre à partir de 15 heures, avec la conférence musicale de Jean-Marc Andrieu : « Jean-Jacques Lefranc de Pompignan et la Musique ».
Après quoi M. Didier Lérisson, nouvel académicien est accueilli solennellement.
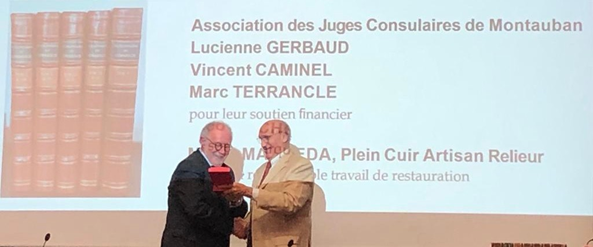
Il est présenté par Mireille Courdeau dans une allocution « affectueuse et admirative ». C’est un Toulousain, fier de ses origines modestes, entré dans la vie active après le Baccalauréat, dans le secteur bancaire où il se forme et progresse, passant de de l’analyse à l’expertise comptable, et où il fera toute sa carrière, à la Banque Populaire. Il est marqué par ses rencontres avec Joël de Rosnay et Michel Serres. Il intervient longtemps à Ouagadougou dans le cadre d’activités de formation. C’est un patron humaniste, exigeant et bienveillant. Il arrive en Tarn-et-Garonne en 2005.
La présidence du Tribunal de Commerce ne l’empêche pas de jouer de la guitare...
Mireille Courdeau conclut en répétant que ce « Lérisson-là ne pique pas, il convainc, il séduit par sa gentillesse, sa malice, ses compétences, sa disponibilité »
Didier Lérisson présente alors l’éloge de son prédécesseur, M Gabriel Roqueplo, né en 1921 à Paris et décédé à Montauban en juillet 2020, à 98 ans. Parisien de la rive gauche, il fait d’excellentes études (HEC, Droit, un DES d’économie). Les années 1947-1948 seront pour lui des années importantes puisqu’il rencontre Dana à Prague dans un rassemblement de jeunesse. Il la retrouve à Londres en 1948, où elle participe aux jeux Olympiques, en tir à l’arc, au titre de la Tchécoslovaquie (Elle sera titulaire de la Médaille d’Argent). Ils se marient à l’automne et se fixent rapidement, en 1950, en Tarn-et-Garonne, où Gabriel Roqueplo est directeur commercial aux Moulins de Saliens, à Reyniès. Il fera toute sa carrière dans cette entreprise dont il deviendra Directeur Général.
Il est élu à l’Académie en 1978, au fauteuil n°29, en remplacement de l’abbé Bozouls. Il est reçu en 1979 par son parrain M. Alain Godeau, directeur honoraire à la banque Courtois, sous le triple signe de la spiritualité, de la rigueur et de la rectitude.
Il nous présentera plusieurs conférences, en 1995 sur le théologien Jean Hus, l’autre en 2006 sur la vie tumultueuse de Dominique Ruzzola, moine de l’ordre des Carmes Déchaux, qui fut mandaté par le Pape pour assister à un certain nombre de conflits, en particulier à Prague et à Montauban. Très impliqué dans le fonctionnement de l’Académie, M. Roqueplo en fut le trésorier pendant dix ans, entre 1995 et 2005.
« Je ne le connaissais pas, conclut Daniel Lérisson, ce fut une belle découverte, un homme d’entreprise aux hautes valeurs morales »
Après quoi, notre nouveau confrère présente sa conférence qu’il a intitulée :
« La dématérialisation du dictionnaire, du papier à la base de données »
Son point de départ est le Dictionnaire Universel de Commerce en 5 volumes, édition de 1759.

Le dictionnaire, dit-il, n’est que l’expression, à un moment précis, de la conjugaison de l’état d’une technologie et d’un niveau de connaissances, l’un et l’autre étant évolutifs.
Il annonce qu’il traitera successivement de l’histoire de ce Dictionnaire puis des domaines impactés par les effets du progrès (technique d’impression, connaissances, finances) avant d’exprimer un certain nombre de remerciements à ceux qui ont permis la restauration de ces cinq volumes.
La création de ce Dictionnaire résulte de celle de l’inspection générale des douanes, par Louvois, soucieux de doter d’outils sa politique manufacturière. Jacques Savary des Brulons, né en 1657, fut nommé en 1686 à ce titre d’inspecteur général des douanes. Il produisit un ensemble de fiches techniques constituant un thésaurus qu’il appela son « manuel mercatique ». « Un vrai travail de titan, réalisé à la plume ». A partir de ce document germe progressivement l’idée d’un dictionnaire de commerce, dont le monde des affaires a besoin.
Ce travail sera à la charge d’un trio composé de Jacques Savary, de son frère Philémon et de l’éditeur Jacques Estienne qui rassemblent les contributions des inspecteurs des manufactures et des ancêtres des actuelles chambres de commerce.
La sortie de ce Dictionnaire Universel de Commerce, annoncée pour 1714, n’intervient qu’en 1723, chez Jacques Estienne, éditeur. Entre temps, Jacques Savary est mort en 1717. Le succès de cet ouvrage suscita une version pirate, laquelle conduisit à de nouvelles éditions du vrai dictionnaire en 1741 et 1750, puis à celle de 1759-65 en cinq volumes, qui est présentée en conférence. Le succès durable de cet outil efficace et opérationnel n’empêche pas de réfléchir à un renouvellement de l’approche suivie, d’autant que l’Encyclopédie arrive.
On glissera donc d’une définition des termes du négoce à celle d’une science économique naissante.
La recherche de gains de productivité dans l’édition a naturellement un impact sur les métiers environnants, et renouvelle le contenu de ces métiers. C’est ainsi qu’on est passé du copiste au correcteur : « terminés les doreurs, relieurs, papetiers colleurs de feuilles. Vive les chefs de projets web- mobile, les ingénieurs cloud computing… ». Quand on fait la liste des métiers qui ont permis la réalisation du Dictionnaire de Commerce, on constate qu’il n’en reste plus beaucoup !
L’appel à des contributions extérieures pour un Dictionnaire ou une Encyclopédie renforce l’anonymat des contributeurs et la personnalisation de l’œuvre autour de l’inspirateur, en dernière analyse le libraire éditeur.
Le conférencier nous propose alors de faire un grand saut dans le temps : la révolution numérique a totalement chamboulé notre environnement, elle en est à ses débuts, la vitesse de progression suit une courbe exponentielle. Le moteur de recherche est un intermédiaire entre le demandeur et le sujet : or leurs réponses peuvent, sur un même sujet, varier considérablement : Daniel Lérisson donne l’exemple de traductions d’un vers d’Horace en plusieurs versions.
Les Data stockent un nombre d’informations de plus en plus important, sans commune mesure avec la mémoire humaine. Par des algorithmes peuvent être agencées des réponses en suivant une logique empruntée au fonctionnement de la pensée humaine, mais….
Pour les utilisateurs l’impératif reste le même : penser par soi-même, et raisonner. La finance : au XVIIIe siècle le financement de l’édition repose sur le libraire imprimeur, qui lance des souscriptions (qui assurent un préfinancement mais il faut souvent faire patienter les souscripteurs). L’Encyclopédie, par exemple, a fini par être un de plus grands succès de librairie de l’ancien régime. L’argent, nous dit le conférencier, est consubstantiel de la nature même de l’entrepreneur, et de nos jours la motivation liée à l’espérance de gain est toujours là, l’entreprise n’est plus perçue que comme un instrument potentiel de gains financiers.
Le besoin de financement du secteur de l’édition confronté à la révolution numérique est considérable.
La financiarisation progressive de l’économie nous met à l’opposé des conceptions d’Adam Smith sur la main invisible régulant l’économie : il serait sans doute bon, glisse le conférencier, qu’elle se manifeste de nos jours. Et face à la révolution numérique, l’adaptation devient une urgence.
Le conférencier conclut en remerciant les personnes qui ont permis de restaurer les cinq volumes de l’édition 1759 du Dictionnaire de Commerce qu'il a eu le plaisir de présenter.
4. L’émission de CFM
« Les rendez vous de l’Académie » fêtaient, ce 13 novembre, leur 35ème émission consacrée aux plus de 33 ans du festival de littérature « Lettres d’Automne ». L’occasion était trop belle pour la « fortune du mot » de jouer sur la parenté lexicale entre festin et festival… L’émission se complut à faire passer Maurice Petit du rôle de questionneur à celui de questionné, lui qui fut le concepteur, réalisateur, animateur inlassable pendant près de 30 ans de « Lettres d’Automne ». Il put ainsi évoquer les grands moments, comme les évolutions de ce festival hors du commun, unique en France.
Enfin, Anne Lasserre nous fit mieux connaître le colonel Yvan Reverdy qui, outre ses faits d’armes, fut un temps président de notre Académie.
Moments forts que vous pourrez écouter lorsque CFM nous aura communiqué le lien :

5. La séance solennelle du 10 décembre
C’est à 15h00 au Théâtre Olympe de Gouges que sera donnée notre séance solennelle, un moment important dans la vie de notre Académie. En un premier temps nous y faisons, en présence des autorités de l’Etat, de la ville, du département, le point de l’année écoulée et présentons les perspectives de l’année à venir.
Puis, dans un second temps, ce sera cette année notre confrère Jean-Marc Andrieu qui, en « conférence-concert », à partir d’une idée de Geneviève Falgas, nous contera et illustrera musicalement les relations entre : « Jean- Jacques Lefranc de Pompignan et la musique ».
Moment privilégié auquel nous vous espérons nombreux.
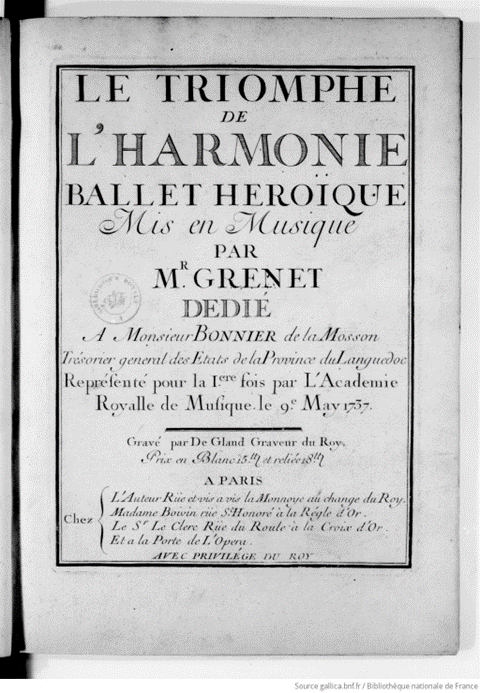
INFOS SUR LE COLLOQUE ÉVOQUÉ CI-APRÈS
Pierre Marillaud
à
Robert d’Artois, Président,
ses chères consœurs et chers confrères,
de l’Académie des Sciences, Belles Lettres et Arts de Montauban
Puisque notre Académie a accepté de patronner le colloque qui se déroulera à Montauban du 3 au 5 juillet 2024 sur le thème : Éloge du « politiquement correct » - Pour une réévaluation d’un discours de modération contemporain , j’ai tenu à vous apporter quelques informations sur ce colloque principalement organisé par Michael Rinn, professeur à l’Université de Brest, et Marc Bonhomme, professeur émérite de l’Université de Berne (Suisse) en même temps que j’adresse l’appel à communications au bureau de notre Académie.
Je précise que Philippe Bécade fait partie du comité d’organisation car, ayant pensé à comparer le discours de la doxa médical et le politiquement correct, cette première proposition de communication a séduit Michael Rinn qui, de ce fait, a sollicité Philippe pour qu’il accepte une place dans le comité d’organisation.
Les deux chercheurs en Sciences du Langage, fondateurs du colloque 2024 de Montauban, Michael Rinn et Marc Bonhomme, ont l’un et l’autre fréquenté à plusieurs reprises le Colloque International d’Albi Langages et Signification, créé par Georges Maurand, et que j’ai eu l’honneur de présider pendant 14 années, de 2001 à 2015.
- Michael Rinn est actuellement professeur à l’Université de Bretagne Occidentale ; Il a publié plusieurs ouvrages dont « Les récits du génocide », « L’Afrique en discours », « Santé publique et communication » et « Témoignages sous influence ».
- Marc Bonhomme, agrégé de grammaire et docteur d’État, professeur émérite de l’Université de Berne, m’aida beaucoup dans le choix des thèmes proposés chaque année pour le colloque d’Albi. Outre de nombreux articles, il publia « Linguistique de la métonymie », « Les figures-clés du discours » (1998), « Pragmatique des figures du discours » (2005), « Le discours métonymique » (2006) et, en collaboration avec Jean-Michel Adam, « L’argumentation publicitaire-rhétorique de l’éloge et de la persuasion ».
J’ajouterai que Roselyne Koren, professeur émérite en Sciences du Langage de l’Université de Tel-Aviv, membre elle aussi, de notre conseil scientifique, était venue au colloque d’Albi en 2004 où elle avait traité un sujet qui, malheureusement... , continue à nous poser des questions brûlantes aujourd’hui : «Contribution à la régulation argumentative du différend politique : le flou polysémique du concept de ‘terrorisme’ est-il insoluble?» Elle publia, outre de nombreux articles ,« Les idées reçues » (Nathan 1991), « L’argumentation dans le discours » (Nathan 2000).
Enfin, je signale la présence de Patrick Charaudeau , professeur émérite de Paris XIII, CNRS, linguiste très connu, auteur de nombreux ouvrages et articles, dont la « Grammaire du sens et de l’expression » ( Hachette 1992, 927 pages) qui fit sensation à l’époque et fut rééditée récemment .
Certes, je suis un peu gêné de mettre mon grain de sel, alors que vous n’avez pas besoin de ces quelques détails avant de lire notre appel à communications, mais le thème du colloque « Éloge du politiquement correct- pour une réévaluation d’un discours de modération contemporain » me laisse penser que les sinistres événements que nous vivons, en particulier depuis l’assassinat du professeur Samuel Paty le 16 octobre 2020, suivi 3 ans plus tard, le 13 octobre 2023, par celui du professeur Dominique Bernard sur le plan national, ainsi que la guerre entre le Hamas et Israël sur le plan international, marqueront sans doute certains des auteurs qui donneront des communications en juillet prochain à Montauban. Aujourd’hui, la plus grande partie des enseignants du primaire et du secondaire de nos établissements publics se condamnent à une véritable autocensure vu les menaces dont certains font l’objet. Qu’elle soit préventive ou de lassitude, cette autocensure remet profondément en cause le fonctionnement de notre école et le principe de laïcité auquel sont soumis tous les établissements publics ainsi que les établissements privés sous contrat. Mais peuvent-ils faire autrement quand certains retrouvent leur voiture avec les pneus crevés, quand ils reçoivent des menaces concernant leur famille ? Il ne s’agit pas de tomber dans l’islamophobie, mais le « pasdevaguisme » qui s’est mis en place depuis trop longtemps déjà, a laissé le champ libre à tous les excès. Des enseignants sont menacés de mort, « on va te faire un Paty », « Sale bâtard, on va te faire la peau », certains élèves ne mangent plus de porc à la cantine de peur de perdre leurs copains, des filles se dispensent des leçons de natation pour ne pas être vues en maillot par les garçons, etc, etc. Alors le discours de sagesse, ce discours de modération pourra-t-il s’imposer ? Nul doute qu’il en sera fortement question au cours de notre colloque. C’est du moins ce que je souhaite vivement, car ancien Inspecteur de l’Éducation Nationale, puis Inspecteur d’Académie-IPR à Toulouse, les échos qui me parviennent de ce qu’il se passe dans les écoles, collèges et lycées publics m’ont atteint le moral, et je vous prie de bien vouloir m’ excuser de vous en avoir fait part.
Mais pour ne pas terminer sur cette note triste, je souhaite que ceux d’entre vous qui nous rejoindront pendant ces trois journées de juillet 2024 prendront du plaisir à participer ou simplement à écouter.
Très cordialement à toutes et tous
Pierre Marillaud
Appel à communication Colloque international
Éloge du « politiquement correct ».
Pour une réévaluation d’un discours de modération contemporain
Ancien Collège
Montauban, 3-5 juillet 2024
sous le patronage de
l’Académie des Sciences, Belles Lettres et Arts de Montauban
- Problématique
Apparu aux États-Unis dans les années 1970 et vulgarisé en français une vingtaine d’années plus tard, le terme « politiquement correct » s’avère profondément ambigu à travers ses enjeux linguistiques, sociaux et politiques.
Dans l’espace anglo-saxon et nord-américain, ce terme désigne essentiellement les formes de discours destinées à lutter contre les discriminations affectant les minorités et les groupes marginalisés. De telles discriminations recouvrent un large spectre englobant le racisme, le sexisme, l’homophobie et des modes d’exclusion plus spécifiques, comme celle liée au handicap. À la fois façon de penser et projet linguistique, le politiquement correct (correct suggérant une idée de conformité éthique, mais aussi de bienséance) présuppose qu’une action volontariste sur la langue peut modifier les comportements dans le sens d’une reconnaissance des différences, d’une valorisation de l’autre et d’une meilleure harmonie sociale (Larrazet, 2010). Concrètement, il se traduit par la mise en place d’une langue non-discriminante fondée sur des procédures de renomination lexicale positivante, de recatégorisation sémantique ou de neutralisation syntaxique (cas des articles ou des pronoms personnels avec l’écriture inclusive). D’un point de vue communicationnel, cette transformation de la langue privilégie la relation (dans l’acception de Watzlawick et al., 1972), vu qu’il s’agit d’estomper le potentiel menaçant des discours et de ménager les faces du public discriminé suivant une visée d’intégration.
Cependant, et particulièrement en France, le politiquement correct a suscité de nombreuses critiques. Sur le plan linguistique, on lui a reproché d’instaurer un nouveau conformisme langagier, invariablement valorisant, composé de stéréotypes, de lieux communs et de formulations euphémisantes. C’est pourquoi sa nouvelle phraséologie conventionnelle a pu faire douter de sa sincérité, d’autant plus qu’en agissant sur les mots, il ne remédie pas forcément aux maux qu’il se propose de combattre. Sur le plan idéologique, par son « hygiène verbale radicale » (Cameron, 1995 : 8), le politiquement correct a été vu comme un instrument de contrôle sur la pensée, destiné à influencer – voire manipuler – l’opinion publique. Dans cette optique, on a tour à tour critiqué son « totalitarisme » (Volkoff, 2001 : 11), son « hégémonisme culturel » (Allan & Burridge, 2006 : 127) ou sa « tyrannie de l’opinion » (Delporte, 2009 : 299), sans parler de ses effets souvent contre-productifs, à l’opposé de ses objectifs consensuels : « On égare le citoyen vers des attitudes d’autocensure, d’inhibition, on verrouille le blocus social » (Mercury, 2001 : 134). Comme le note Krieg-Planque (2021), cette perception négative du politiquement correct est si forte que les locuteurs évitent fréquemment de le prendre en charge pour qualifier leurs discours, l’attribuant aux propos d’autrui qu’ils dénoncent. À ces problèmes s’ajoute le fait que le politiquement correct pâtit parfois d’une extension difficilement contrôlable hors de la sphère stricte de la discrimination sociale, ce qui en dilue la portée conceptuelle. C’est ainsi qu’il s’est vu étendu aux domaines les plus variés : sport, droit, culture, etc., comme en témoignent les ouvrages de Volkoff (2001) ou de Merle (2011). En cela, il tend à se confondre avec la langue de bois ou avec les processus généraux de l’euphémisation du langage.
- Objectif et axes
L’objectif de ce colloque est de réévaluer le concept de « politiquement correct », en tenant compte des critiques précédentes, mais en le recentrant sur son acception première : celle d’un discours de modération et d’intégration face à des pratiques discriminatoires. D’une part, ce concept – reconsidéré selon sa facette positive – est d’une actualité brûlante en ce début de XXIe siècle où l’on voit une montée des discours d’exclusion, tant sur les réseaux sociaux que dans les sphères médiatiques et politiques. D’autre part, envisagé comme un discours de régulation sociale favorisant le vivre ensemble, il constitue un concept à la fois cohérent et souple que des notions voisines, comme celle de « discours inclusif », ne recouvrent qu’en partie. Ce colloque se veut donc une sorte d’« éloge » du politiquement correct, débarrassé autant que possible de sa gangue dogmatique. S’adressant aux chercheurs/euses en linguistique, en littérature et en sciences de la communication, mais également aux psychologues et aux pédagogues, il se propose de contribuer à la modélisation d’une pratique discursive qui invite à l’échange, à l’écoute et au respect de l’autre.
Sur ces bases, les axes d’étude suivants peuvent être privilégiés :
a ) Approches sociolinguistiques et communicationnelles
- Comment le contexte et les conditions de production du politiquement correct ont évolué ces dernières années par rapport à la fin du XXe siècle ?
- Quel bilan peut-on dresser sur la réception récente du politiquement correct ? Quels blocages freinent ou empêchent sa réception positive ?
- Une étude comparative entre les pratiques du politiquement correct dans divers pays permet-elle de le réévaluer positivement ?
- Où en sont actuellement les relations entre le politiquement correct, la langue de bois et le discours inclusif ?
- En quoi les théories de la politesse et des faces (Brown & Levinson, Charaudeau, Goffman, Kerbrat-Orecchioni…) favorisent-elles une meilleure compréhension du politiquement correct ?
b) Approches discursives et rhétoriques
- En quoi les dimensions énonciatives (jeu sur les points de vue, actes de langage indirects, etc.), lexico-sémantiques (création néologique, recatégorisations verbales…) et grammaticales (action sur les pronoms, les adjectifs, la syntaxe…) du discours participent-elles à une orientation positive du politiquement correct ?
- Comment est-il possible de raviver l’expression du politiquement correct à travers des formes langagières novatrices et moins conventionnelles ?
- Comment la rhétorique des figures (euphémismes, ironie, litotes, humour, etc.) est-elle en mesure de valoriser le politiquement correct ?
- Les stratégies rhétoriques fondées sur l’éthos et/ou le pathos peuvent-elles contribuer à lutter contre les discours de discrimination ? Comment les rhétoriques de l’éloquence, en synchronie et en diachronie, sont-elles à même de renforcer les relations interindividuelles ?
- En quoi le recours à l’argumentation s’avère-t-il efficace pour contrecarrer les pratiques discriminantes ?
c) Approches psychologiques et pédagogiques
- Comment éviter que le politiquement correct devienne un discours de manipulation ?
- Le politiquement correct tend-il nécessairement au stéréotypage et à une doxa conformiste, comme le pensent ses détracteurs ? En quoi peut-il contrer les idéologies et les représentations communes reposant sur le rejet de l’autre ?
- Comment sensibiliser efficacement les élèves ou les étudiant/e/s au politiquement correct dans un cadre scolaire et universitaire ? Les manuels pédagogiques sont-ils adaptés pour une telle sensibilisation ?
- Peut-on encore tenir un discours « politiquement correct» devant des élèves qui baignent dans une société de plus en plus tiraillée entre l’individualisme et le communautarisme ? Si « oui », à quel prix et comment ? À l’heure d’Internet et des réseaux sociaux numériques, comment l’école peut-elle toujours s’affirmer comme le lieu où l’on forme l’enfant à honorer la cité et à devenir le citoyen d’une démocratie ?
- Comment diffuser auprès des élèves les instructions officielles relatives au politiquement correct, alors que les parents sont souvent divisés sur cette question ?
d) Études de cas particuliers
Des études de cas plus spécifiques combinant ces différentes approches seront également les bienvenues. Celles-là peuvent porter sur des productions textuelles variées (littérature, médias sociaux, Internet, discours politiques, médiatiques et administratifs). Elles peuvent se concentrer sur un corpus précis ou adopter une perspective comparative. L’essentiel est qu’elles s’attachent à montrer comment le politiquement correct revisité fournit un contre-discours efficace pour faire face aux discours discriminants, notamment xénophobes, racistes, sexistes ou homophobes.
- Éléments bibliographiques
Allan, K. & Burridge, K. (2006), Forbidden Words, Cambridge, Cambridge University Press.
Amossy, R. (2021), L’Argumentation dans le discours, Paris, Armand Colin.
Austin, J. L. (1970 [1962]), Quand dire, c’est faire, Paris, Le Seuil.
Bonhomme, M., de La Torre, M. & Horak, A. (2012), Études pragmatico-discursives sur l’euphémisme / Estudios pragmático-discursivos sobre el eufemismo, Frankfurt am Main, Peter Lang.
Brown, P. & Levinson, S. (1987), Politeness. Some Universals in Language Usage, Cambridge, Cambridge University Press.
Cameron, D. (1995), Verbal Hygiene, London, Routledge.
Charaudeau, P. (2014), « Étude de la politesse, entre communication et culture », in Cozma A.-M., Bellachhab A. & Pescheux M. (dirs), Du sens à la signification. De la signification aux sens. Mélanges offerts à Olga Galatanu, Bruxelles, Peter Lang, p. 137-154.
Clouscard, M. (2013), Le Capitalisme de la séduction, Paris, Delga.
Delporte, C. (2009), Une histoire de la langue de bois, Paris, Flammarion.
Fracchiolla, B. (2023), « Politiquement correct », in Lorenzi Bailly N. & Moïse C. (dirs), Discours de la haine et de radicalisation. Les notions clés, Lyon, ENS Éditions, p. 283-289.
Goffman, E. (1974), Les Rites d’interaction, Paris, Minuit.
Jaubert, A. (2008), « Dire et plus ou moins dire. Analyse pragmatique de l’euphémisme et de la litote », Langue française, n° 160, p. 105-116.
Kerbrat-Orecchioni, C. (2005), Le Discours en interaction, Paris, Armand Colin.
Koren, R. (2019), Rhétorique et éthique, Paris, Classiques Garnier.
Krieg-Planque, A. (2021), « Politiquement correct », Publictionnaire. Dictionnaire encyclopédique et critique des publics. En ligne : http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/politiquement-correct/
Larrazet, C. (2010), « Politically correct : une guerre des mots américaine », Hermès, n° 58, p. 111-112.
Lebouc, G. (2007), Parlez-vous le politiquement correct ?, Bruxelles, Éditions Racine Lannoo.
López Diaz, M. (2014), « L’euphémisme, la langue de bois et le politiquement correct », L’Information grammaticale, n° 143, p. 47-55.
Mercury, Th. (2001), Petit lexique de la langue de bois, Paris, L’Harmattan.
Merle, P. (2011), Politiquement correct. Dico du parler pour ne rien dire, Paris, Éd. de Paris-Max Chaleil.
Piaget, J. (1923), Le Langage et la pensée chez l’enfant, Neuchâtel, Delachaux et Niestlé.
Pick, P. (2017), Qui va prendre le pouvoir ? les grands singes, les hommes politiques ou les robots, Paris, Odile Jacob.
Prak-Derrington, E. & Dias, D. (dirs) (2022), Le Discours et la langue, n° 13.2, « Politiquement incorrect ».
Rinn, M. (2012), « Du bien parler en Euphémie. Le handicap dans la cité honnête, utile et agréable », in Bonhomme M., de La Torre M. & Horak A. (dirs), Études pragmatico-discursives sur l’euphémisme, Frankfurt a. M., Peter Lang, p. 209-221.
Rinn M. et Sherlaw W. (2018), « Santé publique et communication », MEI, n° 44-45.
Rosier, L. (2020), « Politiquement correct », La Revue Nouvelle, n° 5, p. 64-69.
Volkoff, V. (2001), Manuel du politiquement correct, Paris, Éditions du Rocher.
Watzlawick, P, Beavin, J. H. & Jackson Don D. (1972), Une logique de la communication, Paris, Le Seuil.
- Modalités pratiques
Lieu et date : Montauban, Ancien Collège, du 3 au 5 juillet 2024.
Les propositions de communication, d’une longueur de 300 à 400 mots, doivent être envoyées avant le 20 décembre 2023 conjointement aux adresses suivantes :
Les notifications d’acceptation seront envoyées aux participant/e/s avant le 31 janvier 2024. L’ensemble des conférences aura lieu en présentiel.
Les frais d’inscription sont de 50 euros (pauses café, repas de gala, frais d’impression).
La publication d’un ouvrage collectif et/ou d’un numéro thématique dans une revue est envisagée. Des précisions sur ce point viendront par la suite.
Responsables du colloque :
Michael Rinn, Professeur, Université de Bretagne Occidentale, Brest.
Marc Bonhomme, Professeur émérite, Université de Berne, Suisse.
Pierre Marillaud, Inspecteur d’Académie honoraire, ancien chercheur associé à l’Université Jean Jaurès (Toulouse), membre de l’Académie des Sciences, Belles Lettres et Arts de Montauban
Comité d’organisation :
Philippe Bécade, chirurgien, Académie des Sciences, Belles Lettres et Arts de Montauban
Christophe Cosker, Université de Bretagne Occidentale
Pierre Chartier, Université de Bretagne Occidentale
Pierre Marillaud, Inspecteur d’Académie honoraire, Académie des Sciences, Belles Lettres et Arts de Montauban
Michael Rinn, Université de Bretagne Occidentale
Comité scientifique :
Ruth Amossy (Université de Tel Aviv, Israël)
Patrick Charaudeau (Université de Paris 13/CNRS, France)
Béatrice Fleury (Université de Lorraine, France)
Margareta Kastberg (Université de Franche-Comté)
Roselyne Koren (Université Bar-Ilan, Israël)
Alice Krieg-Planque (Université Paris-Est Créteil, France)
Montserrat López Diaz (Université de Saint-Jacques de Compostelle, Espagne)
Paola Paissa (Université de Turin, Italie)
Josias Semujanga (Université de Montréal, Canada)
Ndiémé Sow (Université Assane Seck de Ziguinchor, Sénégal)
Anita Staron (Université de Lodz, Pologne)
Jacques Walter (Université de Lorraine, France)
STATUTS ET RÈGLEMENT DE L'ACADÉMIE :
LA LETTRE MENSUELLE DE L'ACADEMIE :
LE COMPTE-RENDU DE NOTRE DERNIÈRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE :
L'ACADÉMIE AU FIL DES ANNÉES :
À NOTER DANS VOS AGENDAS POUR LES PROCHAINS MOIS :
L'AGENDA CULTUREL DES MEMBRES DE L'ACADÉMIE
LES CONFÉRENCES :
LES EXPOSITIONS :
LES SPECTACLES, CONCERTS ET MANIFESTATIONS DIVERSES :
LES DERNIÈRES PUBLICATIONS
- Lexique amoureux de Montauban , Dirigé par Christian Amalvi & Dominique Porté (En cliquant : voir la fiche ci-jointe pour en savoir plus)
Ce lexique emprunte à bien des genres : un livre d’histoire par ces auteurs historiens patentés ou en herbe, papillonnant entre lieux de mémoire, micro-histoire, mythes et légendes. Un livre d’art par l’attention prêtée aux créateurs mais aussi par ces auteurs qui se plaisent à modeler l’univers qui les entoure et les nourrit, en bonne compagnie avec l’oeil aussi curieux qu’enchanteur du photographe Didier Taillefer.
PARMI LES AUTEURS, on note plusieurs membres titulaires de l’Académie de Montauban : Jean-Pierre Amalric, Genevieve André-Acquier, Guy Astoul, Roland Garrigues, Norbert Sabatié et Christian Stierlé
- Stierlé, Christian (2018) Montauban, Photographies de Claude Dorotte, Editions Sutton : (cliquer voir la fiche)
- Jean de Tinan Lettres à Madame Bulteau , Édition établie, présentée et annotée par Claude Sicard, vient de paraître aux Editions Honoré Champion (janvier 2019)
(Voir l'article dans LA DEPECHE du 07 avril 2019)
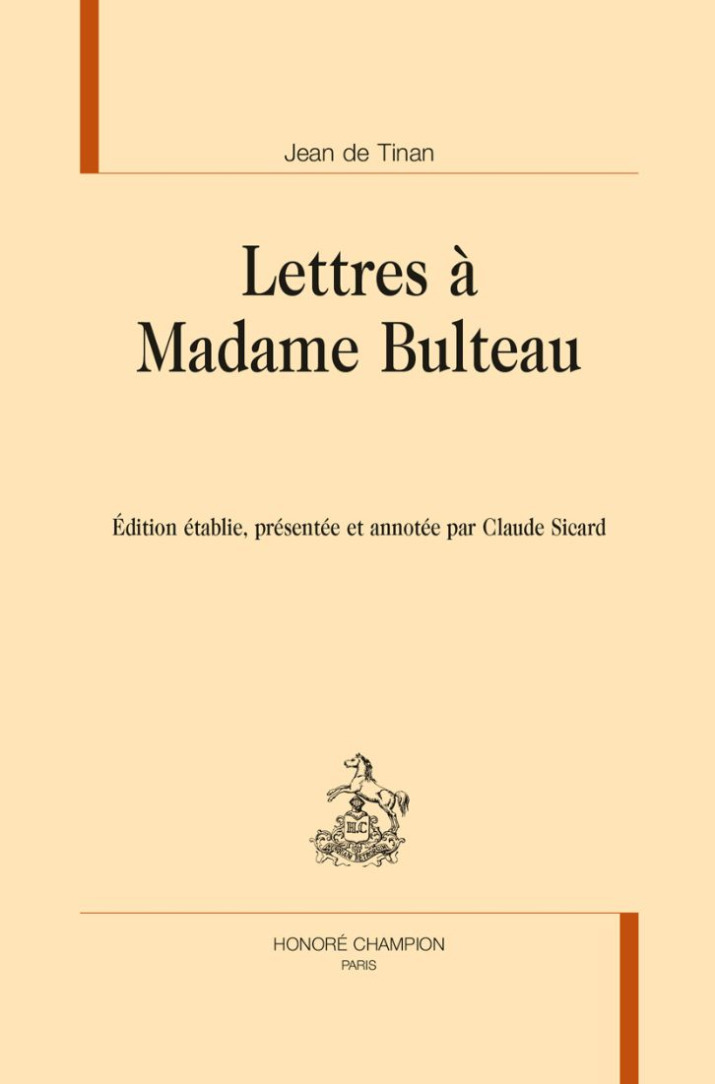
- Guy Astoul , Histoire de Montech, Montech, Europrint (janvier 2019)
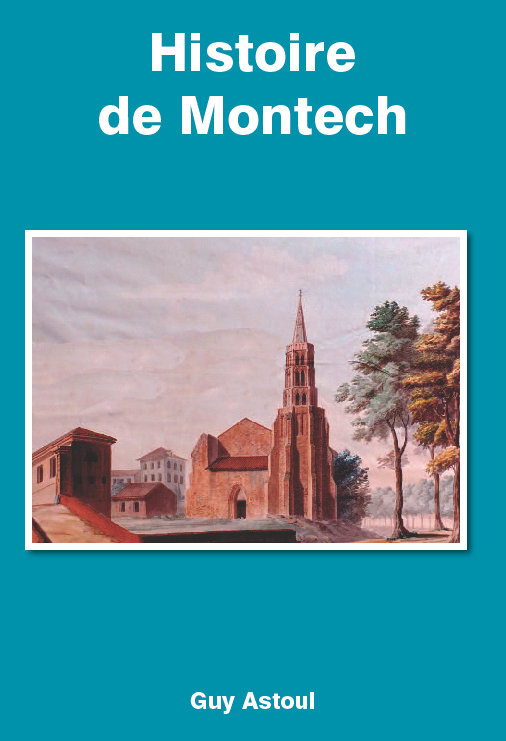
- Geneviève Falgas : Un jour la guerre finira , Editions Cairn, Pyrénées-Atlantiques (novembre 2018)
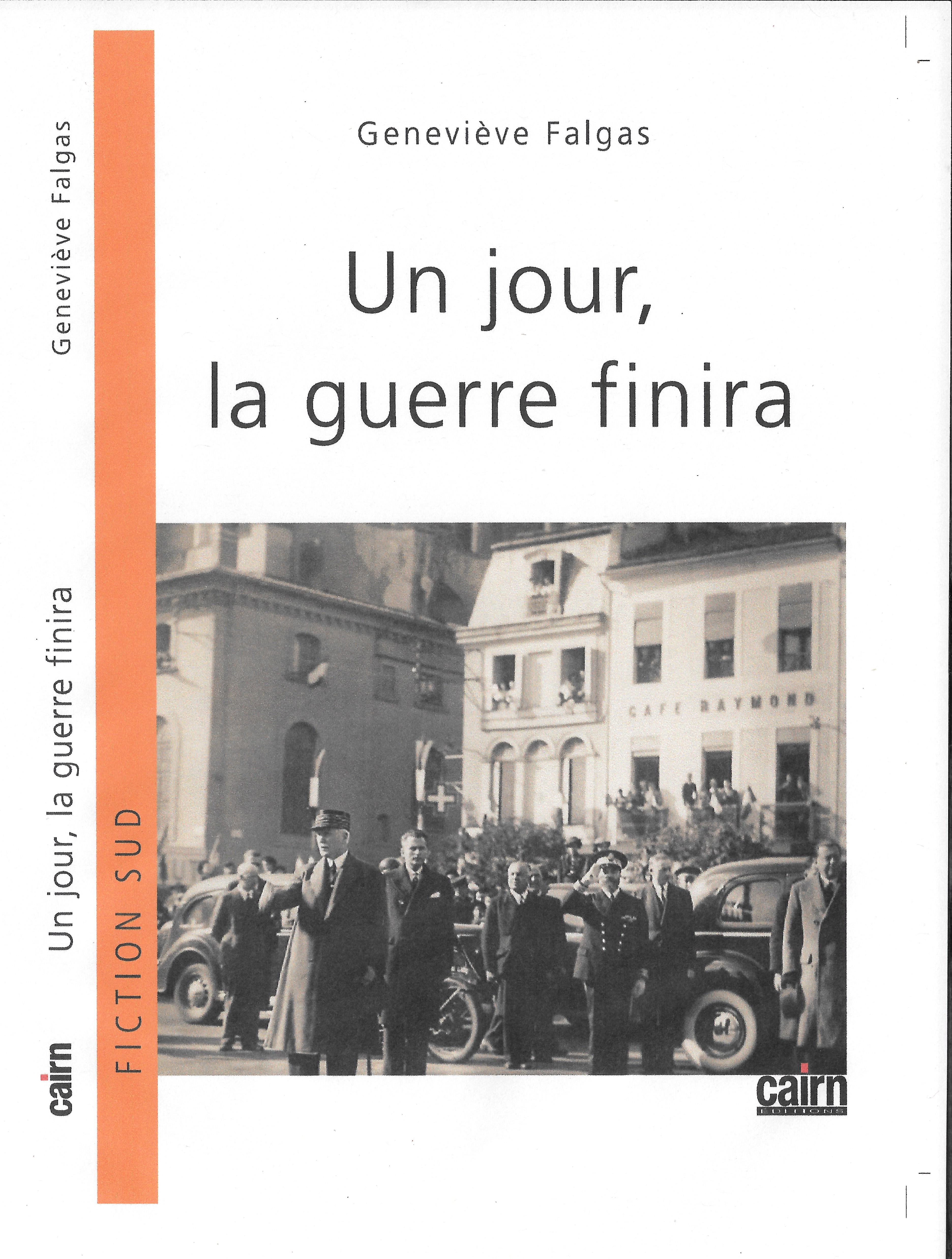
(Voir l'article dans LA DEPECHE du 07 avril 2019)
L'Académie des Jeux Floraux a décerné à Geneviève Falgas pour ce roman, "Le Grand Prix d'Académie-Prix Henri-Fayolle". qui lui sera remis le 3 mai , salle des Illustres au Capitole, à Toulouse.
- Jean-Luc Nespoulous et Edith Labos, Neuropsicolingüostica, recorrido clinico, élémentos conceptuales...y perspectivas, Libéria AKADIA Editorial (2019) (en espagnol)
- Christian Stierlé, Montauban, Histoire et patrimoine de A à Z, Editions Sutton (2019)
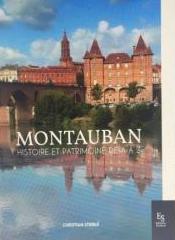
- Chistian Stierlé, Promenades à Montauban, Des lieux, des monuments, des personnages et des événements emblèmatiques, Cairn éditeur (2019)
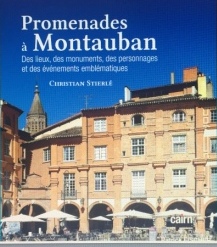
- Jacques Carral : Deux Siècles d'histoire, L'Académie de Montauban de 1730 à 1930, Académie de Montauban, 2019
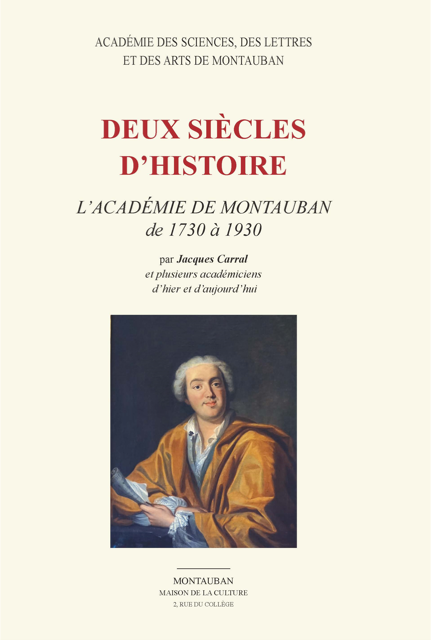
L'ACADEMIE DANS LA PRESSE :

La Dépêche, 26 juin 2019, p. 20.
Pour alimenter cette page, nous avons besoin de votre participation active.
Merci d’adresser les informations à y publier à :